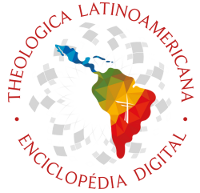Sommaire
Introduction
1 Réconciliation : condition pour l’intégration parfaite de l’être humain avec lui-même, avec Dieu, avec la communauté ecclésiale, avec la société et avec le cosmos
2 L’expérience de la réconciliation dans les Saintes Écritures
2.1 Péché – miséricorde – conversion, dans l’Ancien Testament
2.2 Péché – miséricorde – conversion, dans le Nouveau Testament
3 L’expérience de la réconciliation dans la pratique de l’Église
3.1 Siècles I-VI : réconciliation par la pénitence canonique
3.2 Siècles VII-XI : réconciliation par la pénitence tarifée / privée
3.3 Siècles XI-XX : réconciliation par la pénitence de confession
4 L’expérience de la réconciliation proposée dans le Rituel de la Pénitence de 1973 et ses défis pastoraux
4.1 Le Rituel de la Pénitence de 1973
4.1.1 Points forts théologico-liturgiques
4.1.2 Progrès et limites
4.2 Célébrer la réconciliation aujourd’hui : pistes d’action
Références
Introduction
L’approche du sacrement de la réconciliation se fera à partir des points suivants : 1) La réconciliation comme condition pour l’intégration parfaite de l’être humain avec lui-même, avec Dieu, avec la communauté ecclésiale, avec la société et avec le cosmos ; 2) L’expérience de la réconciliation dans les Saintes Écritures ; 3) L’expérience de la réconciliation dans la pratique de l’Église (approche historico-théologique) ; 4) L’expérience de la réconciliation proposée dans le nouveau rituel de la pénitence et ses défis pastoraux.
1 Réconciliation : condition pour l’intégration parfaite de l’être humain avec lui-même, avec Dieu, avec la communauté ecclésiale, avec la société et avec le cosmos
Parmi les questions existentielles posées par l’être humain au fil de l’histoire, peut-être que celle qui le trouble le plus est la quête de la paix. Parmi les multiples formes de comportement, tant au niveau personnel que social, il en est qui génèrent de graves ruptures qui dépassent le cadre des relations humaines, au point de mettre en danger la viabilité même de la vie sur la planète. Il semble que les divisions et tensions dans le monde tendent à se développer en cercles concentriques, c’est-à-dire depuis de simples conflits interpersonnels et familiaux jusqu’à de grands blocages causés par les intérêts politiques des peuples et des nations. Le pape François, dans sa Constitution apostolique Veritatis Gaudium, met en lumière avec lucidité certains aspects de cette question :
D’autant plus qu’aujourd’hui, nous ne vivons pas seulement une époque de changements, mais un véritable changement d’époque, caractérisé par une “crise anthropologique” et “socio-environnementale” globale, dans laquelle nous constatons chaque jour davantage “des symptômes d’un point de rupture, à cause de la vitesse élevée des changements et de la dégradation, qui se manifestent tant dans les catastrophes naturelles régionales que dans les crises sociales ou même financières”. En dernière analyse, il s’agit de “changer le modèle de développement global” et de “redéfinir le progrès” (VG n.3).
Ce changement et cette redéfinition du modèle comportemental auquel le Pape se réfère peuvent être associés au mot “réconciliation”, si cher à la tradition biblique et liturgique. Il est bien connu que l’être humain aspire, dans son essence, à un monde meilleur, juste, fraternel, réconcilié. La concrétisation d’une telle aspiration exige de la personne de bonne volonté la décision de se mettre dans un processus continu de metanoia, de changement radical de sa manière de penser, d’agir et de ressentir. En effet, l’être humain “n’est ni un ‘non’, ni un ‘déjà’, mais un ‘pas encore’, un être inachevé appelé à se perfectionner, qui doit être créatif et se sentir appelé à lutter et à avancer” (BOROBIO, 2009, p.298).
La réconciliation est une condition sine qua non pour qu’il y ait une intégration parfaite de l’être humain avec lui-même, avec Dieu, avec la communauté ecclésiale, avec la société et avec le cosmos lui-même. Ce processus commence, en premier lieu, par la reconnaissance des limites et des faiblesses qui induisent l’être humain à des pratiques illicites et injustes.
La réconciliation est donc fausse lorsqu’elle consiste à fermer les yeux sur la réalité en feignant qu’elle n’existe pas ; ou lorsqu’on commence par s’absoudre entièrement soi-même ; ou encore lorsqu’on prétend se réconcilier en anéantissant l’autre ; ou en renonçant à tout effort de réconciliation en se disant : “Il n’y a rien à faire”. Ces voies sont fausses car elles nient, en principe, la condition de base de toute réconciliation : accepter les deux pôles ou réalités qui doivent être réconciliés. (BOROBIO, 2009, p.297)
La réconciliation est donc le fruit d’un processus de conversion continu qui imprègne toute action humaine, depuis la simple tâche quotidienne jusqu’aux actions de plus grande envergure telles que : la solidarité, la correction fraternelle, le pardon mutuel, l’engagement pour la justice, l’implication dans la défense de la vie sur la planète, etc. Ainsi, cette compréhension de la “conversion” et la “réconciliation” qui en découle dépassent l’idée que le pardon de Dieu se limite uniquement au moment de célébration sacramentelle de la réconciliation.
2 L’expérience de la réconciliation dans les Saintes Écritures
L’histoire d’Israël est marquée par l’intervention constante de celui qui est “patient et miséricordieux”, qui ne tient pas compte des fautes et des péchés de ce peuple (Ps 130,3). Cette action salvifique de l’Éternel traverse toute l’Écriture Sainte. Bien que d’autres approches du thème soient possibles, dans le cadre de ce texte, nous avons choisi d’examiner l’expérience de la réconciliation à travers la triade : péché – miséricorde – conversion (cf. NOCENT, 1989, p.149-154).
2.1 Péché – miséricorde – conversion, dans l’Ancien Testament
a) Le péché remonte aux origines, c’est-à-dire au moment où l’être humain aspire à prendre la place de Dieu lui-même. À cause de ce péché originel, nous avons été conçus dans la faute (Ps 51,7). Le péché est lié à l’Alliance. Il constitue donc une apostasie de la fidélité envers Dieu. Il existe différents types de péché, le plus fréquent et le plus grave étant l’idolâtrie. En raison de ces “infidélités”, le peuple d’Israël subit des “châtiments” et connaît la joie du “retour” à Dieu. Bien qu’il engage tous, y compris les rois, le péché est aussi une responsabilité individuelle. Le péché est esclavage et, pour cela, il attire le châtiment de Dieu. Ce châtiment est souvent interprété comme un remède donné par Dieu pour corriger ses fils et ses filles du péché.
b) La miséricorde de Dieu est largement chantée dans les textes sacrés, car il est miséricorde depuis toujours (Dt 4,31). Dans le livre des psaumes, par exemple, résonnent des voix éloquentes qui louent cette action de Dieu : “C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies” (Ps 103,3) ; “Tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés” (Ps 85,3) ; “Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes” (Ps 103,10) ; “Rendez grâce au Seigneur, car il est bon : éternel est son amour” (Ps 136,1).
c) La conversion est vécue comme un don de Dieu lui-même. Lui-même, ou par l’intermédiaire des prophètes, invite son peuple à la conversion : “Fils des hommes, jusqu’à quand aurez-vous le cœur endurci ? Pourquoi aimez-vous le néant et recherchez-vous le mensonge ?” (Ps 4,3) ; “N’endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert” (Ps 95,8) ; “Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Corrigez votre conduite et vos actes” (Jr 18,11) ; “Venez, retournons au Seigneur” (Os 6,1). En somme, le psaume 51 synthétise, de manière éloquente, la théologie de la faute, de la conversion et de la miséricorde de Dieu dans l’Ancien Testament.
2.2 Péché – miséricorde – conversion, dans le Nouveau Testament
a) Le péché, ainsi que toutes ses implications, doit être compris à la lumière du mystère du Christ. Selon l’apôtre Paul, le péché est entré dans le monde par un seul homme (Rm 5,12) et par un seul homme la mort sera vaincue (1Co 15,21). Ainsi, le péché remonte aux origines du monde et tous les êtres humains en sont impliqués : “Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous” (1Jn 1,8) ; “Que celui d’entre vous qui est sans péché jette la première pierre !” (Jn 8,7).
En général, dans les écrits néotestamentaires, le péché consiste à refuser la Parole (Mt 13,22), à nier le Verbe et la lumière (Jn 3,19), à ne pas reconnaître sa propre cécité (Jn 9,41), à rejeter le Christ (Jn 1,11), à pratiquer l’iniquité (1Jn 2,14-17). En somme, du “péché” découlent les péchés, comme le montre bien l’apôtre Paul dans l’une de ses listes : “débauchés, idolâtres, adultères, sodomites, voleurs, cupides, ivrognes, calomniateurs, escrocs (…)” (1Co 6,9-10).
b) La miséricorde caractérise le Dieu des chrétiens. Les fidèles sont les destinataires de cette miséricorde divine : “Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde” (Mt 5,7). Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. “Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sujet à la Loi, pour racheter ceux qui étaient sous la Loi, afin que nous recevions la dignité de fils” (Ga 4,4-5). L’évangéliste Luc est, sans doute, celui qui rassemble le mieux les différents comportements de Jésus manifestant la miséricorde. La parabole du père et de ses deux fils est paradigmatique : le père, pris de compassion, court à la rencontre du fils qui revient et, après l’avoir accueilli avec affection (embrassades et baisers), après avoir écouté sa “confession”, il le conduit au banquet (Lc 15,11-32). D’ailleurs, l’attitude de Jésus, qui se montre ami des pécheurs, des marginalisés, des malades, des affligés – ce qui fut cause de scandale pour les pharisiens et même pour certains de ses disciples ! – découle de sa mission première, qui est de révéler la miséricorde du Père.
En somme, la miséricorde
est la condition de notre salut ; c’est le mot qui révèle le mystère de la Très Sainte Trinité ; c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre ; c’est la loi fondamentale inscrite dans le cœur de chaque personne, lorsqu’elle regarde avec des yeux sincères le frère rencontré sur le chemin de la vie ; c’est le chemin qui unit Dieu à l’homme” (MV n.2).
c) La conversion est un moyen efficace d’obtenir la miséricorde et s’opère selon deux volets : le désir humain d’un changement radical de vie (metanoia) et l’aide divine pour sa pleine réalisation. Toutefois, il convient de souligner que l’initiative vient toujours de Dieu, comme l’exprime bien l’apôtre Paul : le Christ a été envoyé non pas lorsque nous étions prêts à nous convertir, mais alors que nous étions encore dans notre péché (cf. Rm 5,6s).
L’écoute de la Parole de Dieu et l’adhésion qui en découle nous replacent sur le chemin du suivi du Christ, car il nous pardonne le péché et fait de nous des créatures nouvelles, grâce au mystère de sa mort et de sa résurrection. En d’autres termes, il s’agit de réaliser dans nos vies la dynamique du mystère pascal du Christ.
3 L’expérience de la réconciliation dans la pratique de l’Église
Au cours de son histoire, l’Église a connu différentes modalités quant à la compréhension théologique et à la pratique liturgique de la réconciliation. Dans le cadre de ce texte, l’approche historico-théologique se fera à partir des périodes suivantes : a) siècles I-VI (réconciliation par la pénitence canonique) ; b) siècles VII-XI (réconciliation par la pénitence tarifée / privée) ; c) siècles XI-XX (réconciliation par la pénitence de confession).
3.1 Siècles I-VI : réconciliation par la pénitence canonique
Au cours des deux premiers siècles de l’ère chrétienne, peu de témoignages font référence à la pratique pénitentielle des chrétiens. À titre d’exemple, on peut citer la Didachè, la Lettre de Barnabé, la Première lettre de Clément de Rome aux Corinthiens et le Pasteur d’Hermas (cf. NOCENT, 1989, p.165-169).
a) La Didachè (Ier siècle), dans la lignée des écrits néotestamentaires, énumère certains péchés graves en lien avec les commandements (chap. 2). Elle évoque également la “confession” des péchés devant l’assemblée (chap. 4) et impose des conditions (confession des péchés) pour participer pleinement à la table du Seigneur (chap. 14). Il convient de noter que cette “confession” était peut-être une forme de reconnaissance publique des propres péchés, similaire à l’“acte pénitentiel” de nos célébrations eucharistiques.
b) La Première lettre de Clément de Rome aux Corinthiens (Ier siècle) est plus explicite : “Vous qui avez provoqué la révolte, soumettez-vous aux presbytres et acceptez la punition comme votre pénitence, en fléchissant les genoux de votre cœur” (57,1).
c) La Lettre de Barnabé (IIe siècle), en plus de dresser une liste de vices à éviter, contient des avertissements à portée eschatologique : “Le Seigneur est proche, avec son salaire” (chap. 19).
d) Le Pasteur d’Hermas (IIe siècle) aborde la question pénitentielle sous les angles de la perspective eschatologique, de la conversion et de la seule possibilité de recevoir le pardon de l’Église.
À partir du IIIe siècle, on constate plus clairement la pratique pénitentielle. On établit la “pénitence canonique” ou “publique”, accordée une seule fois dans la vie pour les péchés les plus graves. Il s’agit d’une discipline rigoureuse d’expiation, qui se terminait par la réconciliation ecclésiale à travers le ministère de l’évêque. Elle comprenait essentiellement trois étapes bien distinctes : a) la confession secrète du péché à l’évêque. Celui-ci admettait la personne au groupe des “pénitents” ; b) le temps nécessaire pour accomplir les œuvres de pénitence, c’est-à-dire : jeûnes prolongés, restrictions alimentaires, port de vêtements pénitentiels et de cilice, prière à genoux, etc. Il appartenait encore au pénitent de demander aux membres de la communauté de prier pour lui ; c) la réconciliation ou la paix. Il s’agissait du moment liturgique où l’évêque et les prêtres présents imposaient les mains sur les pénitents, leur accordant la rémission des péchés et leur réintégration dans l’assemblée ecclésiale.
Personne ne doute de la valeur pédagogique de cette ancienne pratique de la pénitence, fondée sur la conscience de son lien étroit avec le sacrement du baptême. Ce dernier est en réalité la “première pénitence”. Le sacrement de la réconciliation, pour sa part, était considéré comme un second baptême. Cependant, la rigueur extrême et le fait qu’il ne pouvait être administré qu’une seule fois dans la vie et entraînait des conséquences pour toute l’existence ont conduit les fidèles à différer autant que possible leur accès au sacrement de la réconciliation. Cela a engendré des effets secondaires tels que : l’éloignement progressif de la communion eucharistique et la transformation de la réconciliation en sacrement réservé aux personnes âgées ou mourantes.
3.2 Siècles VII-XI : réconciliation par la pénitence tarifée / privée
Le VIIe siècle est considéré comme un tournant en matière de discipline pénitentielle. Il y a rupture avec l’ancienne pratique : la réconciliation peut désormais être privée et répétée. Cette pratique, mise en œuvre par des moines irlandais et écossais, s’est étendue aux communautés paroissiales. Le fait que la majorité des évêques étaient également moines a favorisé la diffusion de cette “nouveauté”. C’est ainsi qu’ont vu le jour les célèbres “livres pénitentiels”. Ces ouvrages contiennent des tableaux et des listes de péchés ainsi que la peine correspondante (tarif) à infliger au pénitent pour chaque faute commise. La durée de ces pénitences variait selon la gravité du péché, allant de quelques jours à plusieurs années de jeûne, etc. En revanche, le principe suivant restait en vigueur : “Pour un péché grave et caché, pénitence secrète ; pour un péché grave et public, pénitence publique”.
Dans la pratique, la pénitence tarifée a soulevé des difficultés, telles que : comment gérer les cas où, lors d’une seule confession, une personne se voyait imposer de nombreuses années de pénitence ? En réponse à cela, des formes de commutations ou de rédemptions de la pénitence ont été créées. Ces commutations pouvaient se faire selon des calculs prédéfinis, par exemple : a) une pénitence de longue durée pouvait être remplacée par une plus brève mais plus rigoureuse ; b) la pénitence pouvait être échangée contre une somme d’argent, dont le montant variait selon la peine ; c) la pénitence pouvait être remplacée par la célébration de messes : on commandait un certain nombre de messes en guise de réparation ; d) la pénitence pouvait être accomplie par une autre personne : on invoquait le précepte évangélique selon lequel les uns doivent porter les charges des autres (cf. BAÑADOS, 2005, p.217).
Bien que l’accès répété au sacrement ait été un élément positif dans l’histoire de la pénitence, sur le plan pastoral, cette pratique a rencontré des limites considérables, comme la “marchandisation” des peines. Cela a renforcé le caractère individuel et magique du sacrement, en mettant l’accent sur le binôme confession-absolution, au détriment de la pénitence en tant que telle.
3.3 Siècles XI-XX : réconciliation par la pénitence de confession
Même si la pénitence publique existait encore pour les péchés publics jugés scandaleux, la confession auriculaire a progressivement pris sa place, au point de devenir la seule forme de célébration du sacrement. Un type de “confession dévotionnelle” s’est instauré, caractérisé par l’accusation des péchés (de la part du pénitent) et l’absolution immédiate (de la part du ministre ordonné). Cette “confession” est peu à peu devenue une condition préalable à la communion eucharistique, même une fois par an, comme proposé par le Concile de Latran (1215). Ainsi, la réconciliation, qui dans les premiers siècles était accordée une seule fois dans la vie – car ce sacrement était considéré comme un second baptême, ou “baptême laborieux” –, devient désormais obligatoire une fois par an. Cette pratique s’est poursuivie jusqu’au Concile de Trente (XVIe siècle).
À l’époque du Concile de Trente, le problème théologique et disciplinaire du sacrement de pénitence était complexe, non seulement à cause de la Réforme et de son attitude envers le sacrement, mais aussi en raison de la complexité de la discipline sacramentelle elle-même et de l’Église. En effet, du point de vue disciplinaire, il existait diverses divergences dans son application (NOCENT, 1989, p.204).
En se limitant à donner une réponse de nature dogmatique aux attaques des réformateurs, le Concile de Trente a traité du sacrement de pénitence en lui-même, et lorsqu’il le considère en relation avec l’eucharistie, c’est sous l’aspect de la dignité requise pour communier, et aussi pour souligner que l’eucharistie ne peut remplacer l’absolution en cas de péché grave. De la doctrine sur le sacrement de pénitence enseignée par Trente, il convient de souligner : a) l’affirmation de l’institution du sacrement par le Christ et de sa nécessité par droit divin, pour le salut de ceux qui sont tombés après le baptême ; b) l’enseignement selon lequel la confession se fait uniquement au prêtre et est secrète ; c) l’appel à la nécessité de confesser tous les péchés, y compris les véniels, au moins une fois par an.
Trente souligne la relation étroite entre l’individu et le confesseur : de la part de l’individu, on exige une attitude de profonde contrition, suivie de la déclaration de tous les péchés (confession) et de la satisfaction des peines ; au confesseur, représentant de Dieu et juge, revient le rôle d’absoudre les péchés du pénitent.
Il convient également de souligner l’enseignement de Trente sur la différence entre le sacrement de pénitence et le sacrement de baptême :
Il est évident que ce sacrement est différent du baptême à plusieurs égards. Car, outre que la matière et la forme qui constituent l’essence du sacrement sont très différentes, il est également établi que le ministre du baptême ne doit pas être un juge, car l’Église n’exerce pas de juridiction sur une personne qui n’est pas encore entrée par la porte du baptême. (…) Il n’en va pas de même pour ceux qui appartiennent à la famille de la foi, ceux que le Christ Seigneur a une fois pour toutes faits membres de son corps par le bain du baptême. En effet, si ceux-ci se salissent à nouveau par un délit, ils doivent, de leur plein gré, se purifier, non par un nouveau baptême – ce qui n’est en aucun cas licite dans l’Église catholique –, mais en se présentant comme accusés devant ce tribunal de pénitence, afin de pouvoir, par la sentence du prêtre, être libérés, non pas une seule fois, mais chaque fois qu’ils se repentent de leurs péchés et y recourent (DENZINGER-HÜNERMANN, 2007, n.1671).
Dans les siècles suivants (post-tridentins), la théologie et la pratique pastorale du sacrement de pénitence ont suivi la voie tracée par Trente et n’ont pas connu de changements substantiels, malgré de vives discussions autour de l’intensité de la “contrition”. La “satisfaction” imposée après l’absolution, outre qu’elle pousse le pénitent à accepter la peine (guérison des séquelles du péché commis), le rend plus prudent et vigilant pour l’avenir. Cette période est également marquée par des appels répétés à la “confession individuelle”, presque toujours considérée comme une condition préalable pour recevoir dignement l’eucharistie. La confession fréquente de tous les péchés (y compris les véniels) devient une obsession pour le clergé.
4 L’expérience de la réconciliation proposée dans le Rituel de la Pénitence de 1973 et ses défis pastoraux
Cette dernière section s’occupera, dans un premier temps, de l’étude du Rituel de la Pénitence de 1973, en cherchant à en souligner la théologie. Ensuite, trois pistes d’action seront présentées, en vue d’une participation consciente, active et fructueuse des fidèles à la célébration de la réconciliation.
4.1 Le Rituel de la Pénitence de 1973
Répondant à la demande explicite du Concile Vatican II selon laquelle “le rite et les formules de la Pénitence soient révisés de manière à exprimer plus clairement la nature et les effets de ce sacrement” (SC n.72), la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin publia à Rome, le 2 décembre 1973, le nouveau Rituel de la Pénitence (RP).
Ce rituel est composé d’une “Introduction générale”, d’un “Rite pour la réconciliation individuelle des pénitents”, d’un “Rite pour la réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution individuelles”, d’un “Rite pour la réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution générales”, d’un large “Lectionnaire” et de trois “Annexes”, à savoir : a) absolution des censures et dispense d’irrégularité ; b) exemples de célébrations pénitentielles : Carême, Avent, Célébrations ordinaires pour les enfants, les jeunes, les malades ; c) schéma pour l’examen de conscience.
4.1.1 Points saillants théologico-liturgiques
L’“Introduction générale” du RP, en harmonie avec la Sacrosanctum Concilium, commence par l’approche du ministère de la réconciliation dans le cadre de l’histoire du salut : le Père a toujours manifesté sa miséricorde et réconcilié le monde avec lui. Ce dessein divin a atteint son sommet dans le mystère pascal du Christ. Depuis lors, l’Église n’a cessé d’appeler les hommes et les femmes à la conversion, par la célébration du sacrement de la réconciliation. À ce sacrement est associé le baptême, “par lequel le vieil homme est crucifié avec le Christ afin que, détruit le corps du péché, nous ne soyons plus esclaves du péché, mais, ressuscités avec le Christ, vivions pour Dieu”, ainsi que l’eucharistie, qui édifie l’Église et fait de ses membres “un seul corps et un seul esprit” (RP n.1-2).
La deuxième section traite de la réconciliation des pénitents dans la vie de l’Église : le Christ a aimé l’Église et s’est livré pour elle afin de la sanctifier, l’unissant à lui comme son épouse. Celle-ci, cependant, ne lui est pas toujours fidèle et, pour cette raison même, a besoin d’une purification et d’un renouvellement continus. Dans le sacrement de la réconciliation, “les fidèles obtiennent de la miséricorde divine le pardon de l’offense faite à Dieu et, en même temps, sont réconciliés avec l’Église, qu’ils ont blessée par le péché et qui collabore à leur conversion par la charité, l’exemple et la prière” (LG n.11).
Cette section présente également les parties constitutives du sacrement de la réconciliation, à savoir :
a) La contrition. De la contrition intérieure dépend l’authenticité de la pénitence. La conversion doit atteindre profondément l’être humain, pour l’éclairer chaque jour davantage et le configurer toujours plus au Christ.
b) La confession exige du pénitent la volonté d’ouvrir son cœur au ministre de Dieu ; et de la part de celui-ci, un jugement spirituel par lequel, agissant au nom du Christ, il prononce, en vertu du pouvoir des clefs, la sentence de rémission ou de rétention des péchés.
c) La satisfaction des fautes est l’expression concrète de la véritable conversion, c’est-à-dire de la réparation du tort causé. Il est donc nécessaire que la satisfaction imposée soit réellement un remède contre le péché et, d’une certaine manière, un renouvellement de vie. Ainsi, le pénitent, oubliant ce qui est derrière (Ph 3,13), se réintègre dans le mystère du salut en se tournant vers l’avenir.
d) L’absolution. Par la confession sacramentelle, Dieu accorde le pardon par le signe de l’absolution, et ainsi se réalise le sacrement de la réconciliation. Par ce sacrement, le Père accueille son fils qui revient ; le Christ place la brebis perdue sur ses épaules et la ramène au bercail ; et l’Esprit Saint sanctifie à nouveau son temple ou vient l’habiter plus pleinement. Cela se manifeste pleinement dans la participation fréquente ou plus fervente à la table du Seigneur, avec une grande joie dans l’Église de Dieu pour le retour de l’enfant éloigné (cf. RP n.6).
Il convient d’observer que la satisfaction apparaît avant l’absolution, c’est-à-dire que l’ordre idéal de la structure du sacrement a été rétabli.
Quant à la réitération du sacrement, entre autres recommandations, le RP clarifie que
il ne s’agit pas d’une simple répétition rituelle, ni d’une sorte d’exercice psychologique, mais d’un effort assidu pour parfaire la grâce du baptême, afin que, portant dans notre corps la mortification du Christ, la vie de Jésus se manifeste de plus en plus en nous. (…) La célébration de ce sacrement est toujours une action par laquelle l’Église proclame sa foi, rend grâce à Dieu pour la liberté avec laquelle le Christ nous a libérés, et offre sa vie comme un sacrifice spirituel à la louange de la gloire de Dieu, tout en se hâtant à la rencontre du Christ (RP n.7).
La troisième section traite des fonctions et des ministères dans la réconciliation des pénitents. En plus de souligner le rôle de toute la communauté dans la célébration de la réconciliation, elle rappelle que l’Église est impliquée et agit dans la réconciliation ; elle met en évidence la responsabilité de l’évêque et des prêtres (qui agissent en communion avec l’évêque) dans la rémission des péchés ; elle rappelle que « le fidèle, tout en expérimentant et en proclamant dans sa vie la miséricorde de Dieu, célèbre avec le ministre ordonné la liturgie d’une Église qui se renouvelle continuellement » (RP n.8-11).
La quatrième section, quant à elle, décrit les trois modalités de célébration du sacrement de la réconciliation, en cherchant à montrer leur importance dans la vie des fidèles ; elle souligne la théologie de la formule de l’absolution, en ces termes :
La formule de l’absolution montre que la réconciliation du pénitent procède de la miséricorde du Père ; elle indique le lien entre la réconciliation du pécheur et le mystère pascal ; elle exalte l’action de l’Esprit Saint dans le pardon des péchés, et enfin elle met en évidence l’aspect ecclésial du sacrement, puisque la reconciliation avec Dieu est demandée et accordée par le ministère de l’Église (RP n.19).
La cinquième section parle des « Célébrations pénitentielles ». Quant à leur nature et à leur structure, ces célébrations sont
des réunions du peuple de Dieu pour écouter sa Parole, qui invite à la conversion et au renouvellement de la vie, en proclamant aussi notre libération du péché par la mort et la résurrection du Christ. Leur structure est la même que celle des célébrations de la Parole, proposée dans le « Rite pour la réconciliation de plusieurs pénitents ». (RP n.36)
Quant à leur utilité et leur importance, les « Célébrations pénitentielles » favorisent l’esprit de pénitence de la communauté chrétienne ; elles aident les fidèles à préparer la confession que chacun pourra faire en temps opportun ; elles éduquent les enfants à acquérir progressivement la conscience du péché dans la vie humaine et de la libération du péché par le Christ ; elles aident les catéchumènes dans leur conversion. De plus, là où aucun ministre ordonné n’est disponible pour accorder l’absolution sacramentelle, les célébrations pénitentielles sont très utiles pour éveiller chez les fidèles une contrition parfaite, née de la charité, par laquelle, avec le désir de recevoir plus tard le sacrement de la réconciliation, ils peuvent obtenir la grâce de Dieu (cf. RP n.37).
La dernière section de l’« Introduction générale » du RP traite des « Adaptations du Rite aux diverses régions et circonstances ». De telles adaptations pourront être faites par les conférences épiscopales (RP n.38), par l’évêque diocésain (RP n.39) et par le ministre (RP n.40).
4.1.2 Avancées et limites
Pour porter un jugement sur le RP de 1973, il est nécessaire de tenir compte du fait que ce rituel est le fruit d’un travail laborieux articulé par le Consilium. A. Bugnini, dans son œuvre anthologique La réforme liturgique, s’exprime ainsi : « La révision des rites de la Pénitence a suivi un chemin assez long et difficile. Il a fallu sept ans pour mettre en pratique les quelques lignes que la Constitution liturgique consacre à ce sujet » (2018, p.551).
De grandes questions ont été discutées, certaines d’entre elles de manière « animée », dès la première étape des travaux (1966-1969), comme l’aspect social et communautaire du péché et de la réconciliation, la question d’une possible célébration communautaire de la réconciliation avec absolution générale sans confession individuelle préalable, une nouvelle formule sacramentelle d’absolution et la possibilité de formules sacramentelles facultatives, etc.
C’est à partir de ce contexte que le nouveau RP a été élaboré. Les trois modalités de célébration de la réconciliation, proposées dans ce rituel, en sont un bon exemple. Le célèbre liturgiste A. Nocent, dans une analyse critique du RP, reconnaît comme positives ces modalités, sous trois aspects : a) la tentative de rétablir l’unité entre la Parole et le sacrement ; b) l’intervention, au moins partielle, de la communauté ecclésiale ; c) la présentation d’un formulaire d’absolution dogmatiquement plus riche, et qui corrige l’aspect juridique. D’autre part, il déplore qu’aucune des trois modalités ne soit réellement satisfaisante et adaptée aux circonstances actuelles, en ces termes :
Le premier rituel, celui qui concerne le pénitent qui rencontre le confesseur, ne se réalise pas facilement : il suppose un contact humain et spirituel pour le dialogue, il unit au sacrement une brève liturgie de la Parole, mais il lui manque la visibilité de la communauté et surtout il peut difficilement se réaliser dans une paroisse ou un groupe de personnes qui se présentent ensemble ; et cela rend impossible la pratique prévue par le rituel.
Le deuxième rituel accentue la préparation communautaire à la confession, chose qui n’a aucune base dans la tradition, mais qui constitue de fait un enrichissement. Mais au moment où le rituel sacramentel devrait accentuer l’aspect communautaire du sacrement, l’absolution, sans la permission de l’Ordinaire, reste individuelle. Seule la préparation au sacrement est communautaire, tandis que le sacrement lui-même reste visiblement individuel.
Le troisième rituel, l’absolution sans confession préalable, ne trouve aucun appui dans la tradition, du fait que l’antiquité considérait l’absolution comme le couronnement de la conversion. Ici, au contraire, l’absolution est placée sur un plan juridique, sans aucun contrôle sur la manière dont le pénitent entend se convertir. Cependant, il faut bien le reconnaître, nous vivons dans des situations nouvelles, que l’Église ancienne n’a pas connues (NOCENT, 1989, p. 215-216).
4.2 Célébrer la réconciliation aujourd’hui : pistes d’action
Célébrer la réconciliation dans les communautés, aujourd’hui, reste un grand défi. Malgré cela, nous osons proposer trois exigences que nous jugeons fondamentales pour l’amélioration de la pastorale de la réconciliation. Les voici :
a) Promouvoir une formation théologico-liturgique sur le sacrement de la réconciliation pour le clergé et le peuple en général. Puisque ce sacrement est « une rencontre joyeuse de l’être humain avec Dieu, par la médiation de l’Église », une telle formation pourra être réalisée, à partir du triptyque :
– Dieu : celui qui promeut et rend possible la pleine réconciliation ;
– L’Église : celle qui collabore et rend visible la rencontre de réconciliation ;
– Le pénitent : la personne qui accepte et participe activement à la réconciliation (BOROBIO, 2009, p.324).
b) Promouvoir les célébrations pénitentielles. Ces célébrations, prévues dans le RP, manquent encore d’une attention spéciale de la part des curés et des responsables des communautés ecclésiales. La liturgiste I. Buyst nous donne de bonnes raisons pour l’accroissement de telles célébrations (cf. BUYST, 2008, p.54-66) :
– Les célébrations pénitentielles pourront faciliter le passage d’une conception individualiste, légaliste, formaliste, à une mentalité plus biblique et communautaire-ecclésiale de la réconciliation. N’ayant pas à se soucier de la confession et de l’absolution, les personnes sont plus disposées à se concentrer sur la Parole de Dieu et à se laisser transformer par elle. Et de plus : le fait que la présidence de ces célébrations ne soit pas restreinte au ministre ordonné rend plus évidente la responsabilité de la communauté et de chaque personne comme ministre de la pénitence.
– La communauté pourra privilégier des moments propices pour les célébrations pénitentielles, tels que : les temps du Carême et de l’Avent, les fêtes des saints patrons, lors des pèlerinages, à des moments ponctuels du cheminement ecclésial, surtout dans des situations de désaccords, de malentendus, de querelles, etc.
– Les célébrations pénitentielles pourront aider les communautés à comprendre que la réconciliation est un itinéraire spirituel qui dure toute la vie et que son objectif primordial est l’« homme nouveau ».
– Étant donné que les célébrations pénitentielles sont des « réunions du peuple de Dieu pour écouter sa Parole, qui l’invite à la conversion et au renouvellement de la vie, en proclamant aussi notre libération du péché par la mort du Christ » (RP n.36), leur accroissement dans la vie de la communauté permettra aux fidèles de faire l’expérience de l’efficacité de la Parole proclamée qui, par l’action de l’Esprit, fait advenir la conversion et le renouvellement de la vie.
c) Être attentif à l’horizon ouvert de possibles « adaptations ». Comme nous l’avons vu précédemment, l’« Introduction générale » du RP propose des adaptations du rite aux diverses régions et circonstances, couvrant les niveaux de la conférence épiscopale, de l’évêque diocésain et du ministre (RP n.38-40).
Pour les deux premiers niveaux (de la conférence épiscopale et de l’évêque diocésain), à l’exception de l’exigence explicite de conserver la formule sacramentelle dans son intégralité, tout le reste du rituel pourra être adapté, y compris avec la composition de nouveaux textes.
Au niveau du ministre, principalement les curés, la possibilité reste ouverte d’adapter le rite aux circonstances concrètes des pénitents, à condition de conserver sa structure essentielle et l’intégralité de la formule d’absolution. Il est également recommandé d’utiliser fréquemment les célébrations pénitentielles tout au long de l’année.
Par conséquent, dans le RP, il existe un vaste champ de possibilités d’adaptations du rite. Cela permettra à la communauté de foi de célébrer de manière plus consciente, active et fructueuse la réconciliation.
Nous concluons ce texte par une observation sur le titre du rituel. A. Bugnini le justifie ainsi :
Le titre général du volume est Ordo Paenitentiae, car il contient des indications pour les rites tant sacramentels que non sacramentels.
Pour l’action liturgique sacramentelle, on préfère, dans les chapitres individuels de l’Ordo, le terme Reconciliatio. Il indique mieux que la pénitence sacramentelle est, à la fois, action de Dieu et de l’homme, tandis que « Pénitence » met davantage l’accent sur l’action de l’homme. (…) Reconciliatio est plus proprement utilisé par l’Église ancienne pour l’acte sacramentel. (…) Cette terminologie sert également à attirer l’attention et à approfondir un aspect fondamental pour la compréhension et le renouveau de la pénitence sacramentelle (2018, p.560-561).
En somme, la réconciliation est une action de Dieu, une initiative de Dieu, comme l’exprime bien l’Apôtre :
Tout vient de Dieu, qui, par le Christ, nous a réconciliés avec lui et nous a confié le ministère de la réconciliation. Oui, c’est Dieu lui-même qui, dans le Christ, a réconcilié le monde avec lui, ne tenant pas compte des fautes de l’humanité, et c’est lui qui a mis en nous la parole de la réconciliation (2Co 5,18-19).
Joaquim Fonseca, OFM – Institut Saint Thomas d’Aquin. (texte original en portugais)
Références
BAÑADOS, C. P. Penitência e reconciliação. In: CELAM. A celebração do mistério pascal; os sacramentos: sinais do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2005. Manual de liturgia, v. III, p.205-238.
BOROBIO, D. Celebrar para viver; liturgia e sacramentos da Igreja. São Paulo: Loyola, 2009.
BUGNINI, A. A reforma litúrgica (1948-1975). São Paulo: Paulus; Paulinas; Loyola, 2018.
BUYST, I. As celebrações penitenciais. In: CNBB. Deixai-vos reconciliar. São Paulo: Paulus, 2008, p. 49-66. Estudos da CNBB, n.96.
DENZINGER – HÜNERMANN. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. São Paulo: Paulinas / Loyola, 2007.
FRANCISCO. Veritatis Gaudium. Sobre as universidades e as faculdades eclesiásticas. Disponible sur : http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html. Consulté le : 12 sept. 2019.
______. Misericordiae Vultus. O rosto da misericórdia. Bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia. São Paulo: Paulus, 2015.
NOCENT, A. O sacramento da penitência e da reconciliação. In: NOCENT, A. et al. Os sacramentos; teologia e história da celebração. São Paulo: Paulinas, 1989, p.143-221. Anamnesis, 4.
VISENTIN, P. Penitência. In: VV.AA. Dicionário de liturgia. São Paulo: Paulus, 1992. p. 920-937.