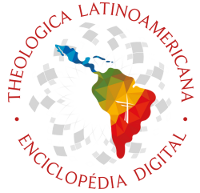Sommaire
1 Le temps dans l’expérience humaine
1.1 La dimension objective et la dimension subjective du temps
1.2 L’« humanisation » du temps
2 Le temps dans l’expérience chrétienne
2.1 Le temps dans la Sainte Écriture
2.2 Le culte comme mémorial
2.3 La compréhension liturgique du temps
2.3.1 L’objet de la célébration chrétienne
2.3.2 Dans l’histoire, vers la plénitude du Royaume
2.3.3 Cercle, ligne, spirale
2.3.4 Année, mois, jour et heure
3 L’année liturgique chrétienne
4 La réforme de Vatican II
4.1 La structure actuelle de l’année liturgique
4.1.1 Le cycle ou temps de Noël
4.1.2 Le cycle ou temps pascal
4.1.3 Le temps ordinaire
4.1.4 Autres fêtes de l’année liturgique
4.2 Le temps liturgique comme mystagogie de l’Église
1 Le temps dans l’expérience humaine
Le temps est, avant tout, une expérience fondamentale et déterminante de l’être humain. Avec l’espace, ce sont les deux coordonnées fondatrices de son expérience : nous sommes et nous nous déplaçons dans un lieu et dans un devenir. Tout être humain est conçu, naît et vit, jusqu’à sa mort, immergé dans ces deux dimensions. Depuis l’espace protégé, chaud et nutritif de l’utérus maternel, radicalement abandonné à la naissance pour entrer dans le grand espace du monde, bien moins aimable que le sein de la mère, l’être humain transite, habite et domestique l’espace naturel ou celui qu’il construit lui-même pour vivre.
Il en va de même pour le temps, que l’homme expérimente comme une évolution continue (un devenir continu), sans retour en arrière, perceptible dans le changement, le renouvellement et le vieillissement des choses et des personnes, impossible à arrêter. « Change, tout change », dit une chanson populaire latino-américaine bien connue, qui exprime non seulement l’expérience de l’inévitable changement, mais aussi celle de la persistance de la mémoire et des valeurs humaines.
Le temps est l’expérience que tout peut être mesuré en termes de durée. Il donne à l’être pensant un passé, un présent et un futur, qui est à la fois individuel et social. Le temps et l’espace déterminent l’homme en tant qu’individu et en tant qu’être social, rendant possible et limitant en même temps son existence, qui est radicalement spatio-temporelle. L’homme ne peut échapper à la réalité d’être situé dans ces deux dimensions, et peut les expérimenter comme des zones de liberté ou, aussi, de limitation.
L’expérience du temps réside dans l’esprit et les émotions, plus que dans les sentiments. Il est plus difficile à saisir, à définir, à mesurer et à contrôler que l’espace. C’est une expérience qui éveille un sentiment de fragilité, d’impuissance, de dépendance à des forces incontrôlables. C’est pourquoi l’être humain a toujours cherché à le contrôler, à le maîtriser et à le surmonter, se heurtant à l’impossibilité objective de le faire, car il est comme un fleuve impétueux qui ne peut être arrêté. Cette expérience mène au sentiment religieux. La religion a la capacité d’incliner en faveur de l’homme un devenir qui effraie, en lui donnant un sens ; ou de construire, à travers sa ritualité, l’illusion de le contrôler et de le maîtriser.
La première et la plus répandue des actions de contrôle du temps par l’homme est sa mesure et, pour cela, il a l’aide de la nature elle-même.
1.1 La dimension objective et la dimension subjective du temps
Il existe des rythmes qui aident l’être humain à mesurer le temps. Parmi ceux qui appartiennent à la nature humaine elle-même, il y a les rythmes biologiques : les battements du cœur et la respiration sont des caractéristiques de sa corporéité. Parmi ceux que l’homme observe dans la nature, il y a les rythmes cosmiques, comme le trajet quotidien du soleil d’est en ouest, la succession du jour et de la nuit, les mois déterminés par les phases de la lune et le mouvement des étoiles qui, lié aux saisons de la nature, détermine la durée d’une année.
Basé sur ces rythmes naturels, l’homme a créé des rythmes sociaux tels que l’heure, la semaine et le mois, qui, dans leur durée objective, ont beaucoup varié d’une époque à l’autre et d’une culture à l’autre. L’être humain n’a pas seulement besoin de mesurer le temps. Il est également capable de générer un horizon temporel et de distinguer, dans sa conscience, entre le moment présent, le passé et l’avenir. Cet horizon dépend de l’âge et du développement intellectuel et est déterminé par la situation sociale de chaque personne. De même, l’horizon temporel d’un groupe humain dépend, entre autres facteurs, de son développement économique, social et culturel.
Il faut donc distinguer entre le temps subjectivement vécu et le temps objectivement mesuré. Dans les deux cas, il s’agit du temps pour l’être humain, puisque sa perception et sa mesure sont intimement liées à la conscience et à l’intelligence de l’homme.
Le temps mesuré objectivement peut être déterminé à la fois par les rythmes biologiques et cosmiques, et par les systèmes de mesure conçus par l’être humain. Le temps subjectivement vécu, cependant, est déterminé par les événements qui marquent la vie humaine personnelle ou sociale. Toute période de la vie d’une personne est vécue comme « courte » ou « longue », selon qu’elle est amusante ou ennuyeuse, importante ou banale, heureuse ou douloureuse. Qui n’a jamais ressenti comme interminables les dix minutes d’attente dans une file à la banque, et comme extrêmement courtes ces mêmes dix minutes partagées avec la personne aimée ? Par conséquent, ce n’est pas le temps en soi, mais ce qui s’y passe, qui détermine l’expérience temporelle.
1.2 L’« humanisation » du temps
L’être humain tente de maîtriser le flux imparable du temps par sa mesure et son organisation. Cependant, toutes les formes de mesure du temps sont basées sur une conception préalable de celui-ci ; ces conceptions sont essentiellement au nombre de deux : la cyclique et la linéaire.
La conception cyclique, exprimée graphiquement par le cercle, est typique des cultures les plus archaïques, puisque son origine se trouve dans les rythmes de la nature. Cela explique pourquoi les catégories de l’année, du mois et du jour existent dans le monde entier : elles sont facilement saisissables dans l’expérience quotidienne.
La forme linéaire perçoit le temps comme un devenir permanent, sans possibilité de retour en arrière, représenté graphiquement par une ligne qui avance toujours. Sa mesure consiste à segmenter cette ligne en périodes. En elle, l’objectif, le « jusqu’où » la ligne va, ou où elle se termine, acquiert une importance fondamentale. La tradition judéo-chrétienne adhère fondamentalement à cette conception du temps.
L’alternance du jour et de la nuit est le modèle le plus immédiat pour mesurer le temps. Mais la durée de la lumière et de l’obscurité qui y sont liées varie beaucoup d’une région à l’autre et d’une saison à l’autre. Ainsi, l’ingéniosité humaine a inventé des instruments qui mesurent les heures du jour, indépendamment du facteur clair-obscur : les cadrans solaires, les horloges à eau et, finalement, seulement au XIVe siècle, l’horloge mécanique. Celle-ci s’est massifiée au XIXe siècle avec la production en série de montres de poche et de montres-bracelets. Au début du XXe siècle, le système temporel a été universalisé en établissant l’heure de Greenwich (GMT – Greenwich Mean Time) comme standard de temps, ce qui a favorisé l’organisation du temps pour un monde de plus en plus globalisé dans les domaines de la production, du transport et de la mobilité humaine.
Le mois, d’autre part, est une unité complexe. Bien qu’il ait un appui naturel évident dans les phases de la lune, il est vécu comme faisant partie d’un segment plus grand, qui est l’année. Cependant, la durée du cycle solaire, que nous appelons année, ne coïncide pas avec la division en mois basée sur le cycle lunaire. Cela a conduit à différentes solutions : le calendrier islamique a adopté le cycle lunaire, divisant l’année en douze mois lunaires, de sorte que son année est dix jours plus courte que l’année solaire ; ou comme l’a fait le calendrier julien, qui a pris le cycle solaire comme base et a standardisé les douze cycles lunaires pour qu’ils s’y conforment.
La semaine est différente du jour, du mois et de l’année, car elle n’est pas liée à des cycles naturels, sauf dans les cultures où s’est imposée la semaine de sept jours, qui représente presque un quart de la durée du cycle lunaire, qui est de 29,5 jours.
La semaine est d’origine culturelle. Par conséquent, dans les temps anciens, elle était différente selon les sociétés. En Mésopotamie et en Israël, la semaine comptait sept jours. Les anciens Romains avaient une semaine de huit jours, les Chinois une de dix, et dans plusieurs cultures d’Afrique de l’Ouest, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique centrale, il y avait des semaines d’environ trois et six jours. Ce qui leur était commun à toutes, c’était le schéma toujours récurrent de certains jours, probablement pour réguler certaines activités répétitives, comme les jours de marché. De nombreuses sociétés connaissaient, dans le système hebdomadaire, un jour de soulagement spécial, généralement fondé sur la religion : le shabbat du judaïsme, le dimanche du christianisme et le vendredi de l’islam.
2 Le temps dans l’expérience chrétienne
L’expérience humaine du temps et son organisation sociale sont intimement liées à la conscience religieuse de l’homme. Dans toutes les religions, le temps joue un rôle important, mais la conception du temps et le comportement religieux et cultuel à son égard, qui découlent de cette compréhension, sont très variés. La conception biblique et liturgique chrétienne n’est que l’une d’entre elles.
2.1 Le temps dans la Sainte Écriture
L’expérience biblique du temps est à la base de la signification que la liturgie chrétienne lui attribue. Le Dieu chrétien est le Dieu-homme, le Dieu-avec-nous, le Dieu qui s’incarne et assume non seulement la beauté de sa création et de ses créatures, mais aussi leurs limites et leurs conditionnements. C’est le Dieu qui s’est fait chair, fragile, limitée et corruptible, situé dans les coordonnées fondamentales du temps et de l’espace. Cela détermine radicalement la liturgie, tout comme le mystère pascal du Christ, qui représente le dépassement de tout conditionnement, y compris celui du temps : le Ressuscité introduit l’humanité dans la nouvelle éternité, dans un temps nouveau, qui attend sa seconde venue, la définitive.
Dans la Bible prédomine une idée du temps qui le considère comme le cadre de l’action de Dieu et de la révélation du dessein divin dans l’histoire. C’est fondamentalement une conception linéaire du temps, à l’exception du livre de Qohélet, qui introduit une conception cyclique et fataliste, caractéristique du monde hellénique, dont la culture a dominé la Palestine à partir des conquêtes d’Alexandre le Grand au IVe siècle av. J.-C.
Avant tout, le temps dans la Bible est l’histoire du salut. Le temps est l’histoire dans laquelle Dieu révèle son projet salvifique, manifeste sa volonté en appelant des personnes concrètes, convoque et rassemble un peuple qui lui appartient, le libérant en permanence de l’esclavage et du péché, le conduisant jusqu’à l’accomplissement de ses promesses.
Cette promesse s’accomplit pleinement en Jésus-Christ, l’irruption de Dieu dans l’histoire humaine, dans l’incarnation et dans sa vie historique. Cette irruption, le jour favorable du salut, ne se termine pas avec la vie humaine de Jésus de Nazareth, mais inaugure l’éternité définitive, le temps de la plénitude qui n’attend que sa consommation à la parousie, la venue définitive du Christ glorieux. Le concept de « royaume » de Dieu, inauguré par Jésus-Christ, est un concept temporel et non précisément géographique. Il équivaut au « règne » de Dieu, c’est-à-dire à l’instauration de sa souveraineté. Jésus a affirmé que ce règne était déjà au milieu de son peuple en raison de ses interventions salvatrices (Lc 11,20). Sa propre irruption dans l’histoire était déjà le début du règne, et la résurrection des morts a ouvert la porte du temps définitif, traçant ainsi la ligne vers la consommation de sa venue eschatologique.
2.2 Le culte comme mémorial
Dans cette idée du temps, le culte acquiert une signification particulière. Les grandes fêtes annuelles de l’Ancien Testament, qui à l’origine étaient des fêtes de la nature, cycliques, ont été historicisées. Leur contenu original a été remplacé par des actions salvifiques de Dieu dans l’histoire. Les festivités se sont transformées en fêtes mémorielles, qui rappelaient des faits salvifiques du passé. À travers des paroles et des actions rituelles, ces événements actualisaient (rendaient présent) le salut de Dieu et, en même temps, promettaient le salut définitif pour l’avenir.
Le rituel est devenu un signe mémoriel de ce qui s’était passé à un moment donné, une expression de fidélité aux préceptes divins et un signe d’espoir dans l’accomplissement futur de la promesse de Dieu. C’est sa fidélité qui actualise dans le présent le salut déjà accompli et le promet pour l’avenir.
Cette compréhension du temps et de l’action cultuelle au fil de celui-ci se retrouve tant dans la liturgie de la synagogue que dans la liturgie de notre Église chrétienne.
2.3 La compréhension liturgique du temps
Le temps est l’œuvre de Dieu et Lui appartient, comme tout ce qu’Il a créé. Dieu existe de toute éternité et pour toujours, c’est-à-dire en dehors du temps et non soumis à sa domination. Le « temps » de Dieu est appelé éternité. Il est l’auteur, le créateur et le seigneur du temps.
Dans le temps, la vie humaine se déploie, prenant conscience du devenir, en faisant une histoire. Le christianisme est une religion historique. Sa liturgie est également historique, dans un double sens : elle célèbre l’histoire et est célébrée dans l’histoire.
2.3.1 L’objet de la célébration chrétienne
Qu’est-ce que notre liturgie célèbre précisément de l’histoire ? Le point central de la liturgie chrétienne est le mystère pascal du Christ, c’est-à-dire les événements historiques de sa mort et de sa résurrection. Ils constituent le sommet et l’articulation du temps chrétien. Dans la liturgie, on célèbre un Dieu qui, selon la révélation, n’est pas seulement le créateur de tout ce qui existe, mais qui se manifeste aussi en libérant et en sauvant l’homme dans l’histoire, parce qu’il s’est lui-même fait histoire du salut.
Les interventions libératrices de Dieu dans l’histoire du salut, passée, présente et future, se concentrent sur l’événement du Christ, sur son mystère pascal. Et c’est précisément ce mystère pascal que l’Église célèbre toujours dans toutes les liturgies. Comme le mystère pascal est la synthèse de l’histoire du salut, la liturgie est son « moment » privilégié, son actualisation. Elle célèbre cette histoire dans la mesure où elle est remplie par les interventions libératrices de Dieu, avant et après l’incarnation. Elle ne célèbre pas seulement la mort et la résurrection du Christ, mais toute sa vie, terrestre, préexistante et glorieuse, son message et ses propres actes salvifiques.
2.3.2 Dans l’histoire, vers la plénitude du Royaume
La liturgie est célébrée dans l’histoire. Ce n’est pas une action intemporelle, elle ne prétend pas « surmonter » le temps. Elle n’est pas célébrée en tournant le dos à l’histoire, mais immergée dans l’histoire réelle, car elle actualise les irruptions salvifiques passées de Dieu dans l’histoire présente, qui est, elle aussi, la continuation de l’histoire du salut.
La liturgie chrétienne ne prétend donc ni surmonter ni dominer le temps, mais au contraire, en lui, qui est le théâtre de l’histoire du salut, elle fait « renaître » l’histoire réelle des êtres humains, en la submergeant dans le mystère du Christ pour que les croyants célèbrent les interventions libératrices de Dieu comme un jour permanent de salut : l’aujourd’hui du mystère pascal qui se rend présent dans la vie concrète de l’Église.
2.3.3 Cercle, ligne, spirale
Dans la liturgie, se rassemblent les trois temps qui distinguent notre conscience : le passé, avec toute sa richesse d’interventions de Dieu ; le présent, avec les circonstances concrètes et déterminantes de l’assemblée qui célèbre ; et le futur, comme but eschatologique qui mobilise l’espérance et l’engagement des chrétiens : « Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection. Viens, Seigneur Jésus ! », disons-nous dans l’acclamation, après le récit de l’institution de l’eucharistie. La liturgie est célébrée dans la tension d’une ligne qui avance vers la rencontre définitive avec le Seigneur de l’histoire.
Dans le temps liturgique chrétien, il y a une synthèse des deux grands systèmes d’organisation temporelle, le cyclique et le linéaire. Il est organisé autour des cycles naturels du jour, du mois et de l’année et, surtout, comme l’a souligné le Concile Vatican II, autour du cycle culturel-religieux de la semaine de sept jours, avec le dimanche comme jour principal. Le monde occidental, influencé par le christianisme, a déterminé le début de son calendrier, l’an zéro, en fonction de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd’hui, grâce à des études qui ont corrigé les calculs du passé, nous savons que la naissance de Jésus a eu lieu, en fait, entre les années 4 et 7 avant l’an 0.
Selon la conception cyclique, la liturgie chrétienne est rythmée par les heures du jour, dans la séquence hebdomadaire marquée par le dimanche, et par l’année, qui reçoit plusieurs noms : « année liturgique », « année ecclésiale », « année du Seigneur ». Pour répartir la richesse de la Bible dans les lectures des diverses célébrations, le temps liturgique est organisé, depuis la réforme du Concile Vatican II, en un cycle de trois ans : A, B et C. La liturgie des heures organise les textes bibliques de l’office des lectures en un cycle de deux ans, An Pair et An Impair. L’Église universelle a établi une année jubilaire tous les 50 ans. Tous ces schémas se répètent de manière circulaire, une unité après l’autre, sans changement. Ils représentent la continuité de la conception cyclique dans le temps liturgique.
En même temps, la tension sous-jacente du temps liturgique est clairement constituée par une compréhension linéaire : l’Église, peuple de Dieu né de la Pâque du Christ, pérégrine vers la « fin des temps », vers la plénitude du Royaume de Dieu qui sera définitivement installé lors de la seconde venue du Christ : la parousie.
De la synthèse du cercle et de la ligne, émerge l’image la plus appropriée du temps de l’Église, qui est le temps liturgique : la spirale ascendante. Elle contient à la fois le mouvement circulaire, des cycles qui se répètent sans changement, et le mouvement linéaire de l’histoire qui avance sans jamais revenir en arrière. Chaque tour de la spirale à la fois répète et renouvelle, revient sur elle-même et avance vers ce qui n’a jamais été parcouru auparavant. Ce qui se répète dans l’année liturgique, en fait, ne se répète jamais comme dans le cycle précédent, mais toujours à un niveau supérieur, dans un contexte nouveau et différent, parce que le monde et l’humanité, les chrétiens et ceux qui célèbrent ne sont pas les mêmes qu’un an auparavant, ni même qu’un mois, une semaine ou un jour avant. Bien que tout dans la liturgie se répète, tout est aussi toujours nouveau, parce que le monde et l’humanité « changent, tout change ».
2.3.4 Année, mois, jour et heure
Comme dans la société civile, l’unité principale du temps liturgique est l’« année », bien qu’il s’agisse d’une « année » particulière, dont le début et la fin ne coïncident pas temporellement avec l’année civile. Sa valeur est théologique, et non organisationnelle. Elle n’est pas définie comme une simple grandeur temporelle, mais comme le symbole d’une réalité surnaturelle. Pour le christianisme, c’est l’analogie d’une réalité spirituelle bien plus profonde que les données cosmologiques d’un tour de la Terre autour du soleil. Elle a de profondes racines bibliques, cristallisées dans les expressions « année de grâce de Yahvé » (Is 61,2), « année de grâce du Seigneur » (Lc 4,19), « plénitude des temps » (Ga 4,4 ; Ep 1,10), « Royaume des Cieux » (Mt 3,2).
Le fondement chrétien de l’année est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L’année de grâce du Seigneur est le temps de la présence du Christ qui dure pour toujours. L’année liturgique est le symbole de l’éternité définitive inaugurée par Jésus-Christ avec sa résurrection et, pour cette raison, elle devient un symbole de la vie pleine du ressuscité.
La liturgie, en célébrant le mystère pascal du Christ au long des années, mois, semaines, jours et heures, pascalise le temps, le plaçant explicitement dans la ligne de l’histoire du salut. En d’autres termes, elle le sanctifie.
Au cours de la journée, l’Église célèbre l’eucharistie et la liturgie des heures. Avec la liturgie des heures, l’Église sanctifie les moments du début et de la fin de la journée – le lever du soleil et son coucher – avec les prières des Laudes et des Vêpres, qu’elle considère comme « le double axe sur lequel tourne l’Office quotidien » – et les heures principales, ainsi que le milieu du jour ou le temps intermédiaire, avec les heures mineures de Tierce, Sexte et None. Elle y ajoute l’office des lectures et une prière brève – les Complies – avant le repos nocturne.
La semaine est marquée principalement par le dimanche, qui est la première fête des chrétiens, comme l’a souligné Vatican II. Le rythme hebdomadaire représente de la manière la plus évidente la sanctification du temps liturgique. La Pâque hebdomadaire est la séquence fondamentale du temps liturgique chrétien.
L’année est clairement organisée dans le calendrier romain, qui a été entièrement réformé par le Concile Vatican II. Le concept biblique et liturgique d’« année sainte » a été incorporé dans l’Église par la coutume d’instituer régulièrement, tous les 25 ans, et aussi à l’occasion d’un événement extraordinaire, une année festive portant ce nom.
3 L’année liturgique chrétienne
Le temps liturgique chrétien a pris une forme concrète, en tant que partie de la liturgie et en tant qu’organisation concrète des diverses célébrations, comme une « année liturgique ». Celle-ci ne s’est pas créée ou développée à partir de la théorie, mais s’est formée à partir de la pratique de célébrer et d’approfondir les vérités théologiques des chrétiens de divers lieux. Elle a établi, dès le début, des usages distincts et des différences, qui ont été en partie unifiés par la suite pour affirmer la communion de l’Église et en partie maintenus, certains jusqu’à aujourd’hui, comme des pratiques distinctes au sein de la communion ecclésiale. Par exemple, les Églises orientales, même celles en communion avec Rome, célèbrent Pâques, la principale fête des chrétiens, à une date différente de celle des catholiques romains. Et il en va de même pour d’autres dates et temps liturgiques.
Comment cela a-t-il commencé ? À partir de l’eucharistie hebdomadaire – les premiers chrétiens célébraient tous les « huitièmes jours », que nous appelons aujourd’hui dimanche (de dominica dies, « jour du Seigneur ») – et de la Pâque annuelle (célébration de la Pâque de la Résurrection une fois par an), un riche cycle de célébrations s’est développé tout au long de l’année.
Les églises chrétiennes des premiers siècles, soumises pendant de longues périodes aux persécutions de l’Empire romain, commencèrent à vénérer leurs martyrs, qui donnaient leur vie et versaient leur sang pour l’Évangile, participant ainsi au mystère pascal du Seigneur. La récurrence annuelle de la date de ces morts a donné naissance à ce que nous appelons le « martyrologe », c’est-à-dire la liste de tous les saints que nous vénérons dans la liturgie. Le martyrologe est enrichi en permanence par la béatification et la canonisation de nouveaux hommes et femmes, comme cela s’est produit récemment avec Monseigneur Oscar Romero, du Salvador (canonisé le 14 octobre 2018, à Rome).
Au quatrième siècle, la fête de la naissance de Jésus est apparue, conséquence logique de l’attention portée à toute sa vie et son œuvre, depuis le moment de sa conception et de sa naissance. Dans les siècles suivants, d’autres événements de la vie de Jésus ont acquis le statut de fêtes liturgiques. Au même siècle, la figure de Marie est entrée avec force dans la liturgie, à mesure que la théologie et la spiritualité définissaient et approfondissaient son rôle essentiel dans l’histoire du salut.
Depuis le Concile de Trente, au XVIe siècle, l’année liturgique, comme toute la liturgie, était formée dans toutes ses structures fondamentales, qui sont restées sans changements majeurs jusqu’au Concile Vatican II en 1965. Le CVII a été précédé de plus d’un siècle d’études liturgiques scientifiques, qui ont peu à peu remis en question une série d’aspects de la liturgie qui seraient profondément réformés à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
4 La réforme de Vatican II
Depuis le Concile Vatican II, nous avons une année liturgique très renouvelée par rapport au passé. Le nombre énorme de fêtes obligatoires de saints qui s’étaient accumulées au fil de l’histoire a progressivement entraîné la perte de la centralité du mystère pascal du Christ et de l’importance du dimanche. La conscience de l’importance fondamentale de la Sainte Écriture pour la foi et la catéchèse de l’Église a rendu nécessaire de repenser sa présence dans la liturgie. On peut en dire autant de l’usage des langues de chaque pays ou groupe humain, clé de la compréhension et, surtout, de la participation plus active des personnes à la célébration. La participation de l’assemblée a été l’une des principales questions de la réforme, qui a conçu la liturgie non comme une fonction sacrée à laquelle les fidèles assistent passivement, en écoutant et en répétant des gestes prédéfinis, mais comme une fête du peuple de Dieu, présidée par le Christ lui-même en ses ministres, et caractérisée par la participation active de toute l’assemblée liturgique, chacun selon sa condition et sa fonction, et avec une plus grande spontanéité et présence de la vie concrète des fidèles.
Tenant compte de ces aspects et d’autres qui nécessitaient une réforme urgente, le Concile a profondément renouvelé la liturgie et l’année liturgique. Il a réévalué la centralité du dimanche, la célébration de la « Pâque hebdomadaire » et le rythme fondamental de l’année liturgique. Une autre grande richesse de la réforme est la présence renouvelée de la Bible dans les célébrations. Pour l’eucharistie dominicale, un cycle de trois ans a été élaboré, au cours duquel des lectures de toute la Bible ont été réparties, permettant aux communautés de se familiariser avec les fondements de la Sainte Écriture pendant cette période.
4.1 La structure actuelle de l’année liturgique
L’organisation actuelle de l’année liturgique comporte des « temps » et des célébrations pour l’Église universelle. Dans l’Église catholique, elle commence avec les Premières Vêpres du Premier Dimanche de l’Avent (c’est-à-dire le samedi après la fête du Christ-Roi, dans l’après-midi). La date de ce jour n’est pas fixe, mais change légèrement chaque année. Comme il y a quatre dimanches de préparation à Noël, on compte à rebours à partir du dernier dimanche avant le 25 décembre pour déterminer la date du premier dimanche de l’Avent. C’est toujours entre les derniers jours de novembre et les premiers jours de décembre. Avec l’Avent commence le cycle de Noël (également appelé cycle de la Manifestation du Seigneur), qui se poursuit jusqu’à la fête du baptême du Seigneur, le premier dimanche après le 6 janvier.
Le deuxième temps est le temps ordinaire, qui commence après la fête du baptême de Jésus et s’étend jusqu’au début du Carême, temps de préparation à la Pâque de la résurrection. Cette date n’est pas non plus fixe, car elle est déterminée par la date de Pâques, établie sur la base du calendrier lunaire, et non solaire : Pâques est toujours le premier dimanche qui suit la pleine lune après l’équinoxe de printemps. Elle oscille entre le 22 mars et le 25 avril.
Commence alors le cycle pascal, qui est constitué par le Carême, la Semaine Sainte et Pâques, culminant avec la solennité de la Pentecôte.
Le lundi après la Pentecôte, le temps ordinaire reprend et dure jusqu’au samedi suivant la solennité du Christ-Roi. Le temps ordinaire compte 33 ou 34 semaines et est le plus long de l’année liturgique. Avec les premières Vêpres du dimanche suivant cette fête, une nouvelle année liturgique commence.
4.1.1 Le cycle ou temps de Noël
Ce cycle ou temps, le deuxième en importance de l’année liturgique, est aussi appelé « cycle de la manifestation du Seigneur », car nous célébrons le Christ qui se révèle à nous dans ses manifestations dans l’histoire humaine. Il est organisé autour de la deuxième grande fête du Seigneur, Noël, qui célèbre sa naissance à Bethléem.
L’« incarnation » de Dieu, le fait de se faire « chair » ou personne humaine, est la condition nécessaire pour qu’il puisse historiquement vivre et mourir. Le mystère pascal a été possible parce que Dieu s’est fait homme. Ce cycle commence l’année liturgique de l’Église, le premier dimanche de l’Avent. Ses principaux moments sont :
– les quatre dimanches de l’Avent, qui constituent la préparation à Noël et nous sensibilisent à l’espérance de la venue définitive du Seigneur ;
– Noël, fête de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem ;
– l’Octave de Noël, semblable à celle de Pâques, qui prolonge la fête pendant une semaine entière ; elle inaugure le « temps de Noël », qui dure jusqu’au début du temps ordinaire ;
– la fête de la Sainte Famille, le dimanche après Noël ;
– le jour de l’Octave, le 1er janvier et début de l’année civile dans une grande partie du monde, célébrant la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu ;
– l’Épiphanie, le 6 janvier ou le deuxième dimanche après Noël, qui rappelle la manifestation du nouveau-né à toutes les nations, représentées par les mages d’Orient ;
– le baptême du Seigneur, le dimanche après l’Épiphanie, qui fait mémoire du début de son ministère messianique, se manifestant ainsi à son peuple, Israël. Avec cette fête, le « temps de Noël » se termine et la première semaine du « temps ordinaire » commence.
4.1.2 Le cycle ou temps pascal
Le cycle, ou temps, de Pâques est le plus important de l’année liturgique, car en son centre se trouve la principale fête chrétienne, la Pâque de la Résurrection. Le cycle commence le Mercredi des Cendres, avec le Carême, un temps de conversion et de réflexion qui dure 40 jours et est orienté vers la préparation de Pâques. À la fin du Carême, vient la Semaine Sainte, la plus intense de l’année liturgique, dont les jours les plus importants sont :
– le Dimanche des Rameaux, où elle commence et commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem avant de mourir et de ressusciter ;
– le Jeudi Saint, où l’on célèbre la « messe chrismale » de l’évêque avec tous ses collaborateurs dans le ministère (prêtres et diacres) et où les huiles sont bénites pour les baptêmes, confirmations, onctions des malades et ordinations de l’année (il y a des diocèses où cette messe est reportée à un autre jour de la Semaine Sainte) ; et, le soir du Jeudi Saint, la Cène du Seigneur où nous célébrons l’institution de l’eucharistie et du sacerdoce ordonné ;
– le Vendredi Saint, le jour où nous nous souvenons de la mort du Seigneur ; c’est le seul jour de l’année où l’eucharistie n’est pas célébrée (c’est pourquoi nous communions avec les hosties consacrées le Jeudi Saint) ;
– le Samedi Saint, qui culmine, le soir, avec la vigile pascale ;
– et la célébration dominicale de la résurrection.
La célébration de la résurrection se prolonge dans l’Octave de Pâques, jusqu’au dimanche suivant, comme « un unique jour de fête ». Elle se poursuit, en outre, pendant toute la cinquantaine pascale ou temps pascal, qui sont les cinquante jours qui culminent avec la fête de l’Esprit Saint, la Pentecôte. Le 40e jour est célébrée la Fête de l’Ascension du Seigneur, qui dans de nombreux pays est reportée au dimanche suivant, qui est celui avant la Pentecôte.
4.1.3 Le temps ordinaire
Pendant tout le temps qui se situe en dehors des deux grands cycles précédents, d’une durée de 33 ou 34 semaines, aucun aspect particulier du mystère pascal n’est célébré, mais plutôt le mystère du Christ et de son Église dans son ensemble. Les dimanches en sont les jours principaux ; tous les sept jours a lieu la fête de la résurrection pour les chrétiens. Une plus petite partie de ces dimanches, entre 5 et 9, se trouve après le cycle de la manifestation, à partir de la fête du baptême du Seigneur, et les autres, après le dimanche de la Pentecôte, jusqu’au samedi précédant le premier dimanche de l’Avent.
Quant à la lecture de l’évangile, l’évangéliste Luc a été désigné pour l’année A, les évangélistes Marc et Jean pour l’année B, et l’évangéliste Matthieu pour l’année C. Tous les trois ans, le cycle recommence, nous donnant la possibilité d’un nouveau parcours à travers les livres et les textes les plus importants pour notre foi. Dans le temps ordinaire, les dimanches et les jours de la semaine sont le motif de la célébration, en particulier le lectionnaire. Avec les lectures des années A, B et C, son unité est donnée, laquelle n’est pas rompue par sa division en deux parties.
4.1.4 Autres fêtes de l’année liturgique
Dans le temps ordinaire, l’Église place une série d’autres festivités importantes, parmi lesquelles se distinguent de nombreuses fêtes de la Vierge et des saints, bien que celles-ci soient également réparties tout au long de l’année, pouvant se trouver dans les cycles de la manifestation et de Pâques. Les événements les plus importants sont les suivants.
En ce qui concerne Jésus-Christ : Présentation du Seigneur (2 février, en réalité, elle entre dans le complexe des festivités de la manifestation) ; Exaltation de la Croix (14 septembre ou 3 mai) ; Très Sainte Trinité (dimanche après la Pentecôte ; célèbre le Père, le Fils et le Saint-Esprit) ; Fête-Dieu (Corpus Christi – Corps et Sang du Christ ; deuxième jeudi après la Pentecôte) ; Sacré-Cœur de Jésus (troisième vendredi après la Pentecôte) ; Transfiguration du Seigneur (6 août) ; Christ Roi (dernier dimanche de l’année liturgique, c’est-à-dire avant le premier jour de l’Avent).
En ce qui concerne la Vierge Marie : Annonciation du Seigneur (25 mars : neuf mois avant la naissance) ; Assomption de Marie (15 août) ; Immaculée Conception (8 décembre) ; Cœur Immaculé de Marie (troisième samedi après la Pentecôte) ; et de nombreuses invocations spéciales, comme Notre-Dame de Lourdes (11 février), Notre-Dame de Fátima (13 mai), et, surtout en Amérique Latine, le continent marial par excellence, dont les pays vénèrent la Vierge Marie comme patronne sous diverses invocations : Notre-Dame de Guadalupe (patronne de l’Amérique Latine, 12 décembre), Notre-Dame d’Aparecida (12 octobre), Vierge de Luján (8 mai), Notre-Dame du Carmel (16 juillet) et bien d’autres.
En ce qui concerne les saints : Toussaint (1er novembre), Saint Joseph (19 mars) et Saint Joseph Artisan (1er mai), Saint Jean-Baptiste (24 juin), Saint Pierre et Saint Paul (29 juin) et d’autres propres à chaque pays. Le grand nombre d’hommes et de femmes qui ont été canonisés depuis le pontificat de Saint Jean-Paul II est dû au désir d’enrichir les calendriers particuliers avec des saints et saintes locaux, en plus de ceux du calendrier universel.
Il y a encore beaucoup d’autres fêtes de la Vierge Marie et des saints. Elles sont souvent plus liées à la dévotion personnelle ou à certaines régions. Pour son importance pour de nombreux catholiques, nous devons également mentionner la commémoration de Tous les fidèles défunts (2 novembre), un jour de grande affluence dans les cimetières.
La communion n’est pas l’uniformité, mais l’unité dans la richesse de la diversité. Pour cette raison, l’année liturgique devient locale dans chaque Église particulière, à travers ses propres célébrations et fêtes.
Les célébrations ont leurs propres couleurs, qui sont utilisées dans les vêtements liturgiques et autres signes/symboles de l’espace de célébration : le vert pour le temps ordinaire, tant les dimanches que les jours de fête et de semaine ; le rouge pour le Dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint et les fêtes des apôtres et martyrs ; le violet pour l’Avent, le Carême et les célébrations pour les défunts ; et le blanc pour Pâques, Noël et les autres solennités et fêtes du Christ et de la Vierge Marie. En divers lieux, la couleur bleue a été popularisée pour les fêtes de la Vierge. La signification des couleurs est conventionnelle, elle peut changer d’une culture à l’autre : le rouge pour la passion, les apôtres et les martyrs qui ont donné leur sang, comme Jésus-Christ, pour l’évangile. Le blanc, couleur par excellence de la sainteté et de la pureté, pour les grandes solennités de l’année et pour les fêtes de la Vierge. Le violet, couleur originellement pénitentielle, de recueillement et de conversion, pour les temps de préparation et pour les célébrations de la mort des chrétiens. Le vert, la couleur la plus commune, pour le temps normal.
4.2 Le temps liturgique comme mystagogie de l’Église
L’année liturgique n’est pas une simple organisation des célébrations liturgiques de l’Église dans le temps. Bien plus qu’une simple structure, elle est en réalité une mystagogie de l’Église, c’est-à-dire un itinéraire formatif qui introduit au mystère du Christ et conduit à un approfondissement toujours plus grand de l’évangile et de toute la doctrine chrétienne et, par conséquent, à une croissance dans l’engagement des fidèles envers leur foi.
On commémore toute la richesse du mystère du Christ : sa naissance, sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection, ses paroles et ses actes, sa Mère Marie, les effets de son message sur tant de témoins et de martyrs à partir des lectures bibliques, la richesse et la beauté des textes liturgiques élaborés par l’Église, l’expérience de célébrer en communauté et de participer activement aux célébrations, de chanter et de dialoguer dans des ambiances fraternelles, d’expérimenter les défis auxquels le Seigneur nous appelle depuis la célébration de la foi ; tout cela est un chemin unique de croissance et d’approfondissement de la vie chrétienne pour tous les fidèles.
Vivre consciemment le déroulement de l’année liturgique, non seulement pendant un an, mais pendant les trois ans du cycle dominical, nous permet de parcourir les fondements de la révélation chrétienne à travers les lectures bibliques, et aide également à générer, dans l’Église, l’authentique communion dans la diversité et, en chaque chrétien, la conscience d’une foi et d’un engagement qui ne sont pas statiques. Ce sont d’authentiques « histoires du salut » vécues dans l’évolution du temps, toujours mises au défi d’une plus grande fidélité à l’évangile et toujours attirées par l’espérance du Royaume, sommet du temps et de l’année liturgique.
Guillermo Rosas. Université pontificale catholique du Chili. Texte original en espagnol.
Références
CALENDARIO ROMANO GENERAL, 1969. Également l’édition contenant le Missel Romain, 3e édition typique, 2002.
CALENDARIA PARTICULARIA, Instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto divino, 24 junio 1970.
PAUL VI. Msterii Paschalis, Motu proprio, 1969.
BERGAMINI, Augusto. Entrée Año litúrgico. In: Nuevo diccionario de liturgia. Madrid: Paulinas, 1987, p. 136-144.
CASTELLANO, Jesús. El año litúrgico. Memorial de Cristo y mistagogía de la Iglesia. Barcelona: Biblioteca litúrgica 1, Centre de Pastoral litúrgica, 1994.
DALMAIS I. H. El tiempo en la liturgia. In: MARTIMORT, A. G. La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia. Nouvelle édition mise à jour et augmentée, partie IV. Barcelona: Herder, 1987, p.889-895.
GOÑI, José Antonio. Historia del año litúrgico y del calendario romano, Biblioteca litúrgica 40. Barcelona: Centre de Pastoral litúrgica, 2010.
LÓPEZ MARTÍN, Julián. La voz: Calendario litúrgico. In: Nuevo diccionario de liturgia. Madrid: Paulinas, 1987, p.258-264.
ROSAS, Guillermo. El año litúrgico. In: CELAM. Manual de Liturgia, v. IV: La celebración del misterio pascual. Otras expresiones celebrativas del misterio pascual y la liturgia en la vida de la Iglesia. Bogotá: CELAM, 2002, p.19-58.
_____. El hoy de la salvación en la liturgia. Revista Medellín, v.XXIX, n.116, CELAM-ITEPAL, p.699-718, décembre 2003.
______. El tiempo en la liturgia. In: CELAM. Manual de Liturgia, v. III: La celebración del misterio pascual. Fundamentos teológicos y elementos constitutivos. Bogotá: CELAM, 2003, p.545-57.
TRIACCA A. M. Entrée: Tiempo y liturgia. In: Nuevo diccionario de liturgia. Madrid: Paulinas, 1987.