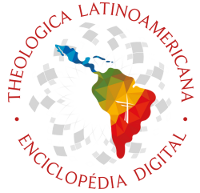Sommaire
1 Comment tout a commencé
2 Brève histoire de la Liturgie des Heures
2.1 Origines
2.2 La réforme de la Liturgie des Heures
3 De la Liturgie des Heures à l’Office Divin des Communautés
3.1 Quelques principes directeurs
3.2 La sacramentalité de l’Office Divin des Communautés
3.3. La sanctification du temps
3.4. Le lucernaire
3.5 Prière de l’Église
4 Un mot pour finir
Références
1 Comment tout a commencé
La réforme de la Liturgie des Heures entreprise par l’Église a accompli l’importante tâche de retrouver le sens ecclésial de la prière, son caractère célébrant, et la tradition la plus authentique d’associer la prière, au fil des heures de la journée, au mystère pascal (cf. PGLH, p.33, 38-39). Cependant, il est admis que la version officielle de l’Office Divin dans le rite romain a conservé des caractéristiques majoritairement cléricales et monastiques (TAFT, 1999, p.303-305 ; JOIN-LAMBERT, 2009, p.83-90 ; p.99-100). Au Brésil, sa version traduite a tardé à atteindre la capillarité du tissu ecclésial, rendant encore plus difficile la réception de l’office réformé dans la période post-conciliaire (LIMA, 2011, p.31-34). Mais les difficultés se sont transformées en opportunité, car un processus authentique de réception a commencé à partir de l’expérience de prière des fidèles.
On trouve des registres à la CNBB, datant de 1986, sur la formation d’un groupe qui serait chargé d’élaborer une proposition alternative et populaire d’Office, visant la participation des fidèles à la Prière de l’Église. Mais l’idée d’un office divin populaire a commencé bien avant, dans les années 1970, à l’initiative de Geraldo Leite Bastos, prêtre de l’archidiocèse d’Olinda et Recife, alors curé de la Communauté de Ponte dos Carvalhos, en périphérie de Recife. Le père Geraldo avait initié une pratique quotidienne de prière, sous l’impulsion du Concile Vatican II. En 1987, dans une interview, il parle de cette expérience :
Il y a 17 ans, nous, de la communauté de Ponte dos Carvalhos, chantions déjà l’Office. J’ai laissé écrit dans le Registre de la paroisse le début de notre pratique d’une prière différente de la messe. Je pense que notre expérience a commencé pour deux raisons : d’abord parce que la messe était devenue un peu formelle. Il était nécessaire de trouver une autre manière de prier qui ne soit pas seulement la messe. (…) Une autre raison fut le contact avec les frères de Taizé, qui étaient arrivés à Olinda. J’ai participé plusieurs fois avec eux et j’ai remarqué qu’ils avaient une expérience de prière différente de celle du Monastère de São Bento. J’ai commencé à penser que le peuple pourrait prier l’Office. En ces temps difficiles pour l’Église, je restais souvent jusqu’au petit matin à prier un Office mal prié, en lisant toute cette psalmodie… Cela m’a amené à imaginer un bréviaire simplifié, populaire, de sorte que moi, qui avais tant de difficulté à prier seul, je puisse trouver un moyen de prier cette prière avec le peuple. (LEITE BASTOS, 1988, p.56)
À cette époque, l’Église du Brésil vivait l’élan de la réception du Concile Vatican II, assumé surtout par la conférence de l’épiscopat latino-américain à Medellín. On ressentait, dans ce contexte, le besoin d’une référence de prière qui corresponde mieux à l’expérience des Communautés Ecclésiales de Base, qui émergeaient comme une expression concrète de l’Église peuple de Dieu. Attentives aux principes et propositions conciliaires, les CEB voulaient approfondir le chemin ouvert par la piété populaire qui avait conservé des trésors de la tradition comme le Petit Office de la Bienheureuse Vierge Marie et la coutume de prier à certaines heures de la journée.
Plus tard, en 1986, le père Marcelo Barros, alors prieur du monastère de l’Annonciation à Goiás, conseiller des Communautés de Base, a réuni un groupe de personnes pour élaborer un Office Divin accessible aux communautés. Il a pris comme inspiration l’expérience du père Geraldo Leite et comme référence immédiate la Liturgie des Heures réformée par le Concile Vatican II, qui était déjà traduite depuis 1971. De plus, la cohabitation avec la petite communauté du monastère de l’Annonciation fut décisive dans ce processus, comme lieu d’expérimentation de la célébration de l’Office avec la participation des voisins. En décembre 1988, fut publiée la première édition de l’Office Divin des Communautés (ODC), qui, en 2018, a fêté ses 30 ans avec sa troisième édition, occasion à laquelle il comptait déjà 21 réimpressions.
Il s’agit d’une expérience née au Brésil, dans le contexte de la réception du Concile Vatican II en Amérique latine, à la lumière des Conférences latino-américaines de Medellín et de Puebla. Bien que l’ODC ait été adopté dans des assemblées de la Pastorale de la Jeunesse et d’autres mouvements ecclésiaux, dans le contexte de l’Amérique latine, il n’existe pas d’initiatives similaires à l’ODC dans d’autres pays du Continent.
2 Brève histoire de la Liturgie des Heures
2.1 Origines
L’Office Divin est une concrétisation de la tradition qui remonte aux débuts de l’Église. Dans les Actes des Apôtres, on trouve des allusions à une pratique de la prière aux heures du jour, en continuité avec le rythme quotidien de la prière juive. Au IVe siècle, ce type de liturgie avait atteint une stabilité : les laudes et les vêpres étaient célébrées quotidiennement, en communauté (ELBERTI, 2011, p.166). Selon Égérie, la pèlerine qui a relaté la liturgie à Jérusalem au même siècle, il s’agissait d’une pratique quotidienne, liée aux heures, surtout au crépuscule et à l’aube, en mémoire du crucifié-ressuscité. On comptait sur la participation du peuple, hommes et femmes, et même des enfants. C’était une liturgie expressive, non seulement avec des psaumes et des hymnes, mais aussi avec des gestes et des symboles, de manière simple et populaire (cf. ETÉRIA, 1977, n.24,1-7). Ce modèle d’office célébré dans les cathédrales, avec toute sa densité biblique et théologique, simple et accessible au peuple, tendait à nourrir la vie du chrétien ordinaire.
Cependant, avec le temps, la prière de l’Église a subi un rétrécissement au point de se limiter à une certaine partie du peuple de Dieu, ce qui s’est produit pour plusieurs raisons, comme la fixation du latin comme langue liturgique, la multiplication des heures dans certains contextes, la complication et la saturation des rites, qui ont exclu le peuple de la participation et de la compréhension des paroles. Selon Pietro Sorci, la cause principale de la disparition de la prière horaire est due à l’eucharistisation (célébration de messes quotidiennes et, parfois, de plus d’une ; occurrence d’heures saintes d’adoration du Saint-Sacrement) et à tout ce qui s’y rapporte (cléricalisation, ecclésiologie des élus, sacramentalisation), au détriment de l’évangélisation, y compris la formation insuffisante dans les séminaires. De plus, l’effacement de cette forme de prière est également dû à la récitation individuelle imposée au clergé, qui a cessé de rassembler le peuple pour célébrer communautairement l’Office (SORCI apud PEREIRA SILVA, 2015, p.15).
Cette réalité a entraîné pour l’Office Divin des conséquences sur le plan de la célébration, comme l’appauvrissement de la gestuelle, la transformation de ce qui était une expression de gratuité en un fardeau, infligé par l’« obligation ». La déconnexion avec l’heure, puisque la récitation de la prière était souvent faite à n’importe quel moment de la journée, a conduit à une diminution du caractère pascal de l’Office. Dans les milieux monastiques, au contraire, l’Office a conservé son style communautaire, lié aux heures et à l’année liturgique, mais en latin et avec des ajouts requis par la condition de la vie monastique. De cette manière, ce qui était simple et populaire est devenu complexe et surchargé d’éléments, avec des psaumes, des hymnes, des lectures, des litanies, des offices quotidiens en l’honneur de la Vierge Marie et des défunts, entre autres.
Le peuple, en grande majorité livré, souvent, à son propre sort, sans aucune possibilité d’une véritable initiation à la foi et de célébration du mystère, a cherché de manière créative dans les dévotions la nourriture de la foi chrétienne, comme l’atteste le Directoire sur la piété populaire et la liturgie :
Du VIIe siècle jusqu’à la moitié du XVe siècle, la différenciation entre liturgie et piété populaire se détermine et s’accentue progressivement, jusqu’à créer un dualisme de célébration : parallèlement à la liturgie, officiée en latin, se développe une piété populaire communautaire, qui s’exprime en langue vernaculaire. (CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN, 2003, n.29)
En ce qui concerne l’Office, le rosaire, avec ses 150 Ave Maria, remplace les 150 psaumes ; l’Angélus, prié trois fois par jour, occupe les heures de l’Office; l’Office de Notre-Dame rassemble les hymnes de toutes les heures de l’Office de la Mère du Seigneur et est prié en une seule fois, imitant le clergé dans sa déconnexion avec l’heure.
2.2 La réforme de la Liturgie des Heures
Le but de la réforme du Concile Vatican II concernant l’Office Divin était de faire revenir cette pratique à la condition de « prière publique et commune du peuple de Dieu » (PGLH, n.1), en récupérant sa dimension d’action communautaire, de prière du Christ au Père et de prière de l’Église avec le Christ (et au Christ, selon saint Augustin), faisant mémoire de sa pâque. De plus, le Concile a changé le langage rubriciste et clérical de la Liturgie des Heures pour un langage ecclésial et pascal, gratuit et spirituel.
Nous soulignons, ci-après, quatre aspects de la réforme.
L’Office Divin est liturgie. Comme toute liturgie, l’Office Divin est une action rituelle, communautaire, ecclésiale, et non une action privée (cf. SC n.26). Il s’agit d’une lit-URGIE (lit = peuple ; urgie = action, office, travail) : action du peuple et action de Dieu (divine) au service du peuple. C’est une action liturgique comme une autre. En elle, les mêmes éléments qui font partie des autres célébrations de l’Église (hymnes, psaumes, lectures bibliques, silence, prières, musique, gestes symboliques) ont été organisés en tenant compte de sa particularité : la mémoire du mystère pascal lié aux heures dans le rythme quotidien, s’articulant également avec le rythme hebdomadaire et annuel.
Le peuple comme sujet. Le Concile Vatican II a voulu rendre à tout le peuple le droit de célébrer l’Office Divin, bien qu’il soit resté davantage dans le domaine du clergé et de la vie consacrée. Mais il a recommandé que les laïcs « récitent l’Office Divin, soit avec les prêtres, soit réunis entre eux, et même chacun en particulier » (SC n.100). La Présentation Générale de la Liturgie des Heures souligne que « la louange de l’Église n’est réservée ni aux clercs ni aux moines, ni par son origine, ni par sa nature, mais appartient à toute la communauté chrétienne » (PGLH n.270). L’Office Divin est une action liturgique si le peuple devient sujet priant, dans l’exercice du sacerdoce baptismal offrant le sacrifice de louange (cf. GARCIA, 2015, p.78).
La vérité des heures. La réforme du Concile Vatican II a attiré l’attention sur la finalité spécifique de l’Office Divin : « consacrer, par la louange à Dieu, le cours diurne et nocturne du temps » (SC n.84). Elle a souligné la vérité des heures (SC n.94), en mettant en évidence, comme heures principales, les Laudes, priées à l’arrivée de la lumière du jour, en mémoire de la résurrection de Jésus, et les Vêpres, célébrées au coucher du soleil, heure qui rappelle la dernière Cène de Jésus et la croix (Lc 22,53). La Liturgie des Heures est la Prière de l’Église, unie au Christ dans sa prière de louange, d’action de grâces et d’intercession, faisant mémoire de sa pâque.
C’est le Sauveur lui-même qui a lié notre temps à la rédemption : « Aujourd’hui s’accomplit cette parole des Écritures » (Lc 4,21), en d’autres termes, aujourd’hui la Parole proclamée transforme le temps en libération et en grâce (cf. GARCIA, 2015, p.77). Dans la Liturgie des Heures, la parole de Dieu prononcée, proclamée, entendue, vécue et actualisée, interprète le temps comme kairós, événement de salut, temps favorable, mémorial de la nouvelle alliance (cf. GARCIA, 2015, p.72). Il y a, dans l’acte de célébrer, une relation profonde entre les heures de Jésus et les heures de la communauté qui prie, entre sa passion et les marques de la passion que les gens portent dans leur corps (cf. SC n.12 ; 2Co 4,10-11).
Source de piété. L’intention de la réforme de l’Office Divin était d’en faire une source de piété et une nourriture pour la prière personnelle (SC n.90). La liturgie des heures est une expression d’alliance et, par conséquent, une source de transformation pascale. C’est glorification et sanctification. C’est pourquoi il est déterminant que nous participions de tout notre être et que nous accompagnions avec l’esprit [et le cœur] les paroles [et les gestes], et que nous coopérions avec la grâce divine pour ne pas la recevoir en vain (cf. SC n.11 et 90).
Malgré ces avancées, la liturgie des heures est restée assez « monastique » dans sa forme. Certains disent que parmi les points faibles de la réforme liturgique, le plus évident est la réforme de la Liturgie des Heures. Dans le mouvement de retour aux sources, la réforme n’a pas réussi à restaurer la simplicité et la ritualité de la pratique primitive de l’Office des Cathédrales, avec toute sa richesse de ministères, de symboles et de rites, célébrée avec la participation du peuple, comme nous l’avons noté plus haut. La réforme a davantage tenu compte du clergé et de la vie consacrée que du peuple. De plus, en raison du poids historique de l’obligation, dans la pratique, il est difficile de passer de la récitation à la célébration. La version brésilienne de la Liturgie des Heures (LH) est excellente du point de vue de la traduction, surtout des psaumes, adaptés au chant. Mais elle porte en elle ces limites de l’édition typique, comme le fait, par exemple, de ne pas avoir progressé vers l’inculturation, si désirée par le Concile lui-même (cf. SC n.37-40).
3 De la Liturgie des Heures à l’Office Divin des Communautés
3.1 Quelques principes directeurs
L’Office Divin des Communautés (ODC), prenant comme référence immédiate pour son élaboration la Liturgie des Heures renouvelée, a cherché à offrir au peuple une version populaire de la tradition de prière de l’Église.
D’un côté, il a été fidèle à la Liturgie des Heures (LH), car il a obéi à la même structure, à la même théologie et à la même séquence rituelle. Comme dans la LH, toute l’élaboration rituelle de l’ODC est destinée à exprimer le mystère du crucifié-ressuscité aux heures du jour, en suivant le rythme quotidien, hebdomadaire et annuel, avec des hymnes, des psaumes, des cantiques bibliques, des prières et des oraisons.
D’un autre côté, en prenant comme point de départ l’expérience ecclésiale du Brésil, l’ODC a su laisser de côté ce qui pèse dans la structure de la Liturgie des Heures et a osé être créatif en incorporant de nouveaux éléments : la nouvelle manière de célébrer des Communautés Ecclésiales de Base et l’aspiration à la prière du catholicisme populaire.
Il ne s’agit pas de proposer aux communautés l’office tel quel dans le Rite Romain, même simplifié ou abrégé. Il s’agit d’un nouveau style brésilien dans le champ plus large de la famille liturgique romaine. Il ne suffirait pas non plus de répéter ou de publier les prières et les chants coutumiers de la religion populaire, ou même des rencontres de prière des groupes en marche. L’Office Divin des Communautés se veut une synthèse réelle et intelligente, fidèle à la grande tradition liturgique et à la sensibilité et la culture de notre peuple (BARROS, 1988, p.30).
De la tradition ecclésiale latino-américaine, l’ODC a hérité du Souvenir de la Vie, qui est l’expression la plus sensible de la relation entre la liturgie et la vie. Selon Libanio, les liturgies qui ont émergé sur la scène de l’Église de Medellín répondent au défi de lier la liturgie à la praxis libératrice « sans briser la colonne vertébrale de la gratuité, de la liberté et de la beauté contemplative » (LIBANIO, 2001, p.107-108). L’Office commence sans aucun commentaire, par une invocation de Dieu et une invitation à la louange. Ce n’est qu’alors que celui qui préside invite les participants à apporter des expériences qui ont marqué leur vie.
La vie, les événements de chaque jour, les personnes, leurs angoisses et leurs espérances, leurs tristesses et leurs joies, les conquêtes et les revers du chemin, les souvenirs marquants de l’histoire, de la communauté, des Églises et des peuples, les phénomènes mêmes de la nature sont des signes de Dieu pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C’est par là que commence notre écoute de la Parole de Dieu. Se souvenir de la vie, la ramener au cœur, partager les souvenirs et les préoccupations, c’est aider à rendre la prière véritable (ODC, 2018, p.11).
Mais la vie est latente dans tout l’office : dans le langage des prières et des suppliques, dans les psaumes, dans les hymnes du cheminement, dans la mémoire des martyrs défenseurs de la vie sur notre continent. Il faut encore rappeler le soin apporté à la dimension œcuménique dans l’ODC, exprimé dans des éléments comme le Notre Père œcuménique, les hymnes des Églises sœurs, l’inclusion d’images de Dieu (de tendresse, de bonté, de compassion).
Le grand mérite de l’Office des Communautés est qu’il a réussi à rendre viable, dans la pratique, ce que la Liturgie des Heures propose : que l’office, comme toute autre action liturgique, n’est pas une action privée, mais une action communautaire, une célébration.
Dans les cultures populaires brésiliennes, la manière de donner à chaque office un caractère plus célébrant est d’intégrer tout le corps et l’univers qui nous entoure dans la prière. Dans la Bible, les psaumes contiennent de nombreuses attitudes corporelles de prière, comme se tourner vers la montagne, élever le regard et les mains, s’incliner, s’agenouiller, marcher en procession (BARROS, 1994, p. 30).
Même sans que cela soit déterminé par écrit, la pratique a créé un style de célébration qui met en avant la valorisation de l’espace, du chant, des ministères, des gestes (allumer des bougies, se rassembler autour de l’ambon pour l’écoute de l’évangile, offrir de l’encens…). Tout pour conduire au silence et favoriser la participation externe et interne, consciente et fructueuse. En ce sens, la grande perle de l’ODC est le lucernaire de la vigile des dimanches et des solennités. Ce rite qui, dans les communautés des origines, appartenait à l’Office quotidien des Vêpres, a été placé à l’ouverture de l’Office de Vigile, soulignant le dimanche comme Pâque hebdomadaire, en analogie avec le rite de la lumière dans la vigile pascale.
Concernant l’interaction avec le catholicisme populaire, l’ODC est un exemple réussi de la « fécondation mutuelle » entre la liturgie et la piété populaire, si désirée par la réforme liturgique (cf. SC n.13) et si souvent évoquée par les documents du CELAM et de la CNBB (CNBB, 1984, p.30). Le travail n’a pas tant consisté à ajouter des éléments extérieurs du catholicisme populaire, mais à faire en sorte que l’Office corresponde à la « piété » du peuple, à son « aspiration à la prière et à la vie chrétienne », à la « soif de Dieu, que seuls les pauvres et les simples peuvent expérimenter » (cf. Evangelii Nuntiandi, n.48). Dans cette syntonie avec la piété populaire, on remarque le style priant, la forme de répétition dans les chants, surtout dans les ouvertures, le langage simple et affectueux, l’absence de commentaires, ce qui facilite la participation et établit une relation amoureuse, d’alliance entre Dieu et son peuple.
3.2 La sacramentalité de l’Office Divin des Communautés
Le Concile Vatican II présente toute la liturgie – non seulement les sept sacrements – comme un événement sacramentel, où Jésus-Christ se rend présent, dans l’exercice de son sacerdoce, pour glorifier le Père et sanctifier l’humanité.
Dans l’article 7 de la Constitution liturgique, parmi les signes sensibles qui signifient et réalisent ce qu’ils signifient, se trouve l’assemblée qui prie et psalmodie, car en elle le Christ se rend présent et agit avec la force de son Esprit. Nous pouvons dire que l’assemblée réunie, le temps, la musique, les psaumes et les cantiques, la prière, les gestes et les paroles, sont des signes sensibles qui atteignent la corporéité des participants, évoquent le mystère invisible de Jésus-Christ et, par l’action de l’Esprit, réalisent la transformation pascale.
3.3 La sanctification du temps
Prenons la catégorie du temps, si importante pour la compréhension de la liturgie horaire de l’Office Divin. Dans les Écritures, les termes chronos, kairós et aiôn désignent respectivement le temps de la vie humaine en cours, le temps de l’action de Dieu dans l’histoire de l’humanité et le temps humain comme intercession entre la donnée historique et son sens eschatologique. Dans toutes les acceptions, le temps est une notion fortement identifiée à l’être humain (AUGÉ, 2019, p.36-38). De telle sorte que la notion de sanctification du temps ne dit rien d’autre que la sanctification de l’être humain lui-même par son insertion mémorielle dans l’expérience temporelle même du Verbe incarné, l’histoire du salut. Le temps est sanctifié par la Liturgie des Heures car, avec l’Année liturgique, elle contribue à donner un sens nouveau au temps de la vie humaine (PINELL, 2005, p.216).
Le temps comme signe sensible devient plus évident à l’aube et au crépuscule en raison de l’incidence de la lumière. Ces moments ont été établis comme mémoire et renouvellement de l’alliance. Sans la parole, la lumière ne signifie pas ; sans la lumière, le verbe ne se rend pas visible (cf. GARCIA, 2015, p.150). La parole narre le mystère pascal du Christ et de l’Église, dans la lumière qui illumine l’obscurité de la nuit, ou dans le soleil qui éclaire l’aube. La parole invisible, mais audible dans les psaumes, les lectures, les hymnes, les prières, interprète le signe sensible, rendant visible le Verbe (cf. GARCIA, 2015, p.72). C’est pourquoi le soin de la vérité de l’heure est une condition pour que la Parole puisse interpréter la lumière.
3.4 Le lucernaire
Le rite du lucernaire, à la vigile du dimanche et des grandes fêtes, se compose de l’ouverture et de l’hymne lucernaire. L’office de vigile commence dans l’obscurité, en silence. On entonne, à mi-voix, un refrain méditatif, pour éveiller dans le cœur l’aspiration au Dieu vivant. Comme à l’accoutumée, sans aucun commentaire, celui qui préside se lève et commence les versets de l’Ouverture, que l’assemblée répète :
– Venez, ô nations, chanter le Seigneur ! (bis)
Au Dieu de l’univers, venez faire la fête ! (bis)
– Son amour pour nous, ferme à jamais ! (bis)
Sa fidélité dure éternellement. (bis)
On allume les bougies
– Pour toi, Seigneur, toute nuit est jour. (bis)
L’obscurité la plus dense bientôt s’illumine. (bis)
– Tu es la lumière du monde, tu es la lumière de la vie ! (bis)
Christ Jésus resplendit : tu es notre joie ! (bis)
On offre de l’encens ou des herbes odorantes
– Que notre encens monte vers toi, ô Seigneur ! (bis)
Cette louange pascale, offrande d’amour. (bis)
– Nos mains priantes s’élevant vers les cieux ! (bis)
Qu’elles parviennent comme une offrande au son de cet hymne ! (bis)
– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. (bis)
Gloire à la Sainte Trinité, gloire au Dieu béni. (bis)
– Alléluia, sœurs, alléluia, frères ! (bis)
Peuple de prêtres, à Dieu la louange. (bis)
Les premiers mots de l’ouverture sont une convocation à la louange, avec des versets du psaume 117. Dans ces mots, nous entendons le Christ lui-même appeler la communauté à participer à sa prière au Père, comme il l’a si souvent fait dans sa vie terrestre (cf. Mc 6,30-31). Nous traçons le signe de la croix sur notre corps au premier verset, nous rappelant notre baptême, par lequel le Christ nous associe à son mystère pascal et à sa prière. Le chant d’ouverture continue, avec des paroles qui se joignent au geste de l’allumage du cierge et des bougies pour narrer la victoire de la lumière sur les ténèbres qui correspondent aux afflictions du peuple. La fonction de la prière des heures est de crier, de placer sous le regard de Dieu ce qui se passe dans le monde. Dieu écoute la clameur, regarde le cœur de ceux qui souffrent, et descend pour sauver (cf. Ex 3,7-8).
Un récipient avec des braises allumées est placé sur l’autel. Encore dans l’obscurité, mais maintenant éclairée par les flammes allumées dans la main de l’assemblée, on fait l’offrande de l’encens, signe du sacrifice spirituel du peuple sacerdotal, accompagnée des versets chantés.
Une fois l’ouverture terminée, celui qui préside invite les participants à apporter les souvenirs qui identifient les lumières du chemin ou les nuits qui persistent…
Ensuite, on entonne l’hymne « Lumière Radieuse ». Cet hymne, plus ancien que le Gloria, remonte au IIe siècle et est cité par saint Basile (BASILE, 2003, p.403). Dans l’ODC (p.265), la version est de Reginaldo Veloso, sous forme responsoriale, pour garantir la participation de l’assemblée par un refrain qui se répète à chaque strophe.
Lumière radieuse, lumière de joie,
lumière de la gloire, Christ Jésus
– Tu es du Père immortel et heureux
la clarté qui en tout resplendit !
– Quand le soleil arrive au couchant
nous apercevons de la nuit la lumière !
– Nous chantons le Père et le Fils
et le Divin qui nous conduit !
– Tu mérites le chant le plus pur,
ô Seigneur de la vie, tu es la lumière !
– Ta gloire, ô Fils de Dieu,
l’univers tout entier séduit !
– Que le ciel chante, que la terre et les mers chantent,
la victoire, la gloire de la croix !
Les paroles de l’hymne continuent de narrer le mystère manifesté dans les lumières qui percent l’obscurité. Elles font que l’assemblée reconnaisse, dans cette image de la nuit illuminée, la présence du Christ Ressuscité, à qui l’hymne s’adresse. Devant le jour qui meurt, la communauté croyante contemple la lumière qui ne meurt pas. Le texte identifie dans la « clarté du Père qui en tout resplendit », le fils unique qui procède du Père, qui est source de vie. Le chant le plus pur est consacré au Christ, Seigneur de la vie, qui séduit l’univers par sa gloire, pour laquelle le ciel, la terre et les mers entonnent leur chant.
L’efficacité suppose la conscience de l’assemblée d’être insérée dans un événement de salut, dans lequel le Christ, par l’action de l’Esprit, réalise en elle le mystère de sa pâque. En transformant le temps en kairós, le passage de la mort à la vie se réalise dans l’Église. Après tout, le but ultime de la liturgie est la sanctification (SC n.10 et 33). Ainsi, peu à peu, chaque personne est amenée à surmonter tout ce qui est ancien pour atteindre la stature de la « créature nouvelle » en Christ.
3.5 Prière de l’Église
Se réunir pour prier est une action primordiale et une exigence vitale de la communauté chrétienne. Lorsque les pères de l’Église soulignent l’importance de l’assemblée chrétienne, ils ne pensent pas seulement à l’eucharistie, mais aussi à d’autres moments communs de prière et de louange.
L’article 83 de Sacrosanctum Concilium fait une affirmation qui reprend la LH comme partie structurante de toute la liturgie de l’Église :
Jésus-Christ unit à lui toute l’humanité et l’associe à son cantique de louange. Et il continue d’exercer ce sacerdoce, dans l’Église, qui loue le Seigneur sans cesse et intercède pour le salut du monde, non seulement par la célébration de l’Eucharistie, mais de bien d’autres manières, spécialement par l’Office Divin.
L’article 84 dit que dans cette prière « le Christ s’adresse au Père, par son corps ». C’est-à-dire que cette prière appartient à tout le corps du Christ. La prière de la communauté et de chaque personne qui prie est le sacrement de la prière du Christ. Il est le médiateur de la nouvelle alliance, par lui l’humanité a accès au Père. Le Père écoute toujours la voix du Fils (Jn 11,42). « Il est donc nécessaire que, lorsque nous célébrons l’Office Divin, nous reconnaissions l’écho de nos voix dans la voix du Christ, et la sienne en nous » (PAUL VI, 1971, n.20).
L’un des mérites de l’ODC est justement de permettre au peuple des communautés d’avoir accès à la prière qui lui appartient et de pouvoir y participer de manière active, consciente et fructueuse. Non seulement cela, mais il a déclenché un processus d’apprentissage de la prière avec l’Église, de découverte des psaumes comme école de prière, de reconnaissance en eux de la voix du Christ et de faire de la prière une expérience de gratuité et d’alliance amoureuse. C’est quelque chose qui ne se fait pas automatiquement. Il faut apprendre.
Saint Benoît offre une « règle d’or », que Sacrosanctum Concilium a reprise et appliquée à toute l’Église : « Que l’esprit s’accorde avec la voix » (SC n.90 ; RB n.19). L’esprit « n’équivaut pas seulement à la raison, mais à la personne intérieure avec sa connaissance, sa volonté et son sentiment. Il est presque identique au cœur, en particulier la partie dominante de l’âme (cf. GRÜN, 2019, p.30-31). La voix se réfère à la manifestation de l’Esprit, c’est la voix de Dieu que nous devons entendre. Le cœur doit être en harmonie avec la voix (cf. GRÜN, 2019, p.30-31).
Pensons au psaume.
Le critère général de choix d’un psaume dans l’office est l’heure. La personne ne choisit pas le psaume, il est offert. Prenons le psaume 30(29) dans l’office du soir (ODC, p.52).
Le soir tombe, la nuit vient
la tristesse, les pleurs, la douleur,
le matin le soleil renaît,
nouveau jour, joie.
1. Seigneur, je dirai de toi de grandes choses,
Car tu m’as délivré et n’as pas permis
Que les méchants rient, se moquant de moi
2. Seigneur, vers toi j’ai crié et tu m’as guéri ;
Ma vie, du lieu où résident les morts,
Toi seul m’as tiré et m’as libéré !
3. Chantez, tous les saints, rendez gloire au Seigneur !
Sa colère est un instant et s’est vite terminée ;
Bonté, toute la vie l’amour perdure !
4. Sûr, je disais : Jamais je ne tremblerai !
Faveur, tu m’as couvert d’honneur et de pouvoir.
Tu as caché ton visage et j’ai été terrifié…
5. Pitié, mon Dieu, je suis en train d’implorer…
Y aura-t-il un avantage, par hasard, dans la mort ?…
La poussière de mes os te louera-t-elle ?…
6. Seigneur, pitié, viens me secourir !
Ma douleur et mes pleurs tu as changés en plaisir ;
Ton nom pour toujours je bénirai !
Le psaume est là, avec des paroles en version populaire en parfaite symbiose avec la mélodie. Tout en lui pointe vers la fin d’une journée de travail et de lutte. Il parle de la tristesse de la nuit qui arrive, mais promet la lumière d’un nouveau jour : Le soir tombe, la nuit vient, la tristesse, les pleurs, la douleur, le matin le soleil renaît, nouveau jour, joie. En chantant les strophes, la personne trouve l’expression de sa gratitude pour la journée passée, pour les luttes surmontées, pour la fermeté malgré les difficultés. La gratitude qui est déjà dans son cœur, parfois étouffée par la fatigue, est réveillée par les paroles du psaume. La personne s’identifie au psaume comme si elle l’avait elle-même engendré (cf. CASSIEN, 2003, p.984).
En trouvant dans le psaume l’expression de sa propre action de grâce, on s’unit à l’action de grâce du Fils, qui a fait de toute sa vie une offrande de louange. Comment ne pas entendre la voix du Christ quand on chante : Ma vie, du lieu où résident les morts, Toi seul m’as tiré et m’as libéré (strophe 2). Là, la voix de celui qui prie et la voix du Christ ne font plus qu’une. Par conséquent, « ce n’est pas moi qui fais quelque chose avec la parole, mais c’est la parole qui fait quelque chose avec moi » (GRÜN, 2019, p.32), la parole qui est le Christ, change la voix de celui qui psalmodie en sa propre voix, l’Esprit qui renouvelle toutes choses le transforme en ce qu’il est en train de prier.
4 Un mot pour finir
Dans le scénario actuel de l’Église, de manière générale, la messe, propre au dimanche, qui par tradition est le sommet de toutes les actions liturgiques, semble être devenue l’unique célébration de l’Église : répétée tous les jours, partout et, souvent, n’importe comment, quand elle n’est pas instrumentalisée à des fins douteuses. À côté de la messe, il y a le chapelet, la dévotion aux saints, l’adoration du Saint-Sacrement, sans parler de l’avalanche de pratiques d’un catholicisme conservateur, qui n’a rien à voir avec la piété populaire. La célébration même de la Parole ne se configure pas comme une partie organique de la liturgie de l’Église, occupant tout au plus une place de suppléance (par manque de prêtre). L’Office Divin n’apparaît même pas dans les planifications pastorales des Églises et des paroisses. Et pourtant, il pourrait bien être une alternative de célébration pour la communauté chrétienne, la plus immédiate après la messe. L’Office des Communautés s’offre comme une source sur le chemin, enracinée dans la tradition des pères et mères de l’Église, avec une manière bien brésilienne, et fidèle à l’ecclésiologie latino-américaine. Il ne s’impose pas comme une obligation, ou comme une forme exclusive, mais s’offre gratuitement aux communautés qui vivent la foi au milieu des luttes de chaque jour et aspirent à nourrir leur vie spirituelle.
Penha Carpanedo, PDDM. Texte original en portugais. Posté en février 2020.
Références
AUGÉ, Matias. Ano litúrgico: é o próprio Cristo presente na sua Igreja. São Paulo: Paulinas, 2019. Fonte Viva.
BARROS de SOUZA, Marcelo. Caminhada popular e Ofício Divino. Revista de Liturgia, São Paulo, v.15, n.86, p.30-36, mar/abr 1988.
______. Descolonizar a oração da igreja. Revista de Liturgia, São Paulo, v.21, n.124, p.27-32, jul/ ago 1994.
BASILIO DE CESAREIA. O Espírito Santo. In: Antologia Litúrgica: textos litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro milênio. Fátima: Secretariado Nacional de Liturgia, 2003.
CASSIANO, João. Conferência X, sobre a oração. In: Antologia Litúrgica: textos litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro milênio. Fátima: Secretariado Nacional de Liturgia, 2003.
CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Diretório sobre Piedade Popular e Liturgia; princípios e orientações. São Paulo: Paulinas, 2003, n.29.
CNBB. Adaptar a Liturgia, tarefa da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1984.
ELBERTI, Arturo. Canto di Lodi per tuti i suoi fedeli. Milano: San Pablo, 2011.
ETÉRIA. Peregrinação de Etéria: Liturgia e catequese em Jerusalém no século IV. Petrópolis: Vozes, 1977.
GARCIA LÓPES-TELLO, Eduardo. La liturgia monástica dele ore: verso una sacramentalitá del verbo visibile. Roma: Edizioni liturgiche, 2015.
GRÜN, Anselm. Liturgia das Horas e contemplação. Petrópolis: Vozes, 2019.
INSTRUÇÃO GERAL SOBRE A LITURGIA DAS HORAS (IGLH). Comentários de Aldazábal. São Paulo: Paulinas, 2010.
JOIN-LAMBERT, Arnaud. La Liturgie des Heures par tous les baptisés: l’expérience quotidienne du mystère pascal. Leuven: Peeters, 2009. Liturgia Condenda.
LEITE BASTOS, Geraldo. Entrevista. Revista de Liturgia, São Paulo, n.86, mar/abr 1988.
LIBANIO, João Batista. Cenários da Igreja. São Paulo: Loyola, 2001.
LIMA, Danilo César dos Santos. A sacramentalidade e o caráter celebrativo do Ofício Divino das Comunidades no Brasil. Roma: Thesis ad Licentiam in Sacra Liturgia – Pontificium Athenaeum S. Anselmi de Urbe, 2010.
OFÍCIO DIVINO DAS COMUNIDADES (ODC). 3.ed. São Paulo: Paulus, 2018.
PEREIRA SILVA, Jeronimo. Semana de estudo sobre a liturgia das Horas. Revista de Liturgia, n.252, nov/dez 2015.
PINELL, Jordi. Liturgia delle ore. Genova-Milão: Casa Editrice Marietti, 2005. Anàmnesis, 5.
PAULO VI. Constituição Apostólica “Laudis Canticum”. In: Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas. Comentários de José Aldazabal. São Paulo: Paulinas, 2010.
TAFT, Robert. Oltre l’oriente e l’occidente: per una tradizione liturgica viva. Roma: Lipa Edizioni, 1999.