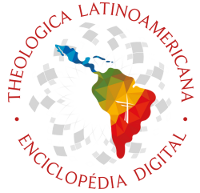Sommaire
1 Réalité actuelle de l’eucharistie
2 Valorisation par le magistère
3 Sacrement principal
4 Noms
5 La doctrine fondamentale
5.1 Instituée par le Christ lors de la dernière Cène
5.2 Mémorial de la Cène
5.3 Mémorial du sacrifice
5.4 La présence réelle du Christ
5.5 Transsubstantiation
5.6 La question des espèces et la formule essentielle
6 L’eucharistie et l’Église
7 La célébration, en synthèse
Références
1 Réalité actuelle de l’eucharistie
L’eucharistie, en tant que principale célébration liturgique de l’Église, subit à notre époque les mêmes tensions et contradictions que la foi chrétienne dans les sociétés contemporaines. Cela n’est pas étrange, car elle célèbre précisément la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité dans la vie actuelle de l’humanité et de chaque croyant. La liturgie est sensible aux changements dans le monde et dans l’Église, car elle n’est pas célébrée dans des espaces et des temps abstraits, mais dans les contextes humains, culturels et ecclésiaux concrets de chaque croyant et de chaque communauté. En général, on peut dire qu’au cours de la dernière décennie, un grand nombre de catholiques ont cessé de participer à l’eucharistie dominicale et de pratiquer la vie sacramentelle. En général, ce sont ceux dont la relation avec l’Église reposait surtout sur la réception des sacrements et la participation aux funérailles et aux grandes fêtes chrétiennes de l’année liturgique ou des sanctuaires. Les communautés ecclésiales de base, les chapelles de quartiers plus homogènes ou les secteurs ruraux, en revanche, tendent à maintenir une praxis de célébration plus vivante et régulière. Mais elles aussi, très fréquemment, ont ressenti l’éloignement des jeunes et la difficulté d’engager des laïcs, hommes et femmes, dans les divers rôles liturgiques liés à l’eucharistie : chorales, lecteurs, acolytes. La crise résultant des abus de pouvoir, de conscience et sexuels de membres du clergé, qui ces dernières années a été largement diffusée et a fortement affecté l’Église dans de nombreux pays du continent, a été un facteur qui, pour de nombreux catholiques ayant une appartenance plus fragile à l’Église et/ou une formation plus superficielle, les conduit à cesser pratiquement toute participation, à commencer par l’eucharistie dominicale.
Certes, la réalité de la célébration de l’eucharistie est trop vaste et diverse pour être résumée ou généralisée en quelques lignes. D’un côté, il y a des communautés avec des célébrations très vivantes et participatives, et de l’autre, des églises où le nombre de fidèles qui vont à la messe dominicale a considérablement diminué, tandis que l’âge moyen des participants a augmenté avec la même radicalité. Les plans pastoraux diocésains, le charisme des curés ou des prêtres qui président l’eucharistie, la formation des laïcs, hommes et femmes, et la tradition de l’Église locale sont déterminants pour la qualité de la vie liturgique et, en particulier, des célébrations eucharistiques. Les grandes différences dans ces aspects déterminent également, en grande partie, les différences de qualité, de participation et de vivacité des messes.
Ce regard réaliste, qui ne se veut pas pessimiste, est nécessaire au début d’un traitement doctrinal de l’eucharistie, car nous, catholiques, nous plaçons ce sacrement au plus haut rang de la vie liturgique de l’Église et nous ne cessons de proclamer sa centralité et son importance. Pour beaucoup, il peut sembler que ces affirmations ne correspondent pas à la réalité du moment et, à vrai dire, ils n’auraient pas tort. D’un autre côté, l’Église peut-elle renoncer à affirmer et à enseigner l’importance et la centralité de l’eucharistie, sans affecter par là le cœur même de sa praxis liturgico-sacramentelle ?
2 Valorisation par le magistère
Le magistère de l’Église continue de placer l’eucharistie à une place éminente dans sa pratique cultuelle. Le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) réaffirme que l’eucharistie est « la source et le sommet de toute la vie chrétienne », citant Lumen Gentium n.11 (CEC n.1324) ; qu’elle « contient tout le bien spirituel de l’Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque », citant Presbyterorum ordinis n.5 (CEC n.1325), et termine en affirmant que « l’eucharistie est le résumé et la somme de notre foi » (CEC n.1327).
Auparavant, la constitution sur la liturgie du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium (SC), affirmait que la liturgie, dont l’eucharistie est l’expression maximale, est « le sommet vers lequel tend l’activité de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa force » (SC n.10).
Le pape saint Jean-Paul II a consacré des pages importantes à l’eucharistie dans son magistère, parmi lesquelles se distingue sa dernière lettre encyclique, en 2003, Ecclesia de Eucharistia (EdE). On y trouve des passages de témoignage d’une grande profondeur, comme celui qui dit : « Voici (dans l’eucharistie) le trésor de l’Église, le cœur du monde, le gage de la fin à laquelle tout homme, même inconsciemment, aspire. Un grand mystère, qui nous dépasse certainement et met à l’épreuve la capacité de notre esprit à aller au-delà des apparences » (EdE n.59).
Le pape émérite Benoît XVI a également écrit sur l’eucharistie. Son exhortation apostolique Sacramentum caritatis (SC), de 2007, est particulièrement importante ; il y intègre la réflexion du Synode des Évêques de 2005, dont le thème était précisément l’eucharistie.
Le magistère du pape François, à son tour, offre un grand nombre de catéchèses, d’homélies et de phrases sur l’eucharistie. Dans la catéchèse du 8 novembre 2017, François rappelle l’épisode ancien et impressionnant des martyrs d’Abitène :
Nous ne pouvons pas oublier le grand nombre de chrétiens qui, dans le monde entier, en deux mille ans d’histoire, ont résisté jusqu’à la mort pour défendre l’Eucharistie ; et combien, encore aujourd’hui, risquent leur vie pour participer à la Messe dominicale. En l’an 304, pendant les persécutions de Dioclétien, un groupe de chrétiens d’Afrique du Nord fut surpris en train de célébrer la Messe dans une maison et fut emprisonné. Le proconsul romain, lors de l’interrogatoire, leur demanda pourquoi ils l’avaient fait, sachant que c’était absolument interdit. Et ils répondirent : « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre », ce qui signifiait : si nous ne pouvons pas célébrer l’Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre, notre vie chrétienne mourrait. En effet, Jésus a dit à ses disciples : « si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’aurez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 53-54). Ces chrétiens d’Afrique du Nord ont été assassinés parce qu’ils célébraient l’Eucharistie. Ils ont laissé le témoignage que l’on peut renoncer à la vie terrestre pour l’Eucharistie, car elle nous donne la vie éternelle, nous rendant participants de la victoire du Christ sur la mort. Un témoignage qui nous interpelle tous et exige une réponse sur ce que signifie pour chacun de nous de participer au Sacrifice de la Messe et de nous approcher de la Table du Seigneur. (FRANÇOIS, 2017)
La question du Pape François est essentielle de nos jours : que signifie l’eucharistie pour nous aujourd’hui ? S’il y a eu des moments où il n’était pas nécessaire de poser une telle question, ce ne sont pas ceux que nous vivons. Certes, pour apprécier l’eucharistie, il ne suffit pas d’en savoir plus sur elle. Si la connaissance n’est pas en lien vital avec toute la vie de foi, elle est de peu d’utilité. Elle peut nous rendre plus sages, mais elle n’aide pas à mieux célébrer notre foi. L’eucharistie est avant tout une expérience. Une expérience de célébration, festive, qui naît de la gratuité d’être chrétien. Nous pouvons en savoir beaucoup sur elle, mais pour qu’elle acquière son sens plein en tant que sacrement de l’Église, elle doit être expérimentée, vécue et célébrée dans la communauté des fidèles. C’est dans cette perspective que l’on tente ici de synthétiser sa doctrine fondamentale.
3 Sacrement principal
La liturgie et les ministères de l’Église sont orientés vers l’eucharistie. « Les autres sacrements », affirme le CEC n.1324, « ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les œuvres d’apostolat, sont unis à l’eucharistie et lui sont ordonnés ». Sa centralité dans l’Église catholique est claire et bien fondée dans la praxis et la doctrine de son histoire. C’est pourquoi il est nécessaire de connaître ces fondements en ces temps où la formation catéchétique de l’Église est souvent faible et rare.
L’eucharistie est le principal des sept sacrements. Dans le monde sacramentel, elle est ordonnée avec l’ensemble des sacrements de l’initiation chrétienne, avec le baptême et la confirmation. La triade baptême-confirmation-eucharistie fut, durant les premiers siècles du christianisme, la porte d’entrée de la communauté chrétienne, comme une célébration sacramentelle unique et simultanée, dont l’eucharistie était le point culminant. Très tard dans l’histoire de l’Église, seulement au début du XXe siècle, la coutume d’anticiper l’eucharistie pour les plus jeunes s’est généralisée, modifiant ainsi l’ordre traditionnel dans lequel les sacrements d’initiation étaient administrés : 1-baptême, 2-confirmation et 3-eucharistie ; pour un nouvel ordre : 1-baptême, 2-eucharistie et 3-confirmation. Mais déjà auparavant, dans l’Église latine, la confirmation avait été séparée du baptême au moment de l’administration. La raison en est que, en Occident, contrairement aux communautés de l’Orient chrétien, l’évêque (et non le prêtre) fut institué comme ministre ordinaire (aujourd’hui nous l’appelons originel) de la confirmation. Les prêtres baptisaient les nouveau-nés et ce n’est que lorsque l’évêque visitait la localité, ou lorsque les enfants ou les jeunes pouvaient se rendre au siège épiscopal, qu’ils pouvaient être confirmés. Et souvent, des années s’écoulaient entre les deux sacrements. Mais même ainsi, l’eucharistie n’était reçue pour la première fois qu’à la confirmation, préservant ainsi l’ordre traditionnel : 1-baptême, 2-confirmation et 3-eucharistie et, par conséquent, on préservait le signe concret de l’eucharistie comme point culminant de l’initiation chrétienne.
Aujourd’hui, on considère qu’il est important de retrouver l’unité de ces trois sacrements, théologiquement et pastoralement liés et interdépendants. Puisque dans les Églises latines cette unité ne peut être temporelle – la coutume et certains avantages pastoraux d’administrer d’abord la première eucharistie puis la confirmation sont très ancrés – on essaie qu’elle soit au moins claire sur les plans catéchétique et liturgique : dans la formation et dans le rituel. Considérer l’eucharistie comme le point culminant de l’initiation chrétienne ne peut être affirmé que théoriquement, car le signe établit comme point culminant (au moins temporellement) le sacrement de la confirmation.
Le baptême et la confirmation impriment un caractère, c’est-à-dire que ce sont des sacrements que l’on ne reçoit qu’une seule fois dans la vie, car ils laissent une marque spirituelle indélébile sur celui qui les a reçus. L’eucharistie, à son tour, est le sacrement du cheminement chrétien : elle est reçue autant de fois que nécessaire, comme nourriture pour vivre l’union personnelle avec le Christ et le discipulat. C’est le sacrement du voyageur, du pèlerin qui désire vivre sa foi à la suite et dans la fidélité à la mission confiée. Dans l’homélie du Corpus Christi de 2015, le pape François a affirmé que « l’eucharistie n’est pas une récompense pour les bons, mais une force pour les faibles ; pour les pécheurs, c’est le pardon, le viatique qui nous aide à avancer, à marcher ». Image profonde et réaliste : la communion eucharistique ne peut être une récompense pour les mérites qu’un chrétien possède, mais elle est précisément la nourriture dont il a besoin dans sa fragilité et sa vulnérabilité pour vivre et témoigner de sa foi dans le monde complexe d’aujourd’hui.
4 Noms
L’eucharistie a reçu plusieurs noms au cours de l’histoire. Chacun d’eux met en évidence un aspect de son contenu théologique ou de sa forme de célébration. Le CEC les énumère de manière plus complète aux numéros 1328 à 1332. Trois d’entre eux sont particulièrement importants :
Fraction du pain. Cette expression se trouve dans les Actes 2, 42-46, dans le contexte de la description de la première communauté chrétienne, et dans les Actes 20, 7-11, dans un contexte que l’on peut qualifier de liturgique, d’une assemblée le « premier jour de la semaine » (Dimanche, Jour du Seigneur), avec un long discours (homélie) de saint Paul. L’expression « fraction du pain » se réfère directement à une action propre à l’eucharistie, qui est de rompre le pain pour le distribuer, mais elle a ses racines dans une coutume juive beaucoup plus ancienne : celle du père de famille qui, après avoir béni la table, rompait et partageait le pain pour les siens. Lors du repas de la Pâque juive, qui est l’antécédent immédiat de l’eucharistie, ce geste était particulièrement significatif.
Cène du Seigneur. En 1Co 11,20, saint Paul utilise cette expression pour distinguer le repas fraternel qui précédait la « Cène du Seigneur » (l’eucharistie) dans les premières communautés chrétiennes. Dans la communauté de Corinthe, les repas précédents étaient le théâtre d’excès et de mépris envers les plus pauvres, ce qui motive la critique de Paul. Bien que cela ne se reproduise pas dans la Cène du Seigneur elle-même, sa proximité avec elle doit les rendre cohérents avec l’esprit chrétien de fraternité, de solidarité et d’estime pour les plus pauvres.
Eucharistie. Ce nom se trouve, sous sa forme verbale, rendre grâces, dans Lc 22,19 : « prit le pain, rendit grâces (…) » et en 1Co 11,24 : « prit le pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit (…) ». Le terme bénir, utilisé en Mc 14,22 et Mt 26,26, est très proche : « Il prit du pain, et, après avoir récité la bénédiction, il le rompit (…) ». Étant donné que l’action de grâce et la bénédiction sont des actions inhérentes à la liturgie chrétienne, et qu’elles se manifestent avec une clarté particulière dans l’eucharistie, c’est le terme que la liturgie actuelle a privilégié par rapport aux autres.
Messe ? Bien que l’expression « messe » continue d’être utilisée dans le langage familier et pastoral en portugais, en espagnol et dans d’autres langues, c’est un terme qui a cessé d’être utilisé dans le langage théologique en raison de sa faible relation avec tout aspect central de l’eucharistie. Son origine se trouve au Moyen Âge, dans la formule de renvoi des fidèles à la fin de l’eucharistie : « Ite, missa est » (littéralement, « allez, elle est envoyée », se référant implicitement à la célébration). À partir de là, par métonymie, l’eucharistie a commencé à être appelée « messe ».
5 La doctrine fondamentale
5.1 Instituée par le Christ lors de la dernière Cène
La tradition chrétienne, basée sur le Nouveau Testament, affirme que l’eucharistie a été instituée par Jésus-Christ lors de la cène qu’il a célébrée avec ses apôtres la nuit avant sa passion. Les textes fondamentaux sont Mt 26,26-29 ; Mc 14,22-25 ; Lc 22,19-20 ; 1Co 11,23-25. Ils transmettent, avec de légères variations, le récit de l’institution qui constitue encore aujourd’hui la partie centrale des Prières eucharistiques. Jn 13,1-15 est également fondamental, il relate le lavement des pieds que Jésus a fait pendant la cène, considéré comme un signe dont le contenu et la signification sont parallèles et analogues à ceux de la fraction du pain : le don radical de sa vie au service de l’humanité. Il dit que le Seigneur, ayant aimé les siens, les aima jusqu’à la fin. Sachant que l’heure était venue de quitter ce monde pour retourner vers son Père, pendant le souper, il lava les pieds des apôtres et leur laissa le commandement de l’amour comme mission. C’est le même contenu de l’offrande du pain rompu et du vin partagé, signes du don radical de Jésus aux siens, que ses disciples doivent imiter en sa mémoire.
Lors de la cène, Jésus a donné à la Pâque, la principale fête juive, sa « signification définitive » (CEC n.1340). « Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique, (…) banquet pascal où l’on reçoit le Christ, où l’âme est comblée de grâce et où nous est accordé le gage de la gloire future » (SC n.47).
Pour leur laisser un gage de cet amour, pour ne jamais s’éloigner des siens et pour les faire participer à sa Pâque, il institua l’eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection et ordonna à ses apôtres (« ceux qu’il constituait prêtres du Nouveau Testament », Concile de Trente, Denziger-Hünermann (DH), n.1740) de faire de même « en sa mémoire » (Lc 22,19 et 1Co 11,24). Eucharistie et sacerdoce ministériel sont deux thèmes que la tradition catholique a maintenus essentiellement liés.
En parlant de l’institution de l’eucharistie, il est nécessaire de se référer à la compréhension contemporaine de l’« institution » : ce n’est pas seulement le moment fondateur d’un sacrement, mais surtout la volonté de Jésus de sauver par certains signes rituels où Il continue lui-même d’agir par l’Esprit Saint, à travers des ministres qui le font en son nom et à sa place. C’est-à-dire que l’institution n’est pas seulement une action du passé historique, mais un effet permanent de celle-ci, chaque fois que le sacrement – dans ce cas, l’eucharistie – est à nouveau célébré : là se trouve Jésus-Christ, maintenant ressuscité et glorieux, présidant chaque assemblée qui célèbre sa foi.
5.2 Mémorial de la Cène
L’eucharistie est un « mémorial » : « Faites ceci en mémoire (commémoration) de moi ». Ce concept est fondamental dans la compréhension sacramentelle contemporaine. Il nous permet de mieux comprendre le mystère de la présence et de l’actualisation de l’œuvre salvifique du Christ dans la liturgie, et spécialement dans l’eucharistie. Ce n’est pas une simple mémoire subjective individuelle, mais une action rituelle et ecclésiale qui rend actuelle et présente la force libératrice des actions de Jésus. L’eucharistie est donc le mémorial du mystère pascal du Christ : non seulement elle évoque ou rappelle, mais elle apporte aussi, d’une certaine manière, ici et maintenant, l’œuvre de salut accomplie par sa vie, sa mort et sa résurrection. Cette œuvre devient présente et actuelle à travers l’action liturgique célébrée par l’Église.
Les rites et les paroles constituent la « matière première » du monde sacramentel chrétien et, en particulier, de l’eucharistie. Ces rites, qui sont des actions symboliques réalisées par les fidèles dans des lieux et avec des objets significatifs, et accompagnés de paroles également significatives, parlées ou chantées, sont les éléments de base de toute célébration liturgique. Dans l’histoire de l’eucharistie, le champ significatif s’est étendu, au-delà des rites et des paroles, à l’édifice dans lequel elle est célébrée, dont le centre visuel et rituel est occupé par l’autel, accompagné de l’ambon de la Parole, à d’autres lieux significatifs en son sein (fonts baptismaux, tabernacle, siège, lieu de pénitence, images), et aux vêtements des ministres. Tous ces signes sont des éléments qui « parlent », communiquant un sens qui dépasse la simple compréhension rationnelle et engage tout l’être de ceux qui forment l’assemblée qui célèbre sa foi. Dans l’« édifice-église », se déroule la « Cène du Seigneur », qui dans sa forme rituelle évoque la cène de Jésus avec ses disciples avant sa passion et sa mort. La table (nourriture) et la parole (communication) sont aussi les éléments centraux de tout repas convivial.
L’eucharistie est le mémorial de l’unique cène historique que Jésus a célébrée avec ses disciples avant de souffrir. Tant la dernière cène narrée par les Évangiles, que la passion, la mort et la résurrection de Jésus, survenues immédiatement après, n’ont eu lieu qu’une seule fois dans l’histoire (ephapax). Ce qui a été donné temporellement a été donné une fois pour toutes ; sacramentellement, par l’œuvre de l’Esprit Saint, il peut être réalisé « en sa mémoire » toutes les fois et en tout lieu où un groupe de chrétiens veut célébrer sa foi, « jusqu’à ce qu’Il vienne » (1Co 11,26), actualisant hic et nunc (ici et maintenant) le salut survenu dans le mystère pascal. Ainsi, chaque eucharistie dans l’histoire participe, sacramentellement, à l’unique cène du passé temporel par l’œuvre de l’Esprit Saint. Chaque eucharistie est un mémorial ou une commémoration de la dernière cène.
5.3 Mémorial du sacrifice
SC n. 47 affirme : « Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le Sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer au long des siècles, jusqu’à son retour, le sacrifice de la croix (…) ».
De même qu’elle est un mémorial de la cène, l’eucharistie est aussi un mémorial de l’unique sacrifice historique du Christ sur la croix. Cela s’exprime communément en disant simplement que l’eucharistie est un sacrifice. Mais cette expression peut susciter des interprétations erronées. Comme pour la cène, quand on dit que l’eucharistie est un sacrifice, on ne l’affirme pas au sens historique, car historiquement Jésus n’est mort qu’une seule fois sur la croix, mais au sens sacramentel ou mémorial : l’eucharistie est le « sacrement du sacrifice (de la croix) ». Cependant, cela n’explique pas pourquoi ou en quel sens la croix elle-même, c’est-à-dire la mort historique de Jésus-Christ crucifié, est un sacrifice. Le livre biblique qui développe cette idée est la lettre aux Hébreux (He 7,26-27 ; 10,1-14), affirmant que le Christ est l’unique prêtre qui offre un unique sacrifice (en s’offrant sur la croix), une fois pour toutes. C’est-à-dire que le sacrifice est accompli par Jésus qui s’offre lui-même. D’où l’expression qu’il est « prêtre, victime et autel ». En dehors de la Bible, la Didachè, un écrit contemporain des derniers livres du Nouveau Testament, est le premier écrit à parler de l’eucharistie comme d’un « sacrifice ».
L’eucharistie n’est pas un « sacrifice » au sens usuel du terme, c’est-à-dire une offrande faite à Dieu pour attirer une faveur, expier une faute ou se purifier. Le Dieu de Jésus-Christ n’a pas besoin de sang ou de sacrifices humains – comme la terrible torture et la mort sur la croix – pour aimer et favoriser son peuple. Jésus ne s’est pas offert en sacrifice en ce sens. L’« agneau de Dieu », Jésus-Christ, qui évoque cet agneau sacrifié à chaque Pâque juive pour être mangé en famille, rappelant le repas rapide d’agneau rôti, de pain sans levain et d’herbes amères avant de partir pour l’exode, ne peut être compris comme une offrande présentée par l’être humain comme un sacrifice à Dieu, pour l’apaiser ou obtenir des faveurs.
D’autre part, la critique prophétique de l’Ancien Testament avait déjà averti que les sacrifices sanglants (d’animaux sacrifiés de différentes manières) ne plaisent pas à Dieu s’ils n’impliquent pas une vie quotidienne cohérente avec l’adoration. « Je veux la miséricorde, non les sacrifices », dit Osée 6,6, prophétisant contre l’adoration vide. Et Isaïe dit : « Je suis rassasié des holocaustes de béliers… et le sang des taureaux et des boucs ne me plaît pas. (…) Rechercher ce qui est juste, donner leurs droits aux opprimés, faire justice aux orphelins, défendre la cause de la veuve » (Is 1,11,17). Un sacrifice « spirituel », c’est-à-dire la prière croyante et l’amour du prochain, plaît plus à Dieu que les sacrifices matériels d’animaux.
Ce que Jésus a fait, c’est donner sa vie par amour extrême, radical, pour l’humanité, couronnant ainsi une vie et un ministère de service humble à l’humanité, représenté par le lavement des pieds que l’Évangile selon Jean place à la place de la Cène du Seigneur. Jésus ne voulait pas mourir de la manière qu’il entrevoyait : d’où sa prière poignante dans le jardin de Gethsémani. Son abandon à la volonté du Père est la conséquence d’une mission livrée à la mission de donner la vie, qui avec sa mort aurait son expression maximale, la résurrection des morts. Ce n’est que dans ce sens que l’on peut dire que la mort du Christ fut un sacrifice. Toute sa vie a été d’être du pain rompu/corps livré et du vin/sang versé pour son prochain. Dans le sacrifice de la croix culmine une attitude permanente de Jésus, qu’il a comprise comme essentielle dans la mission confiée par le Père : le dépouillement de lui-même en assumant la condition d’esclave (Ph 2,6-8), servant l’humanité jusqu’au don volontaire de sa propre vie.
Le caractère sacrificiel de l’eucharistie, toujours affirmé par la doctrine de l’Église catholique, avec une extrême force après que Luther et la Réforme du XVIe siècle l’aient nié, doit être compris comme une participation mémorielle au don volontaire et extrême de sa vie, accepté par Jésus-Christ comme conséquence de sa mission dans le monde. En même temps, et c’est là le vrai sens de la présentation des offrandes dans la célébration de l’eucharistie, l’assemblée actualise le sens sacrificiel de sa propre vie chrétienne, c’est-à-dire qu’elle s’offre comme instrument de l’amour de Dieu pour l’humanité, et s’engage à perpétuer la mission du Christ d’annoncer et de rendre présent le Royaume de Dieu dans le monde.
L’eucharistie est un sacrifice dans cet horizon. Dans la mesure où elle est un don reçu de Dieu, l’eucharistie est le mémorial de son amour extrême et, dans la mesure où elle est une offrande à Dieu, elle est un sacrifice : non pas pour obtenir quelque chose de lui, mais pour donner sa propre vie pour son Royaume, comme Jésus.
5.4 La présence réelle du Christ
L’Église a toujours affirmé que, dans les espèces « eucharistiées » du pain et du vin, le Christ est présent. La base biblique fondamentale sont les paroles de Jésus dans les récits de l’institution : « Ceci est mon corps … ceci est mon sang » (Mt 26,26-28). La foi en la présence du Christ dans la célébration et dans les espèces eucharistiques est présente dès le début de la formation de la liturgie chrétienne.
Vint ensuite, dans le développement historique de l’eucharistie, la vénération des espèces, principalement du pain, lorsque des morceaux restaient après la célébration. Ils étaient conservés avec respect pour être distribués aux malades ou à ceux qui ne pouvaient pas participer à l’eucharistie et, plus tard, ils sont devenus un objet de dévotion et ont été conservés dans des tabernacles spécialement conçus à cet effet. Enfin, parallèlement à la perte du sens de la communion eucharistique, lorsque personne ou très peu de gens s’approchaient pour communier, l’adoration du pain consacré s’est développée plus intensément comme une liturgie propre et indépendante de la célébration de l’eucharistie, et la construction des autels baroques, qui exaltaient souvent l’ostensoir pour l’adoration dans des retables exubérants qui occupaient toute la largeur et la hauteur de l’abside des églises.
La présence du Christ dans l’eucharistie est une doctrine ferme de l’Église catholique, que les grandes Églises réformées partagent également, bien qu’avec des nuances différentes dans leur interprétation. Le Concile de Trente a formulé dogmatiquement cette affirmation en disant que sous les espèces consacrées, le Christ lui-même, vivant et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et substantielle, avec son Corps, son Sang, son âme et sa divinité (DH n.1640, 1651) .
Cependant, la présence réelle du Christ dans l’eucharistie n’a jamais été facile à comprendre rationnellement ; encore moins pour la mentalité technico-scientifique contemporaine. On perçoit avec une grande clarté, comme pour toutes les vérités chrétiennes fondamentales, que ce n’est que par la foi qu’elle peut être acceptée. La question de savoir comment cela peut se produire a toujours accompagné les chrétiens.
5.5 La transsubstantiation
Ce fut la difficulté permanente à comprendre rationnellement l’affirmation que le pain et le vin consacrés sont le corps et le sang du Christ – alors que le bon sens et l’évidence des sens de la vue, de l’odorat, du goût et du toucher disent qu’il n’y a que du pain et du vin – qui a conduit, dès la fin du Moyen Âge, à des réflexions complexes et des discussions ardues sur la manière dont s’opère le changement dans les espèces. Le résultat fut la théorie finalement acceptée par l’Église catholique : la doctrine de la transsubstantiation (DH n.1642).
Selon elle, dans le récit de l’institution, se produit la transsubstantiation du pain et du vin en le Corps et le Sang du Christ. La doctrine explique qu’il se produit un changement de substance, ou d’essence, du pain et du vin, qui deviennent le Corps et le Sang du Christ, mais sans changer leurs accidents de pain et de vin (apparence, poids, couleur, saveur, odeur et texture), de sorte que, bien qu’ils conservent les caractéristiques du pain et du vin, ils ont changé d’essence, étant désormais, véritablement, celle du Corps et du Sang du Christ.
La doctrine de la transsubstantiation continue d’être une explication plausible de la manière dont se produit la transformation du pain et du vin en le Corps et le Sang du Christ, mais elle a été complétée ou élargie par d’autres contributions à l’époque contemporaine, qui critiquent sa concentration sur ce qui arrive à l’espèce sans considérer un facteur essentiel de l’eucharistie : sa signification et sa finalité ; c’est-à-dire qu’ils affirment que la doctrine de la transsubstantiation considère les espèces de manière statique et postulent que la transformation des espèces doit être comprise de manière dynamique et en accord avec la signification du sacrement de l’eucharistie : nourriture spirituelle, force pour la vie ecclésiale. D’où les noms de ces théories : transsignification et transfinalisation.
La seconde est particulièrement intéressante, car Jésus, lors de la dernière cène, ne s’est pas contenté de dire : « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » ; au lieu de cela, il a fait les gestes et prononcé ces paroles dans un but précis : distribuer cette nourriture et cette boisson aux convives pour qu’elles soient aussi consommées par eux. C’est-à-dire : à l’affirmation que ce pain est son Corps et que ce vin est son Sang, sa consommation lors de la cène festive et fraternelle appartient théologiquement et rituellement, comme une unique action liturgique. Et, de plus, cette consommation vise à nourrir la vie intérieure et la fidélité à la suite du Christ de la part de celui qui le fait, non seulement individuellement, mais en tant qu’Église, Corps du Christ. Il ne suffit pas de considérer la transsubstantiation en soi, sans la lier à sa finalité. C’est pourquoi il ne pourrait y avoir d’eucharistie où seul le prêtre célébrant communierait, puisqu’elle est célébrée pour la communion eucharistique, bien qu’une partie des espèces soit conservée pour être distribuée ultérieurement ou pour l’adoration eucharistique.
5.6 La question des espèces et la formule essentielle
Le pain de farine de blé fait sur le moment et le vin naturel, de raisin, non corrompu, sont la « matière » du sacrement. Un peu d’eau doit être mélangée au vin. Le Code de Droit Canonique spécifie que « selon l’antique tradition de l’Église latine, le prêtre utilisera du pain azyme, où qu’il célèbre » (CIC n.926 §1). Le pain azyme est le pain fait sans levain. Les rites orientaux utilisent généralement du pain levé pour l’eucharistie.
La communion, selon l’Introduction à la dernière édition du Missel Romain (2002), peut être offerte en de nombreuses occasions sous les deux espèces (avec le pain et le vin), plus que par le passé. Mais la communion reste valide sous la seule espèce du pain et, si nécessaire, lorsque quelqu’un n’est pas en mesure d’avaler des solides, sous la seule espèce du vin. Plus que la validité, la vérité du signe conseille de communier habituellement sous les deux espèces, puisque cela a été fait par le Seigneur lors de la dernière cène et a été pratiqué ainsi pendant des siècles dans toutes les communautés chrétiennes.
Tous les sacrements ont une formule essentielle, à la proclamation de laquelle est liée leur validité et qui est traditionnellement très soignée par l’Église. Dans l’eucharistie, cette formule est considérée comme la Prière eucharistique complète, depuis le dialogue avant la Préface jusqu’à la doxologie avec l’Amen final. Le cœur de la prière est constitué par le récit de l’institution, qui ne correspond littéralement à aucun des récits bibliques mentionnés ci-dessus (Mt, Mc, Lc et 1Co), mais en contient l’essentiel : « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon Corps, qui sera livré pour vous. / Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon Sang, le Sang de l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. »
6 L’eucharistie et l’Église
Saint Paul affirme que les chrétiens sont le corps du Christ et que le Christ en est la tête (1Co 12,13-30). Cette image a une expression particulièrement intense dans la célébration de l’eucharistie. En elle, les fidèles se réunissent en tant qu’« assemblée » et s’identifient comme « l’Église » du Christ (église dérive du grec ecclesia, qui signifie à l’origine assemblée). Chaque fois qu’ils célèbrent l’eucharistie, les chrétiens se constituent en communauté de disciples qui poursuit la mission de Jésus dans l’histoire. Ils célèbrent ensemble en son nom et « en sa mémoire », présidés par le Christ lui-même, présent dans le ministre (SC n.7) et dans l’assemblée elle-même, qui est son Corps.
Toute la liturgie, et de manière très spéciale l’eucharistie, est « l’exercice du sacerdoce du Christ », selon l’expression de SC n.7. C’est là que se trouve la racine théologique de la participation active que la réforme de Vatican II a promue dans la liturgie. Le Christ tout entier, c’est-à-dire la Tête et le Corps, exerce son sacerdoce dans la célébration de l’eucharistie. Par conséquent, ce n’est pas le prêtre ministre seul ou isolé, mais lui avec toute l’assemblée, qui par le baptême a été constituée en « peuple sacerdotal » (1P 2,9), et chaque homme ou femme baptisé, en « prêtres, prophètes et rois » (Rituel du Baptême, prière de l’onction avec le chrême), ce qui les rend protagonistes de la liturgie par leur participation active, pleine, consciente et féconde (SC n.48). L’eucharistie, chaque fois qu’elle est célébrée, est une expression de toute l’Église, un signe historique de l’Église céleste.
La participation active des fidèles à la liturgie fut l’une des grandes conquêtes du Concile Vatican II. Depuis lors, on a voulu que les chrétiens n’assistent pas à l’eucharistie comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, conscients que dans l’eucharistie il y a une rencontre avec Jésus-Christ vivant et, en même temps, le comprenant autant que possible, ils y participent par l’intimité de la foi, par les rites et les prières, les services et les ministères, les chants et les gestes symboliques, dans la richesse de la célébration. Le renouveau des rites, des textes et des chants, et surtout les efforts d’inculturation ont facilité cet objectif, bien qu’aujourd’hui, comme on l’a déjà mentionné, l’eucharistie subisse d’autres menaces de nos sociétés sécularisées.
L’Église se nourrit de l’eucharistie : elle en vit parce que c’est le sacrement du chemin, du pèlerinage chrétien à travers les lumières et les ombres de la vie et de l’histoire, en poursuivant la mission de Jésus-Christ, pour la plénitude du Royaume. La relation entre l’eucharistie et l’Église met particulièrement l’accent sur la dimension sotériologique (relative au salut) et la dimension eschatologique (relative à la fin des temps), qui sont également intimement liées entre elles. Quand elle célèbre l’eucharistie, l’Église est une Église qui expérimente le salut et se nourrit pour être libératrice et, en même temps, en participant par avance à la liturgie céleste (SC n.8), elle est une Église de l’espérance.
Cela ne signifie pas que la vie des chrétiens se réduit à l’eucharistie ; cela signifie plutôt que, l’eucharistie étant le sommet et la source (LG n.11) de la vie de l’Église, c’est le moment où toute notre vie est offerte à Dieu et reçoit de lui la force de continuer son chemin. L’eucharistie suppose la vie et est pour la vie, tout comme elle suppose la foi et doit la fortifier. Tous les sacrements nourrissent la vie chrétienne, mais l’eucharistie le fait d’une manière unique, comme rencontre du croyant au centre de sa foi : Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que tous aient « la vie en abondance » (Jn 10,10).
La participation active à la célébration de l’eucharistie est un signe de maturité des chrétiens. Répondre aux dialogues avec le ministre qui préside, chanter dans la chorale, saluer ses voisins lors du rite de la paix et, surtout, communier font partie intégrante d’une bonne célébration de l’eucharistie. Ce sont des signes visibles que ce n’est pas une simple fête humaine, mais une rencontre personnelle et ecclésiale avec le Christ ressuscité et vivant dans l’humanité.
7 La célébration, en synthèse
La liturgie de l’eucharistie se développe selon une structure fondamentale qui s’est formée et consolidée très tôt et qui est conservée jusqu’à aujourd’hui. Elle comprend deux grands moments qui forment une unité de base, « un seul acte de culte » (SC n.56) : la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique. À elles sont associés les deux principaux centres significatifs de l’espace liturgique : l’autel et l’ambon, qui doivent toujours être uniques. C’est ainsi que nous parlons des « deux tables » : celle de la parole et celle de l’eucharistie. Ces deux grandes parties sont encadrées par les rites initiaux et les rites finaux. Au premier appartiennent l’acte pénitentiel et le chant du Gloire à Dieu ; au second, la bénédiction finale qui envoie l’assemblée vivre ce qui a été célébré.
La réforme liturgique du Concile Vatican II a souligné de manière marquante l’importance de la Sainte Écriture dans l’eucharistie et dans toute la liturgie de l’Église. Pour ce faire, elle a enrichi le cycle annuel précédent, qui se répétait chaque année et offrait beaucoup moins de passages bibliques et beaucoup de répétitions de certains d’entre eux, en planifiant un cycle de trois ans pour les dimanches et de deux ans pour les messes de la semaine (féries), avec une richesse beaucoup plus grande de passages bibliques dont le critère de sélection et de distribution était que celui qui célèbre l’eucharistie tous les dimanches, pendant les trois ans, ait une vision globale de toute la Sainte Écriture. Les cycles dominicaux (ou « années ») étaient appelés A, B et C, et chacun d’eux recevait la lecture d’un Évangile : Matthieu pour le cycle A, Marc et Jean pour le cycle B et Luc pour le C. Pour l’eucharistie dominicale, on a également établi des lectures de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Pour les eucharisties des féries, un cycle de deux ans a été établi, dénommé I (années impaires) et II (années paires), où l’Évangile se répète chaque année, mais la première lecture est différente les années impaires et paires. Tant en quantité que surtout en qualité (critères de sélection des textes), la Bible a, depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II, une présence digne de son statut de « table de la Parole », partie essentielle de l’eucharistie et non une simple préparation à la communion. En ce qui concerne la richesse biblique, qui doit être lue et accueillie comme parole vivante, c’est-à-dire comme illumination de la réalité de l’assemblée célébrante, la réforme demande aux prêtres de faire une homélie tous les dimanches et, si possible, à chaque eucharistie, et qu’elle soit basée sur la proclamation de la Parole de Dieu.
La célébration de l’eucharistie n’a pas été et ne peut être statique. En gardant le cœur témoigné par la Bible, spécialement tout le Nouveau Testament et la première praxis chrétienne, elle porte le destin de tout ce qui est humain : elle se développe, s’adapte, change au fil de l’histoire. La sclérose de ses normes ou l’inflexibilité pour les adapter aux cultures et aux groupes humains ne l’a qu’aliénée du Peuple de Dieu, qui a besoin de célébrer sa foi et de toujours trouver un moyen de le faire. Que cette forme maintienne toujours l’eucharistie à la première place, c’est la tâche permanente de l’Église d’être fidèle à Jésus, qui nous a demandé de faire cela « en sa mémoire ».
Guillermo Rosas, SSCC. Pontificia Universidad Católica de Chile. Texte original en espagnol. Posté le 30 décembre 2020.
Références
ALDAZÁBAL, J. La Eucaristía. Biblioteca Litúrgica 12. Barcelona: Centre de Pastoral litúrgica, 1999.
ARIAS R., Maximino. Eucaristía, presencia del Señor. CELAM, Colección de Textos básicos para Seminarios latino-americanos. v.IX 2-2. Bogotá, 1997.
BASURKO, X. Para comprender la Eucaristía. Estella: Verbo Divino, 1997.
BENTO XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis. 22 fév 2007.
BETZ, J. La Eucaristía, misterio central. In: FEINER, J.; LÖHRER, M. (eds). Mysterium salutis. v.IV/2. Madrid: 1975. p.186-310.
BOROBIO, D. Eucaristía, Sapientia Fidei 23. Madrid: BAC, 2000.
BROUARD, Maurice (dir.). Enciclopedia de la Eucaristía. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2004.
CONCÍLIO VATICANO II. Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. 1965.
D’ANNIBALE, Miguel Ángel. El misterio eucarístico. In: MANUAL DE LITURGIA del CELAM. v.III. Santafé de Bogotá, 2001. p.167-260.
FRANCISCO. Audiencia general 8 noviembre 2017. Disponible sur : http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171108_udienza-generale.html. Consulté le : 12 sep. 2020.
GERKEN, A. Teología de la Eucaristía. Madrid: Paulinas, 1991.
GESTEIRA, M. La eucaristía, misterio de comunión. Madri: Ediciones Cristiandad, 1983.
GONZÁLEZ, C. I. ’Bendijo el pan y lo partió (Mc 6,41): Tratado de Eucaristía. Conferencia del Episcopado Mexicano. México, 1999.
JUAN PABLO II. Carta encíclica Ecclesia de Eucharistia. 17 avr. 2003.
NOCKE, F.-J. Doctrina especial de los sacramentos. In: SCHNEIDER, T. Manual de teología dogmática. Barcelona: Herder, 1996.