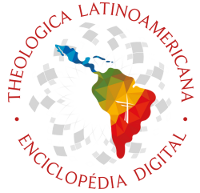Sommaire
1 Le mariage dans l’ensemble des 7 sacrements
1.1 La “différence” du premier / dernier sacrement
1.2 La logique paradoxale du mariage
1.3 Le mariage est-il un bien ?
1.4 L’histoire des sujets et le depositum fidei
2 Quatre modèles classiques de théologie du mariage
2.1 Le modèle des origines : mariage et patrimoine
2.2 La construction laborieuse d’un modèle médiéval : traditions romaines et barbares
2.3 Le modèle moderne : naissance de la forme canonique
2.4 L’ère séculière et la réaction catholique : résistance du pouvoir temporel
2.4.1 Arcanum Divinae Sapientiae, Léon XIII (1880) et Code de 1917
2.4.2 Casti Connubii, Pie XI (1930)
2.4.3 Gaudium et Spes, Concile Vatican II (1965)
2.4.4 Humanae Vitae, Paul VI (1968)
2.4.5 Familiaris Consortio, Jean-Paul II (1981)
2.4.6 Code de Droit Canonique (1983)
2.4.7 Amoris Laetitia, François (2016)
3 Le début d’un “nouveau paradigme” matrimonial, familial et relationnel
3.1 Une théologie postmoderne avec des schémas prémodernes
3.2 L’autocritique du magistère du XIXe siècle
3.3 De l’acte au processus : la dimension eschatologique du mariage
4 Les questions ouvertes sur l’union et la génération
4.1 Le caractère complexe du mariage
4.2 Les différents biens du mariage
4.3 Le débat sur l’indissolubilité
4.4 Loi objective et processus pastoral
4.5 Les formes de vie et les cinq continents du catholicisme
5 Le bien de la relation sexuelle et le “phénomène amour”
5.1 Les biens du mariage sont trois, voire quatre
5.2 La génération perd son exclusivité
5.3 De l’usage du sexe à l’expérience de la sexualité
5.4 Un seul bien peut-il être béni ?
5.5 Le centre et la périphérie : les différents langages de l’Église
Références
1 Le mariage dans l’ensemble des 7 sacrements
1.1 La “différence” du premier / dernier sacrement
Le mariage doit être compris à la fois comme une donnée naturelle, une construction sociale et un symbole rituel de la relation entre Dieu et l’humanité, entre le Christ et l’Église. En tant que tel, il apparaît, dès les premières listes des « sept sacrements » au XIIIe siècle, comme l’un d’entre eux. Il est surprenant, cependant, que même dans les listes les plus anciennes, la particularité du mariage présente des caractéristiques « polaires ». En effet, il est placé à la fin ou au début de la liste, car il représente à la fois le cas par excellence et le cas limite du phénomène sacramentel. Il est en tête ou à la fin de l’expérience sacramentelle. D’une part, en effet, il est le « dernier » des sacrements, car il « rend licite ce qui serait illicite » et peut être compris comme remedium concupiscentiae, c’est-à-dire comme remède à la concupiscence. D’autre part, les auteurs scolastiques eux-mêmes n’oublient pas que ratione significationis (c’est-à-dire « en raison de la signification ») le mariage est aussi le premier des sacrements : non seulement parce qu’il a été institué par Dieu avant la chute, mais parce qu’il exprime l’unité entre Dieu et l’humanité, entre le Christ et l’Église, avec une force et une immédiateté tout à fait inimitables. Ces deux « âmes » de la tradition ecclésiale se concentrent toutes deux sur deux célèbres expressions pauliniennes : le mariage comme « distraction » et comme « limitation de l’ardeur » (1Co 7) et le mariage comme voie d’accès au « grand mystère » de la relation entre le Christ et l’Église (Ep 5). Toute la tradition ecclésiale se meut entre ces deux pôles.
1.2 La logique paradoxale du mariage
Saint Thomas d’Aquin nous explicite, avec une clarté extrême, la nature complexe de ce sacrement. Dans la Somme Théologique (III, 65, 1, c), il présente un célèbre parallélisme entre la « vie naturelle » et la « vie spirituelle » et, après avoir illustré pour chaque sacrement son « équivalent naturel » (à la naissance correspond le baptême ; à la croissance, la confirmation, etc.), en arrivant au mariage, il dit que « cette réalité naturelle » est le sacrement. En revanche, dans la Somme contre les Gentils, il aborde le mariage en deux parties distinctes (III et IV) : la plus grande partie de ce qu’il écrit se trouve dans la section où la raison élabore les données, tandis que peu de lignes sont consacrées à la partie proprement « révélée » et sacramentelle (nous y reviendrons au paragraphe suivant). Ces deux exemples, dans l’œuvre de Thomas, confirment quelque chose d’important : dans le mariage, de manière très particulière, nature et grâce, raison et foi sont indissolublement liées. Cela signifie que l’assomption de la réalité, qu’elle soit naturelle ou civile, dans la logique du mariage est une condition de possibilité du sacrement. Ce n’est pas un hasard si ce n’est que pour ce sacrement qu’on dit qu’il n’est pas « institué par Jésus-Christ », mais qu’il est « élevé » au rang de sacrement, sa dynamique étant déjà assurée par la logique de la création, de la nature et des institutions civiles.
1.3 Le mariage est-il un bien ?
On sait que saint Augustin, dans son œuvre De bono coniugali [Sur le bien conjugal], a offert la première exposition d’une « doctrine matrimoniale », dans laquelle on note cependant une particularité qui attire l’attention. Bien que ce texte soit à la racine du discours chrétien et catholique sur les « biens du mariage », en réalité, la question fondamentale à laquelle répond le texte d’Augustin est celle de la compatibilité entre le mariage et la vie baptismale. La polarisation que nous avons déjà observée plus haut trouve ici un « lieu commun » : si la foi est une manière d’« épouser le Christ » – et cela vaut pour toute l’Église, masculine et féminine – est-il encore possible, licite ou conseillé pour les baptisés de se marier ? La question, qui a reçu des réponses majoritairement positives, conserve, ici et là au cours de l’histoire et dans les diverses traditions, la force de se traduire en différentes disciplines ou rôles sociaux. Pensons, par exemple, à la manière dont le mariage a différemment influé en Orient et en Occident sur les formes de vie des pasteurs (diacres, prêtres et évêques).
1.4 L’histoire des sujets et le depositum fidei
Les caractéristiques particulières du septième sacrement ont toujours dû servir de médiation entre la nature, l’histoire et la grâce. Pour cette raison, les grandes étapes de la théologie du mariage sont affectées par une relation très étroite entre les formes de vie (familiale, économique, culturelle) et leur interprétation par l’Église. Au moins jusqu’au XVe siècle, il était assez évident de confier à la nature et à la société l’articulation de cette expérience, que l’Église se limitait à bénir et à élever à la dignité de sacrement. Les changements dans l’histoire des institutions, dans la compréhension géographique du monde, dans les formes de production et dans la conscience subjective conduiront, à partir du XIXe siècle, à un changement progressif du modèle du mariage et de la famille. Et il sera surprenant d’observer comment le thème classique du « mariage » s’unira de plus en plus au nouveau thème de la « famille », ignoré par la doctrine ecclésiale pendant près de dix-neuf siècles. Cependant, il faut reconnaître que, précisément en raison de l’entrelacement très singulier des niveaux d’expérience et de connaissance, le mariage est l’objet d’une profonde reconsidération naturelle, sociale, psychologique et économique. À tous ces niveaux, la tradition théologique, après la tentative de résistance à tout prix, a été forcée de « traduire la tradition », comme cela s’était déjà produit au moins quatre fois au cours de l’histoire et comme, une fois de plus, l’ Amoris Laetitia (AL) l’exige clairement comme une tâche pour les prochaines décennies. Examinons donc quatre formes classiques d’approche de la théologie matrimoniale.
2 Quatre modèles classiques de théologie du mariage
2.1 Le modèle des origines : mariage et patrimoine
L’annonce de la plénitude de la relation entre l’homme et la femme, comme lieu de vérité de l’Alliance avec le Père céleste, qualifie la parole de Jésus (Mt 19, 1-9) et inaugure le dépassement de la « dureté de cœur ». Mais dès les paroles les plus anciennes, la présence de la « clause d’exception » – « sauf en cas de porneia » – ouvre un espace pour une élaboration ecclésiale de la parole du Maître, ce qui implique une médiation délicate entre les logiques naturelle, civile et ecclésiale. L’identification des destinataires de la parole – qui a été reçue comme une parole universelle, mais qui a des caractéristiques prophétiques et eschatologiques indiquant que ses premiers destinataires sont les disciples – peut être clarifiée en examinant la logique de l’ensemble du chap. 19 de l’Évangile selon Matthieu, où l’on passe du « mariage » (Mt 19, 3-9) au « patrimoine » (Mt 19, 16-30) : l’indissolubilité du lien personnel et l’absence de liens économiques sont annoncées dans le même texte, bien que la tradition se soit orientée à recevoir le premier comme une « norme de droit naturel » et le second comme un « conseil évangélique » (cf. BARBAGLIA, 2016). Le résultat est, d’une part, la valorisation symbolique de l’union sponsale et, d’autre part, une discipline de plus en plus précise des expériences des chrétiens. L’assomption de la réalité créaturelle (« les chrétiens se marient comme tout le monde », de l’ Épître à Diognète) ou le jugement sur la relation sur le plan juridique, prophétique ou eschatologique colorent différemment les premiers siècles de la réception de l’Évangile, jusqu’à la première systématisation par Augustin (Sur le bien conjugal).
2.2 La laborieuse construction d’un modèle médiéval : traditions romaines et barbares
L’évolution doctrinale et disciplinaire au Moyen Âge mérite une considération attentive (cf. CORTONI, 2021). En premier lieu, il apparaît comme une évidence que la doctrine du mariage, dans son unité, a dû servir de médiateur entre différentes traditions culturelles, juridiques et même « naturelles ». Il y a, en fait, une longue élaboration, qui s’étend sur plusieurs siècles, qui tente d’harmoniser la lecture du mariage comme « consentement » – typique de la tradition romaine – avec celle qui le comprend comme « coït » – typique des peuples venus du Nord à Rome. La synthèse, que le savoir théologique et juridique soutiendra dans les Universités de Paris et de Bologne à partir du XIIe siècle, offrira une puissante médiation historique, en combinant dans le même acte la « validité du consentement » et l’« indissolubilité par consommation ». La formule juridique, cependant, cache la présence, dans la dynamique du sacrement, de divers niveaux d’expérience, dont la composition est en permanence confiée aussi à la médiation de la nature et de la culture civile et ne peut être simplement anticipée par l’Église.
Il est donc extrêmement utile d’analyser attentivement l’une des grandes synthèses du savoir médiéval sur le mariage, telle qu’on la trouve dans la Somme contre les Gentils (Summa contra Gentiles = ScG), de Thomas d’Aquin. La thématique du mariage s’y trouve « divisée » en deux parties. La première, plus conséquente, se trouve dans le livre III (chap. 122-126), tandis que la partie plus strictement sacramentelle se trouve dans le livre IV. Il faut savoir que les trois premiers livres de la ScG sont consacrés à la discussion des arguments « de la raison naturelle », tandis que le livre IV travaille dans le domaine de la « révélation divine ». Il y a donc deux discours sur le mariage :
– dans le livre III (chap. 122-126), le texte traite du mariage naturel, de l’indissolubilité, du mariage monogame, de la parenté et de la nature pécheresse de toute union charnelle ;
– le mariage (sacrement) se trouve dans le livre IV et se limite à un seul chapitre (78).
Dans ce chapitre 78, le discours théologique se concentre sur quelques lignes autour du thème de la
generatio (c’est-à-dire de la « génération »), comme catégorie centrale du sacrement :
Generatio autem humana ordinatur ad multa: scilicet ad perpetuitatem speciei; et ad perpetuitatem alicuius boni politici, puta ad perpetuitatem populi in aliqua civitate; ordinatur etiam ad perpetuitatem Ecclesiae, quae in fidelium collectione consistit. Unde oportet quod huiusmodi generatio a diversis dirigatur. Inquantum igitur ordinatur ad bonum naturae, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem: et sic dicitur esse naturae officium. Inquantum vero ordinatur ad bonum politicum, subiacet ordinationi civilis legis. Inquantum igitur ordinatur ad bonum Ecclesiae, oportet quod subiaceat regimini ecclesiastico. Ea autem quae populo per ministros Ecclesiae dispensantur, sacramenta dicuntur. Matrimonium igitur secundum quod consistit in coniunctione maris et feminae intendentium prolem ad cultum Dei generare et educare est Ecclesiae sacramentum: unde et quaedam benedictio nubentibus per ministros Ecclesiae adhibetur. (TOMÁS DE AQUINO, ScG, l. IV, c. 78)
En traduction :
La génération humaine est ordonnée à plusieurs choses, à savoir : à la perpétuation de l’espèce, à la perpétuation d’un bien politique quelconque, comme serait la perpetuation du peuple dans une cité donnée, ou à la perpétuation de l’Église, qui consiste dans l’assemblée des fidèles. Il est, pois, nécessaire que cette génération soit dirigée par divers sujets. En effet, en tant qu’ordonnée au bien de la nature, qui est la perpétuation de l’espèce, elle est dirigée vers cette fin par la force de la nature qui l’incline vers cette fin : et c’est pourquoi on dit qu’elle est un devoir naturel. En tant qu’ordonnée à un bien politique, elle est soumise à la force de la loi civile. En tant qu’ordonnée au bien de l’Église, il convient qu’elle soit soumise au régime ecclésiastique. Or, ce qui est conféré au peuple par les ministres de l’Église s’appelle sacrement. Par conséquent, le mariage, en ce qu’il consiste en l’union d’un homme et d’une femme visant à la génération et à l’éducation de la progéniture pour le culte de Dieu, est un sacrement de l’Église et, pour cette raison, une bénédiction des fiancés par les ministres de l’Église est prévue. (THOMAS D’AQUIN, ScG, l. IV, c. 78)
Si nous examinons le texte, nous verrons présentées, comme dans un miroir, les caractéristiques du modèle médiéval qui restera en vigueur jusqu’au Concile de Trente. Résumons-en les points clés :
– il est caractérisé par la « pluralité des fors ». Un même phénomène, le mariage, se lit dans trois domaines : naturel, civil et ecclésial, auxquels correspondent trois « lois » et trois « logiques » ;
– la dimension sacramentelle est la génération et l’éducation des enfants dans la foi ;
– le sacrement consiste évidemment en la « bénédiction des époux » par les ministres de l’Église, sans inclure directement l’union sexuelle ni le consentement, qui appartiennent à la logique naturelle et civile.
D’un point de vue systématique, la « forme » du sacrement et sa ministérialité sont conçues selon une vision très différente de l’actuelle. Puisque le « consentement » et la « consommation » appartiennent à la logique rationnelle, naturelle et civile, la dimension ecclésiale ne concerne simplement que la « bénédiction », qui n’est évidemment pas un acte des conjoints (comme le sont le consentement et la consommation), mais du prêtre ou de l’évêque.
2.3 Le modèle moderne : naissance de la forme canonique
Le passage qui s’opère avec le Concile de Trente est d’une extrême importance. Non seulement parce que la doctrine classique sur le mariage est réaffirmée, contre la contestation protestante, mais parce que, par le Décret Tametsi (1563), la compréhension institutionnelle du mariage se transforme : comme le dit le premier mot, « tametsi » [= bien que, nonobstant], il y a une « concession », au cœur du document, qui révolutionne l’histoire du mariage catholique. Lisons le premier paragraphe du décret :
La sainte Église de Dieu a toujours détesté et interdit pour de très justes causes les mariages clandestins, bien que l’on ne doive pas douter que, réalisés avec le libre consentement des contractants, ce soient des mariages ratifiés et véritables, tant que l’Église ne les a pas annulés ;
et, par conséquent, doivent être à juste titre condamnés, comme le saint Synode par anathème condamne ceux qui nient qu’ils soient véritables et ratifiés, et aussi ceux qui affirment à tort que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement des parents sont nuls, et que les parents peuvent les rendre ratifiés ou nuls. (DH 1813)
Dans ce paragraphe, qui ouvre le décret, un monde est en train de changer. Le rôle de l’Église dans le mariage change. L’introduction de la « forme canonique », nécessaire à la validité de l’acte, place l’Église dans une nouvelle position. Il y eut de la résistance à l’époque. Voici l’avis éclairant d’un des évêques au Concile, qui a dit : « si le mariage clandestin était aboli, les mariages faits librement et spontanément seraient abolis et, par conséquent, la véritable amitié entre les époux serait interdite » (ainsi dit l’évêque de Cava de’ Tirreni, Tommaso Caselli).
Cette décision inaugure la compétence de l’Église dans les cas matrimoniaux, qui restera une sorte d’imprinting pour toute la période moderne et qui éclatera à l’époque de la modernité tardive, lorsque la concurrence ne viendra plus des premiers États modernes, mais des États libéraux qui ont succédé à la Révolution française. L’affrontement tournera autour de la « compétence en matière d’union et de procréation ». Un contemporain, Paolo Sarpi, qui fut un chroniqueur respecté et critique du Concile de Trente, a écrit sur le décret :
Quoi qu’il en soit – disaient-ils –, le décret n’aurait été fait que pour élaborer, sous peu, un article de foi qui affirmerait que les paroles prononcées par le curé seraient la forme du sacrement… Au contraire, il a été établi que, sans la présence du prêtre, tout mariage était nul, suprême exaltation de l’ordre ecclésiastique, vu qu’une action si importante dans l’administration politique et économique, qui jusqu’alors était uniquement entre les mains de ceux à qui elle incombait, était entièrement soumise au clergé, ne laissant aucune manière de contracter mariage si les prêtres, c’est-à-dire le curé et l’évêque, pour quelque intérêt que ce soit, refusaient de se présenter. (SARPI)
John Bossy, à son tour, auteur d’une synthèse réussie sur la Chrétienté, entre la fin du Moyen Âge et le début de l’Âge Moderne, clarifie ce qui est arrivé au mariage dans le décret :
La proposition fut acceptée – c’était la seule qui pouvait concilier les parties – et devint loi. Même si elle avait été en quelque sorte préfigurée par l’histoire antérieure sur le sujet, ce fut néanmoins un coup de tonnerre dans un ciel serein, et il n’est pas clair dans quelle mesure le Concile était conscient d’avoir imposé à la Chrétienté une véritable révolution, au sens propre du terme. En annulant la doctrine canonique selon laquelle le contrat conjugal suivi de la copulation charnelle constituait le mariage chrétien, en excluant le vaste corpus de rites et d’accords coutumiers pour être privé de potentialité sacramentelle, on transformait le mariage de processus social garanti par l’Église en processus ecclésiastique administré par l’Église. (BOSSY, 1997, p. 79)
La figure du mariage, apparue après la moitié du XVIe siècle, aura une grande influence sur notre manière de penser le sacrement, sa vérité et ses effets. Bien qu’il s’agisse d’une intervention purement disciplinaire, elle aura des conséquences doctrinales non négligeables, qui se feront sentir surtout à partir du XIXe siècle.
2.4 L’ère séculière et la réaction catholique : résistance du pouvoir temporel
Le titre de la récente Exhortation apostolique (FRANÇOIS, 2016) est Amoris Laetitia, la joie de l’amour, l’allégresse de l’amour, mais aussi la fécondité et la créativité de l’amour. Le mot latin laetitia est riche de résonances et de promesses. Ainsi commence le document : par la joie de l’amour. Après la joie de l’évangile – dans Evangelii Gaudium – la joie de l’amour – dans Amoris Laetitia. Comment en sommes-nous arrivés là ? Il peut être utile de retracer, de manière extrêmement sommaire, les grandes étapes qui nous ont conduits à ce point, qui est une sorte de « nouveau commencement ». Après le modèle antique, médiéval et moderne-tridentin, un « modèle XIXe siècle » a vu le jour, qui fait ses débuts dans le premier document papal de la « fin de l’Âge moderne », qui aborde la question « matrimoniale » dans un nouveau contexte. Nous sommes en 1880, sous le pontificat de Léon XIII, quelques années après l’« assaut de la Porte Pia » et la perte du « pouvoir temporel » des papes. L’histoire qui commence à ce moment – et qui arrive à son terme avec AL – est profondément marquée par des questions institutionnelles, juridiques et politiques, qui ont caractérisé l’évolution d’une grande partie des 140 années suivantes. Les questions théologiques et les questions institutionnelles se sont entrelacées d’une nouvelle manière, qui n’a pas de précédent dans l’histoire de l’Église. À la lumière du nouveau texte, nous pouvons relire cette histoire d’une autre manière.
2.4.1 Arcanum Divinae Sapientiae, Léon XIII (1880) et le Code de 1917
Toute la grande tradition médiévale, médiatisée avec autorité par le Concile de Trente, assume, avec cette encyclique de Léon XIII, la problématique nouvelle et inédite d’une réaffirmation de la « compétence ecclésiale » face à la revendication de compétence des États modernes sur le mariage, que le XIXe siècle venait d’inaugurer. Les thèmes fondamentaux, typiques de toute la tradition précédente, sont ainsi « filtrés » par ce nouveau et dramatique problème. Dans cette encyclique sont élaborées les « formes de pensée et d’action » qui seront ultérieurement adoptées par le Code de Droit Canonique de 1917. Et qui deviendront, pendant de nombreuses décennies, l’axe décisif de la compréhension « catholique » du mariage, de la famille et de l’amour. Avec ses mérites et ses défauts. Jusqu’à aujourd’hui, cet « étranglement » institutionnel jette sa longue ombre sur la manière dont nous parlons, réfléchissons, agissons et même prions sur l’amour et le mariage.
2.4.2 Casti Connubii, Pie XI (1930)
Cinquante ans plus tard, dans un monde complètement différent, Pie XI abordait un thème particulier comme celui de la « contraception » comme « clé de compréhension » du mariage et de la famille. Cela déterminera, à partir de ce moment, une certaine priorité dans la lecture « naturelle » du mariage et de la famille. La renonciation à la « liberté » dans le contexte matrimonial se traduit par la norme d’une sexualité purement « objective », presque purifiée de la subjectivité et régulée uniquement naturellement et, par conséquent, par Dieu lui-même. Dans une étreinte entre la grâce et la nature qui, à long terme, risque d’asphyxier et de polariser de plus en plus la relation avec la culture civile et son inévitable évolution « responsable ». L’identification de Dieu avec le « naturel » et de l’homme avec l’« artificiel » a créé une polarisation croissante, qui n’a pas seulement apporté de la clarté, mais qui, à long terme, a obscurci les esprits et les cœurs. Ainsi, le thème de la « nature », qui pour la tradition théologique était une garantie du « dialogue avec la raison », est devenu un principe de confrontation et d’opposition à la culture contemporaine.
2.4.3 Gaudium et Spes, Concile Vatican II (1965)
Les textes que nous trouvons dans GS (n. 46-52) témoignent de quelques phénomènes de grande importance :
– le mariage et la famille sont unis et pensés dans la catégorie des « problèmes les plus urgents », mais non plus principalement de manière apologétique, mais avec ouverture, miséricorde et dialogue ;
– on propose une « lecture personnaliste » qui, en aucune manière, n’exclut le maintien des structures disciplinaires et doctrinales du XIXe siècle, mais les relit avec de nouvelles lentilles : la sainteté familiale, l’amour conjugal et la fécondité sont compris comme faisant partie de la mission ecclésiale ;
– le dialogue culturel devient un terrain prometteur pour le développement commun, pour la reconnaissance du bien du mariage et de la famille, comme « école d’enrichissement humain ».
Cette étape est cruciale, car elle s’inscrit dans la « nature pastorale » de Vatican II, selon laquelle la substance de l’ancienne doctrine du depositum fidei se distingue de la formulation de son revêtement, conformément à l’allocution Gaudet Mater Ecclesia, par laquelle Jean XXIII a ouvert les travaux conciliaires.
2.4.4 Humanae Vitae, Paul VI (1968)
Malgré le changement partiel de langage introduit par le Concile Vatican II et le chemin vers une « personnalisation » du mariage et de la famille, qui trouvent certainement une affirmation de grande importance dans Gaudium et Spes, nous trouvons encore en 1968 dans Humanae Vitae, de Paul VI, d’amples vestiges de la configuration qui remonte à Arcanum Divinae Sapientiae et Casti Connubii : le mariage et la famille – en tant que lieux uniques pour l’exercice de la sexualité – sont entièrement « prédéterminés » par Dieu, laissant à l’être humain un espace de responsabilité si restreint qu’il en résulte souvent presque fictif et toujours très formel et, en tout cas, séquestré par les théories du « consentement contractuel ». La possibilité d’une « procréation responsable » devient un thème abstrait, auquel ne correspondent pas des « pratiques » et des « disciplines » réalistes. Mais la solution inefficace dépend – plus généralement – d’une manière de penser le mariage et la famille « en opposition » avec la culture civile moderne. Le mariage et la famille peuvent encore être « utilisés » comme des remparts anti-modernes et des réserves de compétence ecclésiastique. Mais dans cet « usage » ils subissent aussi des mortifications et des réductions progressives, qui paralysent la pensée et la pratique ecclésiale, l’isolant et la marginalisant de la culture commune. La « paternité responsable » devient un espace de réflexion sur le monde et d’autoréflexion sur l’Église, en vue d’une compréhension différente de la relation entre union et procréation.
2.4.5 Familiaris Consortio, Jean-Paul II (1981)
Bien qu’inscrite dans une forte continuité avec le langage du siècle précédent, Familiaris Consortio réalise deux changements importants : d’une part, elle introduit, y compris dans le titre, l’expression familiaris, qui est nouvelle dans le magistère, qui s’était toujours occupé du « mariage », non de la famille. Son précédent est certainement le Concile Vatican II et sa relecture de la famille ecclésialement. Mais la deuxième étape décisive est la reconnaissance ouverte d’une « différenciation » de la société, qui émerge désormais comme évidente aussi pour l’Église. Il n’existe pas seulement des « familles régulières », mais aussi des « irrégulières », qui ne sont plus automatiquement et ipso facto « infâmes » et « excommuniées ». Le document de Jean-Paul II n’accorde pas beaucoup d’importance à cette « admission », mais c’est le début d’une petite révolution. La logique de l’opposition à la société civile, inaugurée par Arcanum Divinae Sapientiae, en 1880, cent ans plus tard, ne se soutient plus sur le plan pratique et opérationnel, même si théoriquement elle peut encore apporter un peu de réconfort. Au lieu de l’opposition frontale, la conciliation dans la différenciation entre en jeu. C’est seulement une tâche, indiquée et non réalisée, mais clairement reconnue. Cela ouvre la voie à une évolution d’abord de la praxis, puis aussi de la théorie.
2.4.6 Code de Droit Canonique (1983)
Dans le Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1601, on trouve, sous le titre « Le Sacrement du Mariage », le texte suivant :
L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée par le Christ Notre Seigneur à la dignité de sacrement entre baptisés. (CEC can. 1055, § 1)
Si nous regardons systématiquement, un fait devrait nous surprendre : c’est le seul des sept sacrements à commencer par une citation du code. Ce fait en dit long sur la tradition, ses lumières et ses ombres. C’est une tradition qui, comme nous l’avons vu, est préparée par les développements théoriques médiévaux, par les bouleversements institutionnels modernes, et trouve ainsi un langage et une mens prêts à être appliqués également aux nouvelles questions, qui surgissent bien plus tard que le Concile de Trente. Nous voyons la racine de ce « début juridique » dans l’évolution du magistère et de l’expérience ecclésiale, telle qu’elle s’est développée aux XIXe et XXe siècles.
Le Code de Droit Canonique de 1917 définissait le mariage en ces termes : « Le consentement matrimonial est l’acte de volonté par lequel chacune des deux parties transmet et reçoit le droit perpétuel et exclusif sur le corps (ius in corpus), en vue d’actes, par leur nature, aptes à la génération de la progéniture » (can. 1081 § 2 du CDC de 1917).
On peut observer ici au moins trois points importants :
– le mariage est compris comme un « contrat » ;
– le point central est le « droit de disposer du corps du conjoint » et non le « consortium intime de toute la vie » ;
– l’absence de toute référence au « bien des conjoints ».
Le langage juridique aussi, en un siècle, a profondément changé, ce qui n’a pas manqué d’être significatif comme préparation au saut qui s’est produit avec Amoris Laetitia.
2.4.7 Amoris Laetitia, François (2016)
Ainsi, nous arrivons au magistère de François. C’est le dernier maillon de la chaîne magistérielle de la fin de l’Âge Moderne. Nous n’avons pas seulement un « nouveau » document, suivant un processus synodal précis, avec une forte exigence de conversion pastorale et une réception vigoureuse du Concile Vatican II. Même au seul niveau du « lexique », les « noms de l’amour » changent et se transforment : de « arcane de la sagesse divine » à « mariage chaste », puis à la « vie humaine », au « consortium familial », pour enfin arriver à la « joie de l’amour ». Derrière ces noms qui changent, nous voyons affleurer une histoire complexe, douloureuse, problématique et, en même temps, prometteuse. Le nouveau document doit être lu dans ce « large arc », dans le contexte de cette histoire récente, sans simplement le dissoudre dans les 2 000 ans d’histoire chrétienne, mais sans non plus le comprimer dans l’histoire très recente des dernières décennies. À la lumière de ce dernier document, tous les autres prennent aujourd’hui inévitablement de nouvelles couleurs et de nouvelles formes. Il en a toujours été ainsi dans la longue histoire de l’Église chrétienne, chaque fois que la tradition a réussi à se montrer et à se reconnaître non seulement « vivante », mais aussi « saine ». Pour maintenir cette « constitution saine et robuste », il faut recourir sans cesse aux sources de la tradition et en offrir une « traduction », comme je vais tenter de le faire ci-après.
3 Le début d’un « nouveau paradigme » matrimonial, familial et relationnel
La période qui a suivi le Concile Vatican II a accéléré la dissolution du « modèle du XIXe siècle » de compréhension et d’articulation de l’expérience matrimoniale. Pour reprendre l’image d’un grand sociologue allemand de la seconde moitié du XXe siècle, « la société moderne se distingue des formations sociales antérieures par un double accroissement : une plus grande possibilité de relations impersonnelles et des relations personnelles plus intenses » (LUHMANN, 2008, p. 43). Le texte d’AL, en fait, a sanctionné la rencontre ecclésiale avec ce monde par une série de nouveautés qui méritent d’être brièvement examinées ci-après.
3.1 Une théologie post-moderne avec des schémas pré-modernes
La fin du modèle de la théologie catholique du mariage du XIXe siècle se nourrit non seulement d’une nouvelle expérience de l’« union » et de la « procréation », offerte par la société ouverte libérale et post-libérale, mais aussi de l’utilisation de « schémas interprétatifs » différents de ceux établis entre le Concile de Trente et le Concile Vatican II. Une théologie « post-moderne » de l’union et de la procréation a recours à des « schémas pré-modernes » pour surmonter les difficultés de la lecture moderne fournie par la « forme canonique » tridentine, réinterprétée par l’apologétique du XIXe siècle et par les deux codes du XXe siècle.
3.2 L’autocritique du magistère du XIXe siècle
De manière assez explicite, AL propose une « autocritique » du style magistériel des deux siècles précédents (cf. AL n. 35-37). En particulier, on y souligne les distorsions d’une pastorale matrimoniale basée sur la dénonciation stérile, sur la prétendue normalisation, sur les « manières inadéquates d’exprimer les convictions et de traiter les personnes », sur le « déséquilibre entre la fin unitive et la fin procréative », sur l’idéalisation idéologique de la théologie, sur la prétendue « autosuffisance de la doctrine » et sur la présomption de « remplacer les consciences, non de les former ».
3.3 De l’acte au processus : la dimension eschatologique du mariage
L’un des aspects les plus décisifs du changement de paradigme consiste justement en une difficile transition de la considération du mariage comme un « acte » à sa pensée comme un « processus ». La pertinence des « faits de la vie » et des « chemins de la conscience » devient ainsi décisive également pour la théologie, comme l’affirme, avec une clarté lumineuse, le dernier numéro d’AL :
Contempler la plénitude que nous n’avons pas encore atteinte nous permet aussi de relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que familles, cessant ainsi d’exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d’intentions et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le Royaume définitif. De plus, cela nous empêche de juger avec dureté ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. Nous sommes tous appelés à maintenir vivante la tension vers quelque chose de plus au-delà de nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans ce stimulant constant. (AL n.325)
4 Les questions ouvertes sur l’union et la procréation
Une doctrine sur le mariage, la famille et les faits de vie commune implique une relecture de l’ensemble de la tradition. Voici les principaux éléments qui synthétisent l’analyse historique et la réflexion systématique.
4.1 Le caractère complexe du mariage
Le mariage est une « institution » qui participe simultanément de la nature, de la culture civile et de la vocation ecclésiale. Aucune de ces dimensions, même dans leur relative autonomie, ne peut être considérée sans les autres. Il y a donc :
– des faits et des désirs à assumer ;
– des droits / devoirs à observer et à traiter ;
– des dons et des mystères à reconnaître et à célébrer.
L’irréductibilité de chacun de ces niveaux aux autres est l’un des plus grands défis de ce sacrement. Et le défi de la tradition réside justement dans la sauvegarde de la corrélation entre des éléments non réductibles. Cette complexité originelle du mariage a mis à l’épreuve la doctrine ecclésiale. Que ce soit parce que le mariage vient « avant » le sacrement, ou parce qu’il vient « à la fin » du sacrement. C’est pourquoi il a pu être le « premier » et le « dernier » des sacrements. Parce que dans le mariage, la « grâce » se montre comme nature et, en même temps, la nature « est déjà » grâce. Et, au milieu de ces « pôles », se meut la loi, qui, d’une part, fonctionne comme « pédagogie » et, d’autre part, comme « reconnaissance ». C’est peut-être précisément sur ce point que nous rencontrons le plus de difficultés à notre époque.
4.2 Les divers biens du mariage
La réflexion sur les « biens » du mariage fut, à son tour, le fruit d’une élaboration naturelle, culturelle et ecclésiale. Quand nous parlons des « biens » du mariage, nous nous déplaçons justement sur cette pente glissante. Leur identification – inaugurée par Augustin à travers la triade proles, fides et sacramentum – réalise une sélection des « données » que – de temps en temps – la nature, l’histoire et l’Église placent au centre de leur attention. Ainsi, il a été possible que des « biens » que l’Église antique, médiévale et moderne ne considérait pas, voient le jour. Examinons-en seulement trois :
– le « bien des conjoints » et la « communauté de vie et d’amour » ont acquis une nouvelle évidence et une autonomie consistante ;
– la « sexualité » et le « sentiment d’amour » se sont transformés de fonctions de la procréation en fins en soi ;
– une « vocation ecclésiale » consciente a changé la relation entre le sujet, la famille et l’Église, modifiant les relations entre ces différentes expériences.
À leur tour, les « biens classiques » déjà identifiés par Augustin ont été enrichis et transformés :
– la proles” n’est pas simplement la procréation, comme fruit de l’exercice du sexe. C’est plutôt la découverte d’une « procréation responsable ». Avec toute l’articulation nécessaire d’une pensée sur l’espace possible d’« autodétermination » de l’homme / de la femme dans la procréation ;
– la fides n’est pas seulement la « fidélité conjugale », mais un acte de foi ecclésiale. La relation entre « fidélité » et « foi » est devenue l’un des points clés de la relecture contemporaine du sacrement. Ici, la relation entre « acte » et « vocation » a ouvert un espace pour une nouvelle compétence théologique dans le domaine qui avait été auparavant pratiquement séquestré par la seule et évidente compétence juridique.
– le sacramentum ne s’identifie pas seulement à l’« indissolubilité » – avec le « ne pas pouvoir dissoudre », c’est-à-dire avec la « négation d’une négation » – mais avec l’acte positif d’aimer, de vivre ensemble, d’être dans une alliance. Peut-être l’un des points les plus délicats de cette évolution est-il d’interpréter correctement la parole forte de Jésus, selon laquelle l’être humain « ne doit pas séparer ce que Dieu a uni ».
4.3 Le débat sur l’indissolubilité
Cette parole-clé de Jésus – « que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » – indique une « évidence originelle » et un « accomplissement final ». Un théologien a dit il y a quelques décennies : le lien est indissoluble, mais il n’est pas incassable. La question, au niveau systématique, requiert une solution qui ne peut être simplement de nature judiciaire, bien qu’elle exige de nouvelles formes juridiques. Et il est significatif que la tradition ait identifié l’indissolubilité non pas sur le plan de la « différence sacramentelle », mais sur celui de la logique naturelle et commune. C’est pourquoi le remède à l’« échec » du lien doit assumer la tâche d’une nouvelle compréhension qui concerne :
– d’une part, les sujets impliqués et leur conscience ;
– d’autre part, l’« historicité du lien », qui n’est pas seulement un « acte », mais un « parcours » et une « vocation ».
La solution classique pour faire face aux crises conjugales était : le lien est indissoluble, mais le sujet lié par le lien peut avoir souffert de « vices de consentement ». Ainsi, on peut reconnaître le lien comme « nul » sur la base d’une enquête sérieuse de ces « causes de nullité ». Cependant, tout ce que l’indissolubilité du lien garantit devient très fragile si elle est soumise à une analyse du consensus sur lequel se base le lien. On passe ainsi facilement de « tout » à « rien ». C’est la solution du « for externe », qui connaît aujourd’hui des limites de plus en plus grandes, devenant un motif de fictions et de mystifications marquantes. Une nouvelle voie, que AL inaugure d’une certaine manière, en reprenant une logique plus ancienne, est celle du « for interne », où l’on peut découvrir que le lien, dans la conscience des sujets, peut avoir une histoire et même échouer. Le grand thème qui entre dans la doctrine du mariage catholique, grâce à AL, avec un certain précédent dans FC, est « l’histoire du lien matrimonial ». La solution doctrinale et disciplinaire aujourd’hui requiert de nouvelles catégories juridiques, qui doivent être construites et/ou reconnues. Il y a une « lex condenda » (une loi à créer) qui attend des contributions non accessoires au profil théologique du sacrement.
4.4 Loi objective et processus pastoral
La récupération d’une « dimension eschatologique » du mariage sacramentel impose donc une certaine distance entre « institution juridique » et « vocation sacramentelle ». Cela a été très difficile dans une Europe marquée par le Décret Tametsi, qui a indirectement donné naissance à ce que les Codes de 1917 et de 1983 ont ensuite assumé comme règle : c’est-à-dire l’identification de tout mariage entre baptisés comme « sacrement ». Cette identification détermine une sorte de « mise à zéro vocationnelle » du sacrement. Et ici entre le nouveau paradigme théologique d’ Amoris Laetitia. Il ne modifie pas la doctrine, mais il lui garantit une herméneutique plus ancienne et plus nouvelle que celle de la modernité tardive. En récupérant une ancienne distinction entre des sphères qui possèdent une certaine autonomie, il peut surmonter l’idée (idéalisée) d’identifier le bien avec la loi objective. Il y a des « biens possibles » que la nature et la culture réalisent, dans la différence et l’analogie par rapport à l’idéal ecclésial. Ces biens non seulement peuvent, mais doivent être reconnaissables et reconnus.
4.5 Les formes de vie et les cinq continents du catholicisme
Une reconsidération théologique du mariage, dans une relation structurelle avec la famille, exige une nouvelle corrélation de mondes et d’expériences, qui ne peuvent plus être interprétés comme des « systèmes juridiques parallèles ». Le résidu de « pouvoir temporel » qui subsiste dans le « droit matrimonial canonique » empêche encore de reconnaître le « bien possible » de la sphère naturelle et de la sphère civile. Une grande révision théologique réinterprète la dimension juridique à la lumière de l’eschatologie. À tout cela doit s’ajouter le grand changement introduit dans la doctrine du mariage, après le Concile Vatican II, par la découverte de cultures – également matrimoniales – des cinq continents, qui entrent comme sujets dans la doctrine et la discipline ecclésiales. Le témoignage ecclésial, médiatisé par des expériences naturelles et des histoires civiles très diverses – entre l’Afrique, l’Océanie, l’Asie, l’Amérique et l’Europe – apporte à la doctrine du mariage une nouvelle richesse et une grande diversification de perspectives, bien qu’en continuité avec la tradition. Seul un pape « latino-américain » pouvait mettre en pleine évidence cette nouveauté structurelle.
5 Le bien de la relation sexuelle et le « phénomène amour »
Si nous récapitulons le parcours général effectué jusqu’à présent, nous pouvons observer une série de données pertinentes et les lire dans une perspective sapientiale. Les relations personnelles, les communautés de vie et les alliances sponsales ont été interprétées pendant des siècles avec la catégorie de « bien », précisément parce que dès le début, il y a eu la tentation de les lire comme un « mal ». Comme nous l’avons vu, la première grande synthèse sur le mariage, écrite par saint Augustin, s’intitulait De bono coniugali (Sur le bien conjugal). Si nous surmontons l’idée que le mariage est un mal – ce fut la tentation d’une partie du christianisme antique qui est restée cachée jusqu’à L. Tolstoï et même après – et si nous pouvons aussi surmonter l’idée que le seul « conjoint » de chaque homme ou femme ne peut être que le Christ et que, par conséquent, tout « autre » mariage est illicite ou peccamineux, nous entrons dans la considération du mariage comme un « bien », c’est-à-dire dans la théorie des « biens du mariage ». Augustin a offert une présentation synthétique qui a fait école pendant de nombreux siècles : les trois biens du mariage sont les enfants, la fidélité et le sacrement (c’est-à-dire l’indissolubilité). La primauté de la procréation est très claire pour Augustin, car c’est la véritable justification centrale de la vie matrimoniale. Si quelqu’un est incapable de continence, l’orientation de l’acte sexuel vers la procréation le rend licite. Mais la « procréation » n’est pas le seul bien du mariage ; il y a aussi la « fidélité » et le « lien pour toujours ». Déjà pour Augustin, être fidèle et se lier pour toujours a sa propre dignité, même s’il n’y a pas de procréation.
5.1 Les biens du mariage sont trois, voire quatre
Pendant des siècles, cette représentation du mariage, justifiée par la procréation, est restée centrale. Au moins jusqu’au code de 1917 – et donc officiellement jusqu’en 1983 – la définition du lien matrimonial comme ius in corpus (droit sur le corps) de chacun des conjoints sur l’autre montre la centralité de l’acte d’union sexuelle comme justification théologique du mariage. Il faut ajouter que, toujours à partir d’Augustin, la distinction entre « biens en soi » et « biens pour autrui » a placé le mariage « en fonction » soit de la procréation, soit de l’amitié sociale.
Mais, avec la modernité tardive, une autre manière de comprendre la relation entre homme et femme a gagné en force. Désormais, dans le mariage, chaque sujet, en plus de procréer, trouvait dans le bien de l’autre et dans son propre bien par rapport à l’autre une valeur décisive. La considération du plaisir charnel lui-même a perdu son caractère de libido à réfréner et d’intempérance à combattre, pour assumer celui d’expression et d’expérience d’amour – au point d’amener l’Église catholique elle-même, à partir du Concile Vatican II, à parler du mariage comme d’une « communauté de vie et d’amour » et à ajouter ainsi aux classiques tria bona (trois biens), dont Augustin avait parlé, un quatrième bien, le bonum coniugum, le bien des conjoints. Dans cet horizon, évidemment, beaucoup de choses étaient destinées à changer.
5.2 La procréation perd son exclusivité
La personnalisation du mariage et de la famille n’est pas indolore, même pour la théologie. La centralité de la procréation commençait à être contestée et l’on parlait, officiellement, au moins depuis Humanae Vitae, de « procréation responsable » ou de « paternité et maternité responsables ». Un certain « contrôle » de la procréation est devenu possible et raisonnable, en accord avec la nouvelle pertinence du bien du couple. Du point de vue d’une pensée systématique, ce nouveau positionnement modifiait profondément le système latin, qu’Augustin avait inauguré avec son autorité et dont la synthèse avait traversé avec une grande force plus d’un millénaire et demi d’histoire.
Cependant, il n’est pas courant de tirer les conséquences systématiques nécessaires de cette grande transformation : c’est-à-dire qu’il est difficile d’admettre que, si la procréation est absolument centrale, il est évident que la relation entre homme et femme ne peut être « ordonnée » que si le ius in corpus (droit sur le corps) est exercé au sein du mariage. Si, par conséquent, le sexe se justifie par la procréation, il est évident que seul le mariage est le lieu de l’exercice du sexe. Si, cependant, la relation entre homme et femme a, en soi, une valeur de « bien », l’exercice de la sexualité acquiert une certaine autonomie, non seulement de la procréation, mais aussi du mariage. Elle devient un « bien » sans nécessairement devoir être liée à la procréation. La relation entre union et procréation change et demande de nouvelles médiations, plus flexibles et moins rigides.
5.3 De l’usage du sexe à l’expérience de la sexualité
Ce développement n’empêche nullement que l’on reconnaisse encore aujourd’hui dans le mariage l’unité complexe de ces quatre biens (procréation, bien des conjoints, fidélité et indissolubilité), mais il n’exclut pas qu’il puisse exister des formes de vie, des unions (hétérosexuelles ou aussi homosexuelles) où n’existent que certains de ces biens. Qui restent des biens, même s’ils ne se situent pas dans l’horizon de la procréation. Ils génèrent de l’amitié sociale, de la fidélité, de la paix, même s’ils ne génèrent pas d’enfants.
La première question que nous devons nous poser est donc : un homme et une femme peuvent-ils vivre la fidélité, l’indissolubilité et le soin mutuel sans procréer ? Cela n’est en aucun cas impossible, c’est même une réalité qui peut prendre la forme d’un mariage, même sacramentel, pourvu que l’« absence de procréation » ne soit pas vécue et présentée comme un choix explicite. Il en est ainsi depuis l’époque d’Augustin. Le « ne pas pouvoir procréer » n’empêche pas le sacrement. Mais même dans le cas où la non-procréation serait explicitement souhaitée et, par conséquent, le sacrement serait exclu, qu’est-ce qui nous empêcherait aujourd’hui de bénir, dans l’union non sacramentelle, les biens qui existent, au lieu de maudire pour le bien qui n’existe pas ?
Ici se trouve un point très délicat de la tradition morale récente : si le « moindre mal » ou le « bien possible » peut être considéré comme un « désordre » et donc un péché, ou, au contraire, un « autre ordre », un « moindre bien ».
5.4 Un seul bien peut-il être béni ?
Rappelons qu’en 2010, une polémique a éclaté autour de certaines déclarations de Benoît XVI concernant l’usage du préservatif par un « prostitué », ce qui, dans certaines circonstances, pourrait être considéré comme un « acte moral ». Le même exemple peut être appliqué non pas en ce qui concerne le jugement moral, mais en ce qui concerne le discernement pastoral. Prenons le cas extrême où, dans la vie d’un « prostitué » ou d’une « prostituée », sont expressément souhaitées – dirions-nous par profession – l’absence de procréation et l’absence évidente de fidélité, mais où l’on vit une relation stable, hétérosexuelle ou homosexuelle, dans laquelle l’un prend soin de l’autre et désire le bien de l’autre. Cette « communauté de vie et d’amour », perçue non comme occasionnelle mais comme ayant une stabilité acquise, en dehors de toute perspective sacramentelle, pourquoi ne pourrait-elle pas être reconnue et bénie ? Et, si tel était le cas, ne pourrait-elle pas être a fortiori valable aussi pour la vie sans engagement d’un homme et d’une femme, ou de deux hommes, ou de deux femmes, qui vivent leur infertilité naturelle forcée ou volontaire, mais qui sont féconds dans la relation personnelle, sociale, culturelle et ecclésiale ? S’il manquait trois des quatre biens qui composent la relation matrimoniale, mais que celui qui subsiste était réellement un bien, une forme de « vivre pour l’autre » et d’« abnégation », même au milieu de l’absence possible des trois autres, l’Église ne serait-elle pas le lieu idéal pour une reconnaissance prophétique, plutôt que le tribunal sévère d’un jugement d’exclusion ?
5.5 Le centre et la périphérie : les différents langages de l’Église
En conclusion, nous nous demandons quelle doit être la conscience des ministres de l’Église face au phénomène de l’union et de la procréation. Doit-elle être la conscience de fonctionnaires d’une institution qui porte, importe et impose le centre à toutes les périphéries ? Ou celle d’hommes de Dieu qui conduisent au centre toute périphérie, aussi éloignée et isolée soit-elle ? L’Église n’établit ni n’impose le bien : avant tout, elle le reconnaît et l’accueille. Par conséquent, la question décisive n’est pas quel est le pouvoir de l’Église sur la bénédiction, mais plutôt quelle est l’autorité que le bien réel et le bien possible exercent sur l’Église elle-même. La première question émane d’une Église « fermée sur son centre » ; la seconde naît spontanément d’une Église véritablement en sortie universelle, convaincue d’avoir un centre eucharistique, mais aussi un corps sacramentel et, finalement, une périphérie et un « hors de soi » à stimuler dans la louange, l’action de grâce et la bénédiction. Une Église qui sait pouvoir et devoir parler avec des langages différents en son centre, dans son corps élargi et aux marges les plus extrêmes de sa périphérie. Combien de ressemblance avec son Époux et Seigneur pourrait retrouver en elle-même une Église qui serait habituée à manger avec les prostituées et les publicains, qui saurait s’arrêter pour converser avec des femmes ayant eu de nombreux maris, qui ne perdrait pas l’occasion de s’entretenir avec des aveugles de naissance et des pauvres malades, en qui elle serait toujours capable de découvrir – sans grande surprise et avec une ouverture magnanime – le visage plein d’espérance des « prémices du Royaume ». C’est pourquoi les distinctions entre mariage, union civile et union naturelle servent justement à reconnaître, dans chaque réalité, le maximum de bien possible de la part d’une Église qui se reconnaît non seulement comme maîtresse, mais surtout comme mère.
Andrea Grillo. Athénée Pontifical Saint-Anselme (Rome) ; Abbaye de Sainte-Justine (Padoue). Texte original en italien. Traduction Paolo Brivio ; réviseur Francisco Taborda. Soumis : 03/03/2021. Approuvé : 06/06/2021. Publié : 30/12/2021.
Références
AGOSTINHO. De bono coniugali.
BARBAGLIA, S. Gesù e il matrimonoo: indissolubile per chi? Assisi: Cittadella, 2016.
BLIXEN, K. Il matrimonio moderno. Milano: Adelphi, 1986. (ed. orig. 1924)
BOSSY, J. Dalla comunità all’individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell’Europa moderna. Torino: Einaudi, 1997.
CONCÍLIO DE TRENTO. Decreto Tametsi (1563). In: DENZINGER-HÜNERMANN. Compêndio dos Símbolos e declarações de fé e moral (DH). São Paulo: Paulinas/Loyola, 2007. n. 1813-1815, p. 457-458.
CONCÍLIO VATICANO II. Gaudium et spes (1965). In: DENZINGER-HÜNERMANN. Compêndio dos Símbolos e declarações de fé e moral (DH). São Paulo: Paulinas/Loyola, 2007. n. 4240-4345, p 994-1035.
CORTONI, U. C. Christus Christi est sacramentum. Una storia dei sacramenti nel Medioevo. Roma: Ecclesia Orans, 2021.
DE ROUGEMONT, D. L’Amour et l’Occident. Milano: BUR, 1977. (ed. orig. 1939)
GIDDENS, A. La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne. Bologna: Il Mulino, 1990.
GRILLO, A. Le cose nuove di Amoris Laetitia. Come papa Francesco traduce il sentire cattolico. Assisi: Cittadella, 2016.
GRILLO, A. Meravigliosa complessità. Riconoscere l’Amoris Laetitia nella società aperta. Assisi: Cittadella, 2017.
LUHMANN, N. Amore come passione. Milano: Bruno Mondadori, 2008.
KASPER, W. Il matrimonio. Brescia: Queriniana, 2015.
PAPA LEÃO XIII. Arcanum Divinae Sapientiae (1880). In: DENZINGER-HÜNERMANN. Compêndio dos Símbolos e declarações de fé e moral (DH). São Paulo: Paulinas/Loyola, 2007. n. 3142-3146, p. 671-673.
PAPA PIO XI Casti Connubii (1930). In: DENZINGER-HÜNERMANN. Compêndio dos Símbolos e declarações de fé e moral (DH). São Paulo: Paulinas/Loyola, 2007. n. 3700-3724, p. 794-805.
PAPA PAULO VI. Humanae Vitae (1968). In: DENZINGER-HÜNERMANN. Compêndio dos Símbolos e declarações de fé e moral (DH). São Paulo: Paulinas/Loyola, 2007. n. 4470-4496, p.1057-1066.
PAPA JOÃO PAULO II. Familiaris Consortio (1981). In: DENZINGER-HÜNERMANN. Compêndio dos Símbolos e declarações de fé e moral (DH). São Paulo: Paulinas/Loyola, 2007. n. 4700-4716, p. 1110-1115.
PAPA JOÃO PAULO II. Código de Direito Canônico – 1917 – 1983. São Paulo: Paulinas, 1983.
PAPA FRANCISCO. Amoris Laetitia (2016). São Paulo: Paulinas, 2016.
TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, Summa contra Gentiles.
VESCO, J.-P. Ogni amore vero è indissolubile. Considerazioni in difesa dei divorziati risposati. Brescia: Queriniana (GdT 374), 2015.