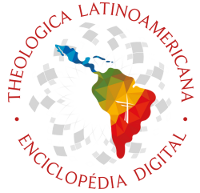Sommaire
1 La mort fait partie de la vie
2 Célébrer à l’occasion de la mort : une tradition de l’Église
2.1 Rituels des exèeques de l’Église latine
2.2 Considérations sur le rituel des exèeques de 1969
3 Pour mieux célébrer à l’occasion de la mort : suggestions pastorales
Références
1 La mort fait partie de la vie
François d’Assise conclut le célèbre « Cantique des créatures » en louant la « sœur mort » : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. […] Bienheureux ceux qu’elle trouvera dans ta très sainte volonté, car la seconde mort ne leur fera point de mal ». Le saint d’Assise fut cohérent avec ce motif inhabituel de louange. Ses biographes rapportent que, au moment extrême de sa vie, il entonna le psaume 141, avec les frères qui l’entouraient. D’ailleurs, le moment de la mort de saint François fut si expressif que, jusqu’à nos jours, la famille franciscaine se réunit chaque année, la veille de sa fête, le soir, pour célébrer le transitus du père séraphique.
La mort fait partie de la vie. Ce n’est pas un hasard si, dans diverses cultures et religions, des rites funèbres sont célébrés, dans le but d’honorer, de vénérer, de remercier, de dire adieu, de « recommander » l’être cher à la protection de la divinité. Il s’agit d’une sorte de conclusion des « rites de passage ». Ces rites englobent des étapes significatives de la vie humaine, comme la naissance, l’enfance, l’âge adulte, l’initiation religieuse, etc. Les rites funèbres mettent en évidence, d’une part, l’adieu du défunt à ce monde terrestre et, d’autre part, cherchent à le réintégrer dans un autre lieu, celui de la mémoire. Ils sont également importants dans le processus de deuil, car, en plus de « rendre hommage » au défunt, ils exercent un effet réparateur sur les personnes qui y participent, c’est-à-dire : ils renforcent la communion, resserrent les liens de solidarité, de complicité et de compassion mutuelles.
Cependant, à notre époque, le paradoxe du déni et de la banalisation de la mort est perceptible. En même temps que l’on occulte la réalité de la mort, les médias diffusent des nouvelles avec des doses excessives de sensationnalisme, nous donnant l’impression d’assister à un spectacle terrifiant. Et, pour aggraver la situation, le monde entier, à partir de la fin de l’année 2019, s’est vu plongé dans un océan de tourmentes, provoqué par la pandémie du Sars-CoV-2. Même en sachant que l’isolement social a été l’un des moyens les plus sûrs pour contenir la propagation du virus, on constate également que cette mesure préventive a provoqué de graves effets secondaires sur une bonne partie de la population de la planète. L’impossibilité pour les gens de rendre visite à leurs parents et amis malades et de célébrer dignement les rites funèbres, en mémoire de leurs proches décédés, a causé des dommages irréparables à de nombreuses personnes.
Le taux élevé de pathologies issues d’un « deuil compliqué », en ces temps de pandémie, a attiré l’attention des psychologues et des psychiatres, « car il s’agit d’une situation défavorable, dans laquelle beaucoup perdent beaucoup de choses, pas seulement des personnes, le temps d’élaboration de ce moment pourra être encore plus long et plus lent, et à une échelle collective, puisque toute la société souffre » (MELO, 2020, p. 1). Le célèbre théologien portugais J. Tolentino Mendonça souligne les principales phases qui doivent être respectées dans le travail de deuil, en ces termes :
Nous aurions d’abord besoin de pleurer notre impossibilité de consolation (phrase extraordinaire de l’Ancien Testament que saint Matthieu récupère pour son Évangile, la scène de la mort des innocents : « Une voix s’est fait entendre à Rama, des pleurs et de grandes lamentations : c’est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée » – Mt 2,18). Nous aurions ensuite besoin de pleurer et d’être consolés, par petites étapes. Et intégrer alors, progressivement, l’absence dans une nouvelle compréhension de ce mystère qu’est la présence des autres dans notre vie. (MENDONÇA, 2016, p. 16-17)
Il est admis que la pandémie a placé la population mondiale à une croisée des chemins énigmatique. L’important est de choisir un chemin où le travail de deuil soit moins traumatisant.
2 Célébrer à l’occasion de la mort : une tradition de l’Église
Dans le cadre de la foi chrétienne, la mort est considérée comme le couronnement d’une expérience pascale de la vie. Les sacrements de l’initiation chrétienne, surtout le baptême, insèrent la personne dans cette expérience. Dans les eaux du baptême, se réalise, sacramentellement, le passage de la mort à la vie, du tombeau à la résurrection :
Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. (Rm 6,4-6)
La vie chrétienne consiste en une configuration progressive au Christ, comme l’exprime bien l’Apôtre : « Le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un gain » (Ph 1,20-21). Dans ce dynamisme pascal, la mort corporelle est envisagée comme la plénitude de la vie. Une fois incorporé à la communauté de ceux qui sont nés de nouveau par les eaux baptismales, le chrétien ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l’a délivré des ténèbres et l’a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé (cf. Col 1,13). Ainsi, les moments marquants de la vie de la communauté, comme la mort d’un frère ou d’une sœur, sont célébrés par toute l’Église, le corps vivant du Christ.
Il est connu que les chrétiens des premiers siècles ont incorporé, dans les célébrations liturgiques, divers éléments de la culture des peuples de l’époque. En d’autres termes, les rites chrétiens sont le fruit d’une saine « inculturation », c’est-à-dire de la fécondation mutuelle d’éléments propres à la culture avec la foi chrétienne. Dans le cas des rites liés à la mort, des coutumes « païennes » ont été adaptées par les chrétiens, par exemple : a) le viatique (communion offerte au mourant pour le fortifier dans son « dernier voyage ») remplace la pièce de monnaie que les Grecs et les Romains mettaient dans la bouche du défunt, afin que celui-ci puisse payer le « péage » de son voyage vers l’au-delà ; b) les psaumes remplacent les lamentations, courantes dans le monde romain ; c) le refrigerium (repas funèbre « païen » qui se tenait sur la tombe du défunt, le troisième, le septième, le trentième jour et à l’anniversaire après la mort) a conduit certains chrétiens à célébrer l’eucharistie auprès du tombeau de leurs proches. Cette pratique, peu à peu, a été transférée dans les espaces des églises, donnant naissance aux « messes pour les fidèles défunts ».
2.1 Rituels des exèeques de l’Église latine
Dans un bref parcours, seront signalées quelques caractéristiques théologico-liturgiques extraites des principaux rituels des exèeques de l’Église latine, à savoir : le rituel romain du VIIe siècle, les rituels romano-gallicains des VIIIe-IXe siècles, le rituel romain de 1614 et le rituel romain de 1969 (cf. ROUILLARD, 1993, p. 237-242).
Le rituel romain du VIIe siècle est considéré comme le plus ancien et, pour cette raison, mérite une attention particulière. On y trouve un itinéraire succinct sur les procédures dispensées au mourant sur son lit de mort, ainsi que les orientations pour la célébration des exèeques. Voici le texte (notre traduction) de l’« Ordinaire de la manière d’agir en faveur des défunts » :
1. Dès que tu le verras approcher de la mort, le malade devra communier au saint sacrifice, même s’il a mangé ce jour-là, car la communion sera pour lui une aide et une défense dans la résurrection des justes. Elle le ressuscitera.
2. Après avoir reçu la communion, la Passion du Seigneur sera lue par un prêtre ou un diacre devant le corps du malade, jusqu’à ce que l’âme quitte le corps.
3. Mais avant que l’âme n’ait quitté le corps, on dit : R/. « Saints de Dieu, secourez-le. V/. Que le Christ t’accueille ». Psaume 113 (Quand le peuple d’Israël sortit d’Égypte). Antienne : « Que le chœur des anges t’accueille ». Le prêtre dit la prière comme dans les sacrements.
4. Ensuite, le corps est lavé et placé dans le cercueil. Et après que le corps est dans le cercueil, avant de sortir de la maison, on dit l’antienne : « Tu m’as formé de la terre et tu m’as revêtu de chair, mon Rédempteur ; ressuscite-moi au dernier jour ». Psaume 96 (Le Seigneur a régné).
5. Ensuite, le corps est placé à l’intérieur de l’église. On dit : Antienne : « Seigneur, tu as ordonné que je naisse ». Psaume 41 (Comme une biche soupire). Antienne : « Que les anges te conduisent au paradis de Dieu ; à ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et te mènent à la cité sainte de Jérusalem ». Psaume 4 (Quand je crie, réponds-moi !).
6. Tandis qu’il est porté vers la sépulture : Antienne : « Celui qui a appelé ton âme à la vie ». Psaume 14 (Seigneur, qui habitera ?). Antienne : « Seigneur, qui as pris l’âme du corps, fais-la se réjouir avec tes saints dans ta gloire ». Psaume 50 (Aie pitié, ô mon Dieu). Antienne : « Vois, Seigneur, mon humilité et ma souffrance, pardonne tous mes péchés ». Psaume 24 (Seigneur, mon Dieu, vers toi j’élève mon âme). Antienne : « Que les anges te conduisent au royaume de Dieu avec gloire ; que les martyrs te reçoivent dans ton royaume, Seigneur. De la terre tu l’as façonné et tu l’as revêtu de chair, mon Rédempteur, ressuscite-le au dernier jour. Psaume 50 (Aie pitié, ô mon Dieu).
7. Et quand il sera placé dans l’église, tous prient pour cette même âme toujours, sans cesse, jusqu’à ce que le corps soit enseveli. Qu’ils chantent des psaumes ou des répons, disent des prières ou fassent des lectures du livre de Job et, quand viendra l’heure des vigiles, en même temps, qu’ils célèbrent la vigile, disent des psaumes avec les antiennes sans alléluia. Le prêtre, cependant, dit la prière, tandis qu’ils chantent l’antienne : « Ouvrez-moi les portes de la justice et, en y entrant, je chanterai le Seigneur ». Psaume 117 (Rendez grâce au Seigneur).
Dans un regard panoramique sur cet Ordo du VIIe siècle, on perçoit facilement son caractère pascal. Les psaumes pascals 113 et 117 qui encadrent le rituel laissent entrevoir qu’il existe une correspondance typologique entre les exèeques et l’exode, c’est-à-dire : « le défunt expérimente sa sortie d’Égypte et son entrée dans la terre promise, où il est accueilli par les anges et les saints » (ROUILLARD, 1993, p. 239). Cela apparaît explicitement dans le rite décrit ci-dessus. Le cortège funèbre – de la maison du défunt, en passant par l’église, jusqu’à la sépulture – possède un sens eschatologique : la communauté « accompagne » l’être cher dans son « voyage » vers sa demeure définitive, la « Jérusalem céleste ». Ici, seront accueillis par les habitants du ciel ceux qui « ont vaincu la grande tribulation » (Ap 7,14). Enfin, dans le présent rituel, prédomine la certitude que le défunt entrera dans la gloire, sans entraves majeures.
Dans les rituels romano-gallicains des siècles suivants, l’euchologie change substantiellement. La mentalité des peuples franco-germaniques a influencé, de manière décisive, le contenu des prières et des monitions, à savoir : a) les demandes insistantes de la miséricorde et du pardon de Dieu en faveur du défunt, ainsi que la protection contre tous les dangers auxquels il se trouve exposé, dans son « voyage » vers l’au-delà ; b) l’insécurité de la part des fidèles quant au destin éternel de la personne qui vient de décéder ; c) l’eucharistie, qui en vient à occuper la place centrale dans les funérailles, et la mentalité conséquente de « sacrifice de propitiation et de suffrage » en faveur des défunts. Des siècles plus tard, le réductionnisme atteindra un tel point que, lors de la messe d’exèeques, les fidèles ne communieront pas, afin de reverser au défunt les « mérites » obtenus par cette célébration ; d) le manque de clarté dans la relation entre la mort du fidèle et le mystère pascal du Christ. D’ailleurs, le Christ et l’Esprit Saint sont peu mentionnés, sauf dans la conclusion trinitaire des prières. Les prières sont adressées à Dieu, mais n’explicitent pas qu’il a envoyé son Fils pour le salut des humains. « En somme, cette théologie de l’au-delà semble presque entièrement inspirée de l’Ancien Testament et peu animée par la bonne nouvelle de l’Évangile. […] Elle n’est ni christologique ni pascale » (ROUILLARD, 1993, p. 241).
Le rituel romain de 1614 fait partie de l’ensemble des livres liturgiques promulgués par l’Église après le Concile de Trente. Le déroulement des funérailles obéit à l’ancienne coutume processionnelle, à savoir : de la maison du défunt jusqu’à l’église ; de l’église au cimetière. Quant à la théologie, ce rituel porte en lui des influences directes des rituels antérieurs, surtout de ceux provenant de l’empire carolingien. De telles influences sont perceptibles dans les ambiguïtés qui y sont présentes : à côté d’une euchologie, issue des anciens sacramentaires romains, qui révèle une pleine confiance en la résurrection, coexiste une autre, qui exprime l’incertitude et la terreur face à la mort et au « destin de l’âme ». À titre d’exemple, il convient de citer le répons qui suit la prière du Notre Père :
V/. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
R/. Mais délivre-nous du mal.
V/. De la porte de l’enfer.
R/. Arrache, Seigneur, son âme…
Comme on peut l’observer, le texte suggère que tous les défunts courent le danger de confondre la « porte » de l’enfer avec celle du ciel. D’ailleurs, la conception effrayante de la mort et le doute quant au destin du défunt étaient largement véhiculés dans la réflexion et la prédication de l’Église, dont l’apogée eut lieu aux XVIe et XVIIe siècles. D’autres impasses théologiques sont perceptibles comme : a) la référence inexpressive au mystère pascal ; b) l’absence de lien avec le sacrement du baptême ; c) une euchologie exclusivement pour le défunt. Dans les prières, il n’y a aucune mention des vivants qui pleurent la perte de leurs proches ; e) un rituel à exécuter exclusivement par le clergé.
La musique rituelle des exèeques est également peu pascale. La séquence “Dies irae” et l’“Offertoire” de la “Messe de Requiem” en sont de bons exemples. Dans ces deux pièces musicales, entre autres aspects, s’expriment la peur de l’enfer, le pessimisme face à la vie et la croyance généralisée que « peu sont sauvés ». Certains affirment que l’antienne “Domine Jesu Christe” (Offertoire) est le texte le plus énigmatique – non seulement de la liturgie des exèeques mais de toute la liturgie romaine –, en raison de la demande que le Christ « libère les âmes de tous les défunts des peines de l’enfer ». À la rigueur, il s’agit de quelque chose de paradoxal, du fait que la théologie soutient qu’il est impossible de passer de l’enfer au paradis, donc un conflit avec le principe lex credendi lex suplicandi (cf. SORESSI, 1947, p. 245-252).
Quatre siècles après l’utilisation de ce rituel par l’Église latine, la Congrégation pour le Culte Divin a publié, en 1969, un nouveau rituel des exèeques. Sacrosanctum Concilium avait expressément demandé que le nouveau rituel des exèeques exprime plus clairement le caractère pascal de la mort chrétienne et qu’il corresponde mieux aux conditions des diverses régions, y compris en ce qui concerne la couleur liturgique et le rite des exèeques des enfants (cf. SC, n. 81-82).
Ce rituel est composé d’une introduction générale (Observations préliminaires), où sont présentées ses bases théologiques et pastorales, et de huit chapitres, constitués comme suit :
a) Veillée pour le défunt et prière au moment de la mise en bière (chap. I). Il s’agit d’une célébration de la Parole de Dieu, sous la présidence d’un prêtre ou d’un(e) ministre laïc(que). Au moment de la déposition du corps dans le cercueil, un bref rite est prévu, constitué de psaumes, d’une lecture brève et d’une oraison conclusive.
b) Premier type d’exèeques : célébrations à la maison du défunt, à l’église et au cimetière (chap. II). Ici, on conserve la tradition des anciens rituels, avec deux processions reliant trois stations, à savoir : de la maison du défunt à l’église, et de celle-ci au cimetière. Dans ces trois lieux, sont prévues des prières, des psaumes, des répons, etc., et l’eucharistie (à l’église).
c) Deuxième type d’exèeques : célébrations à la chapelle du cimetière et auprès de la sépulture (chap. III). Ici, le rituel ne prévoit pas la célébration de l’eucharistie. À la chapelle du cimetière, on célèbre une liturgie de la Parole de Dieu, suivie de la « recommandation et de l’adieu ». Auprès de la sépulture, on récite les prières indiquées et on chante un « chant approprié ».
d) Troisième type d’exèeques : célébrations à la maison du défunt (chap. IV). Cette troisième possibilité de célébration est similaire à celle de la « Veillée » (chap. I), suivie de la « recommandation et de l’adieu ».
e) Exèeques pour les enfants (chap. V). Pour ce type d’exèeques, il existe des textes propres (prières et lectures bibliques), en plus de la recommandation que la couleur liturgique soit « festive et pascale ».
f) Textes divers : pour les exèeques des adultes (chap. VI), les exèeques des enfants baptisés (chap. VII), les exèeques des enfants non baptisés (chap. VIII).
2.2 Considérations sur le rituel des exèeques de 1969
Sans l’ombre d’un doute, le nouveau rituel des exèeques constitue une avancée expressive par rapport à l’ancien. À titre d’exemple, on peut souligner les points suivants :
a) Le rétablissement de la perspective pascale et ecclésiale. Cette perspective constitue le fil conducteur de tout le rituel. Dès le début des « Observations préliminaires », nous lisons :
L’Église célèbre avec une profonde espérance le mystère pascal du Christ dans les exèeques de ses enfants, afin que ceux-ci, incorporés par le baptême au Christ défunt et ressuscité, passent avec lui de la mort à la vie. […] C’est pourquoi la sainte Mère l’Église offre le sacrifice eucharistique de la Pâque du Christ et élève vers Dieu ses prières et ses suffrages pour le salut de ses défunts, afin que, par la communion qui existe entre les membres du Christ, ce qui pour l’un sert de suffrage, pour les autres serve de consolation et d’espérance. (n. 1)
On voit clairement la relation intime entre les exèeques et les sacrements primordiaux : le baptême et l’eucharistie. On peut affirmer également que la célébration des exèeques constitue le couronnement d’une vie tissée au sein de la communauté ecclésiale et nourrie par les sacrements.
b) Une euchologie plus complète. Il convient de souligner dans les prières et les préfaces la présence de divers « thèmes » peu explicités dans le rituel tridentin, comme : l’espérance et la certitude de la résurrection, liées à la Pâque du Christ ; le pardon et la miséricorde divine ; la valeur eschatologique de l’eucharistie, définie comme « viatique dans le pèlerinage terrestre » et « gage de la pâque éternelle du ciel » ; la profession de foi en la victoire pascale du Christ ; une plus grande attention aux personnes en deuil, etc.
c) Un lectionnaire fourni. Comme les autres livres liturgiques élaborés après le Concile Vatican II, le rituel des exèeques présente un riche lectionnaire. Les « Observations préliminaires » en indiquent les raisons en ces termes :
Dans toutes les célébrations pour les défunts, tant aux exèeques que dans les autres, on accorde beaucoup d’importance à la liturgie de la Parole de Dieu. Ces lectures proclament le mystère pascal, éveillent l’espérance d’une nouvelle rencontre dans le Royaume de Dieu, nous enseignent une attitude chrétienne envers les morts et nous exhortent à donner, partout, le témoignage d’une vie chrétienne. (n. 11)
Le lectionnaire comprend un fonds significatif de lectures de l’Ancien et du Nouveau Testament. Les textes sont présentés dans l’ordre où ils sont proclamés dans l’action liturgique (première lecture – psaume responsorial – deuxième lecture – acclamation à l’évangile – évangile), et sont répartis en trois sections : « Exèeques des adultes », « Exèeques des enfants baptisés » et « Exèeques des enfants non baptisés ».
d) L’élargissement du fonds de psaumes. Le nouveau rituel récupère un répertoire expressif de psaumes qui remontent à l’ancienne tradition des célébrations d’exèeques, surtout ceux à contenu pascal et de confiance. Après tout, le langage poétique, exprimé dans les divers genres des psaumes, permet à la communauté de foi de se solidariser avec celui qui est malade, affligé, en insécurité, abandonné, etc. : « Dans mon angoisse, j’ai crié vers le Seigneur, et le Seigneur m’a exaucé et libéré ! Le Seigneur m’a sévèrement éprouvé, mais il ne m’a pas abandonné aux mains de la mort » (Ps 118/117, 5.18).
e) La révision des exèeques des enfants. Le nouveau rituel a pris en compte la demande de Sacrosanctum Concilium de réviser les exèeques des enfants, y compris la création d’un formulaire pour une « messe propre » (cf. SC n. 82). Des textes ont également été élaborés pour les exèeques d’enfants non baptisés, c’est-à-dire de ceux dont les parents souhaitaient les faire baptiser, mais en ont été empêchés par une mort précoce. Une caractéristique de l’euchologie de ces célébrations est le fait de confier l’enfant (non baptisé) à la miséricorde divine, sans faire mention de son entrée dans la gloire céleste ; on prie surtout pour ses parents. Derrière cette « omission » se cache la question controversée relative au sort des enfants qui meurent sans baptême. Il convient de rappeler que, à l’époque où ces prières ont été rédigées, prédominait la doctrine commune selon laquelle les « âmes » des enfants non baptisés étaient dans l’impossibilité de jouir de la « vision béatifique » de Dieu. Cette question a été discutée, quatre décennies plus tard, par la Commission Théologique Internationale. En 2007, le pape Benoît XVI a approuvé et autorisé la publication du document « L’espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême », élaboré par ladite Commission. L’étude parvient à la conclusion suivante :
Notre conclusion est que les nombreux facteurs que nous avons considérés précédemment offrent de sérieuses raisons théologiques et liturgiques d’espérer que les enfants qui meurent sans baptême seront sauvés et pourront jouir de la vision béatifique. Nous soulignons qu’il s’agit ici de raisons d’espérance dans la prière plus que de connaissance certaine. Il y a beaucoup de choses qui ne nous ont tout simplement pas été révélées (cf. Jn 16,12). Nous vivons dans la foi et l’espérance en le Dieu de miséricorde et d’amour qui nous a été révélé dans le Christ, et l’Esprit nous pousse à prier avec une gratitude et une joie constantes (cf. 1Th 5,18).
Ce qui nous a été révélé, c’est que le chemin ordinaire du salut passe par le sacrement du baptême. Aucune des considérations exposées précédemment ne peut être adoptée pour minimiser la nécessité du baptême, ni pour en retarder l’administration. Bien plus, comme nous voulons le réaffirmer ici en conclusion, il existe de fortes raisons d’espérer que Dieu sauvera ces enfants, puisqu’on ne peut faire pour eux ce qu’on aurait souhaité faire, à savoir les baptiser dans la foi et la vie de l’Église. (CTI, 2008, n. 102-103)
Le rituel des exèeques de 1969 innove également sur d’autres aspects, tels que : l’admission de la crémation (n. 15) ; le ministre des exèeques, à l’exception de l’eucharistie, peut être un laïc (n. 19) ; la sensibilité œcuménique de la part de celui qui prépare et préside les exèeques, étant donné qu’il est courant lors des veillées funèbres d’avoir la présence de personnes d’autres confessions ou même sans pratique religieuse (n. 18) ; la possibilité d’adapter le rituel par les conférences épiscopales (n. 21-22), etc.
Pour conclure ces considérations sur le rituel des exèeques de 1969, il est également pertinent de souligner ses limites, comme l’existence de vestiges d’une eschatologie dualiste (corps contre âme) et la non-adaptation du rituel par la majorité des conférences épiscopales. Ces aspérités et d’autres pourront être aplanies à mesure que les Églises s’engageront dans l’élaboration de rituels qui, en plus d’une bonne théologie, tiendront compte de la réalité culturelle des communautés de foi.
3 Pour mieux célébrer à l’occasion de la mort : suggestions pastorales
Comme il a été dit au début de ce texte, l’Église, dans sa sollicitude pastorale, a toujours cherché à encourager et à consoler ses fils et ses filles au moment extrême de l’existence, en les préparant au dernier et décisif combat spirituel, mené entre la vie et la mort. De bons exemples en sont le rite de la « recommandation de l’âme » (1614) et celui de la « recommandation des agonisants » (1969). De tels rites – composés de prières, de brèves péricopes bibliques, de jaculatoires, de répons, etc. – sont réalisés auprès du mourant sur son lit de mort. Une fois le décès survenu, on célèbre les exèeques.
En célébrant la « pâque » de ses fils et de ses filles, l’Église poursuit sa noble mission de consoler et de réconforter les personnes en deuil, comme l’Apôtre nous y exhorte : « Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui se sont endormis. C’est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles » (1Th 4,14.18). Dans le sillage de cette lointaine tradition, il est urgent que l’Église crée des moyens efficaces pour la sédimentation d’une « pastorale de l’espérance », qui serve de contrepoint au phénomène paradoxal de camouflage et/ou de banalisation de la mort, typique de la société d’aujourd’hui.
Pour une plus grande efficacité de cette « pastorale de l’espérance », il convient, entre autres, de tenir compte de :
a) Une action conjointe avec la « pastorale de la santé ». Le réconfort spirituel dispensé au malade, ainsi qu’aux membres de la famille et à tous ceux qui s’occupent des malades, constitue un véritable ministère de la consolation. Ce « ministère » tend à se potentialiser dans la vie des gens, surtout lorsque ceux-ci doivent affronter la douleur de la mort d’un être cher et le travail de deuil qui s’ensuit.
b) Une formation adéquate pour les agents de la « pastorale de l’espérance ». La célébration des exèeques et l’assistance spirituelle conséquente aux familles en deuil requièrent une préparation soignée. Il s’agit d’un apprentissage qui privilégiera l’écoute de la personne qui souffre. Sans la culture de l’écoute, il devient impossible d’ouvrir le canal de la consolation.
Écouter signifie donner la parole, donner du temps et de l’espace à l’autre, l’accueillir aussi dans ce qu’il refuse de lui-même, lui donner le droit d’être qui il est et de sentir ce qu’il sent et lui fournir la possibilité de s’exprimer. Écouter est un acte qui humanise l’homme et qui suscite l’humanité de l’autre. (MANICARDI, 2017, p. 15)
Lors des exèeques et des célébrations de soutien aux familles en deuil, l’écoute a une place privilégiée au moment du « souvenir de la vie ». Ici, les personnes sont invitées à exprimer leurs sentiments et à faire mémoire du « passage » de l’être cher, à la lumière du mystère pascal du Christ. Les faits, les paroles et les actions du (de la) défunt(e) se transforment en un véritable « testament » à accomplir par tous. De même, l’écoute de la Parole de Dieu et son lien avec ce qui a été dit lors du « souvenir de la vie » deviendront une nourriture substantielle pour la vie et un remède efficace pour combattre la tristesse et la douleur de la séparation.
D’autres contenus étudiés, au long du processus de formation, devront corroborer une telle « écoute ».
c) La création d’itinéraires d’exèeques adaptés aux besoins pastoraux de chaque région. Le rituel des exèeques de 1969 laisse une large marge pour que les conférences épiscopales fassent des adaptations, selon les besoins pastoraux de chaque région (cf. n. 21-22). Malheureusement, la grande majorité des conférences épiscopales a opté pour une simple traduction du rituel. Le liturgiste Gregório Lutz – de regrettée mémoire –, alors qu’il faisait des considérations sur un nouveau rituel des exèeques pour le Brésil, a déploré le fait que le rituel de 1969 ait été seulement traduit, sans aucune adaptation, en ces termes :
Il est vrai qu’il exprime la foi chrétienne authentique à l’égard de la mort, mais cette foi est exprimée dans un langage qui, ici, est difficilement compréhensible. C’est pourquoi ce nouveau rituel n’a pas été aussi bien accepté qu’un rituel adapté l’aurait été, éventuellement avec des suggestions différentes pour les régions ayant leurs propres traditions et pour des milieux diversifiés. (LUTZ, 1998, p. 33)
Cette opinion de Lutz peut s’appliquer à d’autres pays d’Amérique latine. Dans le cas du Brésil, ce qui s’est produit, en pratique, ce sont des publications de subsides alternatifs pour les célébrations d’exèeques qui sont adoptées dans les paroisses et les diocèses. À titre d’exemple, on peut citer : « Nossa Páscoa: subsídios para a celebração da esperança » et « Celebrando por ocasião da morte: subsídio para velório, última encomendação e sepultamento ». Le premier a été préparé par la Commission Épiscopale Pastorale pour la Liturgie de la CNBB. Ce subside est composé de quatre chapitres et de deux annexes. Le premier chapitre contient trois célébrations de la Parole ; le deuxième propose une célébration pour la recommandation ; le troisième présente un rite propre pour le moment où le corps est déposé dans la sépulture ; le quatrième propose une célébration pour les crémations (une au crématorium et une autre pour la déposition de l’urne avec les cendres). Dans l’annexe I, on trouve un petit lectionnaire, et dans l’annexe II, un recueil de chants appropriés.
Le subside « Celebrando por ocasião da morte: subsídio para velório, última encomendação e sepultamento », quant à lui, se compose de six itinéraires. Chaque itinéraire envisage une circonstance de mort différente, à savoir : d’un membre actif de la communauté ; d’une personne décédée après une longue maladie ; d’un(e) jeune ; d’un(e) religieux(se) ; d’une victime de violence ; d’un enfant. Chacun des itinéraires est composé de trois parties : a) « Veillée » (célébration au format de l’Ofício Divino das Comunidades : arrivée, ouverture, souvenir de la vie, psaume, lectures bibliques, méditation, prières, louange) ; b) « Recommandation et adieu » ; c) « Inhumation / crémation ». Il y a aussi deux petits rites pour le moment de la crémation et de la déposition des cendres, ainsi qu’un « Office de soutien aux familles en deuil ».
En somme, ce que l’on espère, c’est que les diverses Églises trouvent la meilleure façon de célébrer la pâque de leurs fils et de leurs filles et que ces célébrations soient des moments privilégiés pour proclamer la foi au « Christ premier-né d’entre les morts » (Col 1,18).
Joaquim Fonseca, OFM. ISTA/FAJE. Texte original en portugais. Envoyé : 08/12/2021. Approuvé : 20/12/2021. Publié : 30/12/2021.
Références
BROVELLI, F. Exéquias. In: SARTORE, D.; TRIACCA, A. M. Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992. p. 426-436.
CARPANEDO, P.; FONSECA, J.; GUIMARÃES, I. R. Celebrando por ocasião da morte: subsídio para velório, última encomendação e sepultamento. 4.ed. São Paulo: Paulinas, 2018.
CNBB. Nossa páscoa: subsídios para a celebração da esperança. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2004.
COMISSSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. A esperança da salvação para crianças que morrem sem batismo. São Paulo: Paulinas, 2008. Documentos da Igreja, 22.
FONSECA, J. Música ritual de exéquias: uma proposta de enculturação. Belo Horizonte: O Lutador, 2010.
LUTZ, G. Pensando um novo ritual de exéquias para o Brasil. Revista de Liturgia, São Paulo, n. 149, p. 31-34, 1998.
MANICARDI, L. O humano sofrer: evangelizar as palavras sobre o sofrimento. Brasília: Edições CNBB, 2017.
MELO, Laís de. Como lidar com o luto em tempos de pandemia. Jornal da Cidade.net., Aracaju, 20 maio 2020. Disponible sur : http://www.jornaldacidade.net/cidades/2020/05/317677/como-lidar-com-o-luto-em-tempos-de-pandemia.html. Consulté le : 4 nov. 2021.
MENDONÇA, J. Tolentino. A mística do instante: o tempo e a promessa. São Paulo: Paulinas, 2016. p. 16-17.
RITUAL DE EXÉQUIAS. São Paulo: Paulinas, 1971.
RITUALE ROMANUM Pauli V Pontificis Maximi. Editio septima post typicam. Sanctae Sedis Apostolicae e Sacrae Rituum Congregationis Typographorum, 1949.
ROUILLARD, Ph. Os ritos dos funerais. In: VV.AA. Os sacramentos e as bênçãos. São Paulo: Paulus, 1993. p. 225-265.
SORESSI, M. L’offertorio della messa dei defunti e l’escatologia orientale. Ephemerides Liturgicae, Cittá del Vaticano, n. 61, p. 245-252, 1947.
SOUZA, Christiane P. de; SOUZA, Airle M. de. Ritos fúnebres no processo de luto: significados e funções. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2019, v. 25, p. 1-7. Disponible sur : https://www.scielo.br/j/ptp/a/McMhwzWgJZ4bngpRJL4J8xg/?lang=pt&format=pdf. Consulté le : 6 nov. 2021.