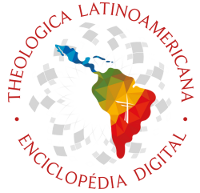Sommaire
Introduction
1 Étapes historiques du mouvement liturgique
1.1 Pré-histoire du Mouvement liturgique
1.2 Début et théologie du Mouvement liturgique
1.3 Développement du Mouvement liturgique
1.4 Le Mouvement liturgique au Brésil
2 La contestation du Mouvement liturgique
3 Nouvelle phase du Mouvement liturgique
Conclusion
Références
Introduction
En jetant un bref regard sur l’histoire de la liturgie, nous nous rendons compte qu’il y a toujours eu des périodes historiques où la liturgie a été reconnue avec une attention particulière, au point de se caractériser dans toute la vie de l’Église et à toutes les époques comme source et sommet de la vie chrétienne.
Au début du XXe siècle, un grand mouvement de renouveau liturgique prend de l’ampleur dans l’Église d’Occident. C’est ce qu’on appelle le Mouvement liturgique, qui a eu sa pré-histoire à l’époque des Lumières (XVIIIe siècle) et de la restauration catholique (XIXe siècle). Le Mouvement liturgique est né de la nécessité pour l’Église de retrouver son identité. Souffrant de l’influence de l’individualisme et du rationalisme modernes, le culte de l’Église, ses formes de célébration et sa théologie avaient été relégués au second plan.
Après la tourmente de la Révolution française et l’échec des idées des Lumières, la période suivante, le Romantisme, a eu une influence positive sur la liturgie. En effet, cette période a éveillé le sens de l’histoire et a conduit de nombreux clercs et simples fidèles à rechercher l’origine et la signification des gestes, des vêtements, des rites, des objets et des fêtes dans la liturgie.
Le désir de renouveau contamine bientôt les Églises européennes. En Allemagne, les études de théologie sont promues par les professeurs de l’Université de Tübingen. La réflexion théologique de ces professeurs, centrée sur l’Église comme corps mystique du Christ, a été une précieuse préparation pour le Mouvement liturgique. Nous examinerons ici de manière essentielle quelques personnages, événements et problèmes qui ont caractérisé le Mouvement liturgique et l’avènement de Vatican II. Nous nous attarderons sur la pensée de quelques personnes dont la réflexion théologique a eu d’importantes implications dans la compréhension et la conception de la liturgie et continue d’influencer encore aujourd’hui.
1 Étapes historiques du Mouvement liturgique
1.1 Pré-histoire du Mouvement liturgique
Au XVIIe siècle s’inaugure le mouvement philosophico-culturel appelé les Lumières, en nette opposition à la vision et aux affirmations du Baroque, opulent et théâtral dans ses formes. Les Lumières privilégient l’essentiel et la sobriété : « Dans la vision des Lumières de l’époque, les événements sont examinés à la lumière de la raison, sans excès de sentiment et en luttant contre l’ignorance et la superstition » (CONTE, 1992, p. 61). Les Lumières se sont opposées à toutes les formes de piété populaire, considérées par elles comme pleines de superstitions et de fanatisme. Elles critiquaient aussi sévèrement les célébrations pompeuses et demandaient une liturgie plus sobre et essentielle, attentive à favoriser la participation des fidèles. Des instances qui n’ont pas toujours été accueillies par les ecclésiastiques, qui, au lieu du renouveau, préféraient tout ce qui ne troublait pas la tranquillité de leur vie.
À cette période, un grand intérêt est également né pour l’étude des sources liturgiques anciennes, niées par les réformateurs protestants. Parmi les grands, le cardinal théatin Giuseppe Maria Tomasi (1649-1713), connu comme le « prince de la liturgie d’Occident », mérite une attention particulière ; il souhaitait ramener à leur « forme originelle les offices et les rites en général de l’Église » (cf. DI PIETRO, 1986, p. 11).
Les Lumières ont également eu une grande influence sur la liturgie. Ce mouvement a déclenché un processus contre la centralité tridentine et l’extériorisation baroque exagérée. Les catholiques exigeaient une liturgie plus simple, adaptée à la réalité du peuple et comprise par lui. Le problème était que le clergé voyait la liturgie davantage comme une fonction éducative du peuple que comme une célébration du mystère du Christ, ce qui a compromis le travail de réforme. En tout cas, ce mouvement peut être considéré comme le début du Mouvement liturgique, qui culminera avec la réforme liturgique de Vatican II. Et c’est à partir de là que nous comprendrons que la liturgie est la source primordiale de la vie chrétienne.
Cependant, en tant que tel, le Mouvement liturgique peut être considéré comme un phénomène très récent, que ce soit par sa dénomination ou par son contenu. L’expression « Mouvement liturgique » apparaît pour la première fois en Allemagne, dans le Vesperale d’A. Schott, édité en 1894, et a été accueillie pour indiquer un phénomène historico-culturel typique de notre temps, bien que, tout au long de l’histoire, il y ait toujours eu des mouvements qui ont successivement abouti à une transformation de la liturgie. Il est ardu, voire impossible, comme c’est le cas pour tout mouvement, de lui attribuer une définition synthétique et complète. La meilleure est peut-être celle que nous trouvons dans les mots de Neunheuser :
un courant qui rassemble de vastes milieux dans la recherche d’un renouveau, en premier lieu, de la vie spirituelle elle-même, en se laissant toucher par la force de la liturgie et, en second lieu, de la liturgie en soi, à partir d’une compréhension plus profonde de son esprit et des lois intimes qui la régissent. (NEUNHEUSER, 1992, p. 787)
De cela, nous pouvons, pour simplifier, indiquer deux objectifs du Mouvement liturgique : faire de la liturgie la nourriture de la vie chrétienne ; répondre à la question : « Qu’est-ce que la liturgie ? ».
On peut parler de deux instances : l’instance historico-herméneutique et l’instance spirituelle. En elles sont implicites, et doivent être considérées, l’instance théologique et l’instance pastorale.
La restauration liturgique tridentine a abouti à un attachement tenace aux formes héritées d’un Moyen Âge où la liturgie était devenue une affaire cléricale et éloignée du peuple. La théologie du culte chrétien, celle des Pères, avait été oubliée et l’événement du salut, opérant dans l’action liturgique, restait totalement absent.
1.2 Début et théologie du Mouvement liturgique
Nous n’avons pas l’intention d’entrer dans la discussion sur la périodisation du Mouvement liturgique ; pour notre propos, nous accueillons les phases indiquées par R. Guardini : « Le Mouvement liturgique a d’abord développé une phase restauratrice ; puis une phase académique ; enfin une phase réaliste » (cf. GRILLO, 2007, p. 31), mais nous sommes d’avis que le Mouvement liturgique se poursuit.
Le début du Mouvement liturgique du XXe siècle – préparé dans les milieux monastiques et, surtout, à Solesmes avec l’abbé P. Guéranger – coïncide généralement avec ce que l’on appelle l’« événement de Malines », une conférence tenue le 23 septembre 1909, au cours du Congrès National des Œuvres Catholiques, par Lambert Beauduin (1873-1960), bénédictin de l’abbaye du Mont-César, en Belgique, sur « La vraie prière de l’Église » (cf. BEAUDUIN, 2010). Dans cette conférence, L. Beauduin a observé que dans le culte divin régnait l’individualisme religieux, que les assemblées liturgiques avaient perdu leur caractère communautaire, que les fidèles ne cherchaient Dieu que sous une forme dévotionnelle, ce qui appauvrissait de plus en plus la liturgie. Se référant à une affirmation tirée du motu proprio Tra le sollecitudini, dans lequel le pape Pie X décrivait la liturgie comme la source la plus importante et indispensable de l’Église, L. Beauduin a affirmé qu’il était nécessaire d’entreprendre un chemin de renouveau liturgique, par lequel la célébration communautaire de la liturgie retrouverait sa signification profondément ecclésiale. L’Église en tant que Corpus Christi mysticum, que L. Beauduin avait mis en relation avec le renouveau liturgique, deviendra le thème dominant de l’ecclésiologie de la première moitié du XXe siècle (cf. GOPEGUI, 2008, p. 18-26).
L’avènement de la papauté de Pie X (4 août 1903) a marqué pour le ML le début d’un premier accueil officiel des demandes de renouveau. Avec sa première encyclique, le pape annonçait le programme de son pontificat : Instaurare omnia in Christo, et, entre-temps, par différentes interventions, il a initié une première réforme de la liturgie.
Dans le motu proprio Tra le sollecitudini, du 22 novembre 1903, le pape déclarait :
Étant en effet notre plus vif désir que l’esprit chrétien refleurisse en tout et se maintienne chez tous les fidèles, il est nécessaire de pourvoir avant tout à la sainteté et à la dignité du temple, où les fidèles se réunissent précisément pour puiser cet esprit à sa source première et indispensable : la participation active aux très saints mystères et à la prière publique et solennelle de l’Église. (PIE X, 1903, dans l’Introduction)
L’action de Pie X en faveur de la liturgie a été considérée comme une contribution très importante au défi relevé par le Mouvement liturgique. Les interventions répétées pour la révision des livres de chant liturgique, pour la réforme du psautier, sur la communion fréquente, orientaient de manière décisive l’Église vers une liturgie qui commençait à retrouver sa juste place. Rousseau l’affirme également :
Reconstruire la communauté des fidèles autour de la vie paroissiale ; réveiller la ferveur du peuple par la participation active au saint sacrifice de la messe ; apprécier la richesse des fêtes ecclésiales, la valeur des sacrements, des sacramentaux ; donner aux chrétiens le goût des saints mystères, en les restaurant dans l’atmosphère de l’âge d’or de la foi, en les buvant à grandes gorgées à tous les canaux de la grâce : voilà ce qu’était, par excellence, son programme d’apostolat. Cette phrase a été souvent citée : Il n’est pas nécessaire de chanter ou de prier pendant la messe, mais nous devons chanter et prier la messe, ce qui contient déjà une attitude de piété liturgique, que ses actes ultérieurs ne feront qu’amplifier. (ROUSSEAU, 1961, p. 236)
Peu ont réussi à saisir le contenu théologique des paroles du pape sur la participation active des fidèles à la prière publique et solennelle de l’Église. Peut-être même pour Pie X la question était-elle beaucoup plus sur le plan extérieur que théologique. Avec son discours, le pape cherchait à surmonter la participation passive du peuple chrétien aux célébrations liturgiques. Il n’en demeure pas moins que ses affirmations, grâce à quelques théologiens du Mouvement liturgique de l’époque, ont eu une répercussion notable sur la vie de l’Église.
C’est précisément à partir des affirmations de Pie X que le Mouvement liturgique – qui s’est inséré dans une vision renouvelée de l’Église portée par quelques théologiens, parmi lesquels surtout J. A. Möhler – se proposait essentiellement trois objectifs : 1) favoriser et accroître la participation active des fidèles à la liturgie ; 2) revaloriser l’art sacré ; 3) redécouvrir la vision théologique de la liturgie et sa dimension pastorale.
La liturgie a dû se libérer de l’image juridique, surmonter la phase historiciste pour atteindre une base théologique sur laquelle ont été greffées les réformes de type pastoral. Par conséquent, une nouvelle vision de l’Église a caractérisé les débuts du Mouvement liturgique. Tout le climat de transformation politique, philosophique, théologique et historico-culturelle qui s’est créé entre la période du Romantisme et des Lumières a aidé les laïcs catholiques à acquérir une plus grande conscience de leur appartenance à l’Église.
Cette situation historique, culturelle et religieuse qui avait créé et diffusé l’image de l’Église comme société juridiquement parfaite était déjà dépassée. Ce fut le Mouvement liturgique, conjointement à l’épanouissement des études sur les Pères de l’Église, qui a contribué de manière décisive et profonde à redécouvrir des images, des modèles et des interprétations de l’Église auxquels on n’avait accordé aucune attention jusqu’alors. Dans la conviction de fond que le divorce entre le peuple et l’Église provenait principalement de la désaffection pour la liturgie, P. Parsch et son collaborateur J. Casper se sont engagés dans la promotion de la Volksliturgie dans les paroisses fréquentées par les intellectuels et le peuple en général. Leur œuvre sera poursuivie plus tard par les jésuites H. Rahner et J. A. Jungmann, à travers ce qu’on a appelé la théologie kérygmatique. De manière particulière, Jungmann, avec la redécouverte de la centralité du mystère pascal, concentrera sa réflexion sur le caractère kérygmatique de la liturgie, conjugué à une conception de l’Église comme plebs sancta, où l’idée de l’Église comme corps mystique est orientée vers une ecclésiologie fortement communautaire et eucharistique (cf. PAIANO, 1993, p. 72).
Le Mouvement liturgique présentait aux hommes de son temps
Non pas un nouveau visage de l’Église, mais plutôt un visage qui était resté longtemps dans l’ombre ; en effet, il cherchait à les rapprocher le plus possible de ce que l’Église était dans sa nature la plus profonde, c’est-à-dire de son être sacramentel et de ses célébrations liturgiques, tout en leur enseignant que l’Église est le « corps mystique » du Christ, c’est-à-dire le mystère du Christ qui prolonge son existence humaine. Et de cette nouvelle communauté ecclésiale redécouverte dans les circunstantes (les participants), qui sont précisément les participants à la célébration, le point central est l’autel (NEUNHEUSER, 1987, p. 22).
Romano Guardini comprenait la relation entre le Mouvement liturgique et l’Église en décrivant le premier comme un courant très vigoureux du mouvement ecclésial, allant jusqu’à affirmer qu’il était « le mouvement ecclésial dans son aspect contemplatif. Là, l’Église est insérée comme une réalité religieuse dans la vie de prière. La vie personnelle fera partie de la vie ecclésiale » (GUARDINI, 1989, p. 39). L’interpénétration vitale entre l’Église et la liturgie est mise en évidence de manière emblématique ainsi : « la liturgie est la création rédemptrice et priante, parce qu’elle est l’Église priante » (GUARDINI, 1989, p. 39).
Ce nouvel ordre d’idées s’affirmait de plus en plus, surtout en Belgique, grâce à l’œuvre de L. Beauduin qui, avec les moines du monastère du Mont-César, promouvait les fameuses Semaines et conférences liturgiques, avec l’apparition des grandes revues liturgiques. Parmi les nombreuses, nous rappelons particulièrement la revue Les questions liturgiques, dont Beauduin fut le fondateur, et qui devint très rapidement Les questions liturgiques et paroissiales.
Le programme de restauration liturgique du pape Pie X devient en quelque sorte le programme de dom L. Beauduin. Il comprit que pour la sanctification du peuple de Dieu, il était nécessaire de commencer par une formation adéquate du clergé qui, ensuite, travaillerait pastoralement dans les paroisses, lieu où le peuple de Dieu est rassemblé et organisé (cf. BEAUDUIN, 1914).
Dans l’introduction au recueil des œuvres de L. Beauduin, publié à l’occasion de ses 80 ans, trois mérites fondamentaux de l’œuvre du moine bénédictin belge ont été mentionnés : avoir initié le Mouvement liturgique grâce à la richesse des initiatives promues ; avoir fourni un programme et une doctrine au même mouvement, qui ont démontré son engagement pour que les activités développées puissent avoir un impact sur le terrain proprement pastoral ; l’intérêt pour l’ecclésiologie ainsi qu’une grande sensibilité et ouverture œcuménique, résultant d’une intense réflexion théologique sur la liturgie.
Pour Beauduin, la liturgie est le culte de l’Église
Toute la force novatrice de cette simple définition réside dans le mot « église », qui spécifie au sens formellement chrétien le « culte ». Celui-ci, en effet, reçoit de l’« église » son caractère « public » et « communautaire », non pas, cependant, dans un sens qui rendrait le culte chrétien semblable à n’importe quel culte, provenant de n’importe quelle « société » qui l’établirait par la loi, mais bien dans le sens que l’« église », étant dans le monde la continuation du Christ, exerce ce culte tout spécial et parfait que le Christ a rendu au Père dans sa vie terrestre. Le culte de l’église est donc, avant tout, un culte chrétien au sens éminent, car en lui s’exprime la nature propre de l’église, qui est une communauté visiblement réunie autour du Christ. (MARSILI, 1992, p. 640)
Dans la définition de la liturgie de Beauduin, l’ecclésialité ressort comme l’aspect dominant de la liturgie. Est donc liturgie, tout et seulement ce que l’Église reconnaît comme sien dans les actes de culte, parce que l’Église est la continuation du Christ. En effet, le sujet unique et universel du culte de l’Église est le Christ ressuscité et glorieux. C’est Lui qui exerce notre culte et accomplit ici sur terre toute notre liturgie. Et c’est précisément en vertu de cette présence active du Christ dans l’histoire, par le biais de son Église, que la liturgie peut être définie comme l’exercice du sacerdoce du Christ, moment par lequel Il nous constitue en sa communauté et nous transforme en son corps mystique. Un tel sacerdoce
a) est personnel, et cela veut dire que c’est le sacerdoce personnel du Christ qui agit par l’intermédiaire de ceux qui sont ses ministres en vertu d’un sacrement ; b) est collectif (nous dirions « communautaire ») tandis que le Christ, réunissant en lui toute l’humanité rachetée, exerce « une action sacerdotale collective et solidaire, en faveur et au profit de toute sa communauté » ; c) est hiérarchique, c’est-à-dire que, bien que ce soit « le Christ lui-même qui exerce ici sur terre son sacerdoce », néanmoins, voulant le rendre visible, il choisit pour lui des « ministres, des instruments qui agissent en son nom et avec son pouvoir, et c’est là le sacerdoce catholique, transmission sacramentelle de l’unique sacerdoce du Christ ». (MARSILI, 1987, p. 91)
Marsili a observé qu’« aujourd’hui, il est facile d’évaluer cette synthèse de la théologie de la Liturgie présentée dans les lointaines années 1912-1920, (…), mais à cette époque, ce fut un fait vraiment extraordinaire et tous ne l’ont pas compris dans sa pleine valeur » (MARSILI, 1987, p. 91-92).
À la lumière de la réflexion liturgique et ecclésiologique actuelle, cependant, une critique peut être adressée à l’explication de la nature sacerdotale de la liturgie offerte par Beauduin. Quand il parle de la liturgie comme de l’exercice du sacerdoce du Christ dans l’Église, ici, l’église n’est que la hiérarchie. Le Christ exerce bien une action sacerdotale en faveur et au bénéfice de toute sa communauté, mais il le réalise par l’intermédiaire de ses ministres. De la prémisse sur la nature collective du sacerdoce du Christ, Beauduin n’arrive pas à la conclusion que tous les fidèles agissent dans le Christ en exerçant leur sacerdoce commun. Il a clairement affirmé qu’il faut dire avec beaucoup de prudence que dans le Christ tous ont un véritable sacerdoce – le sacerdoce universel – et ce, parce que, en raison du mouvement protestant qui niait le sacerdoce ministériel, cela pouvait créer de la confusion dans les esprits (BEAUDUIN, 1954, p. 87).
Bien que Beauduin ne soit pas parvenu à approfondir la réflexion théologique sur le sacerdoce commun des fidèles, il faut reconnaître que sa pensée est celle qui a pénétré le plus profondément le Mouvement liturgique, et ce « peut-être en raison de son traditionalisme et de sa nouveauté réunis, peut-être en raison de son ouverture à la dimension ecclésiologique, peut-être en raison de sa capacité à ‘unir’ le moment sanctificateur et cultuel de la liturgie, peut-être en raison des ‘retombées’ évidentes d’une telle vision sur le plan de la spiritualité et des pastorales » (CATELLA, 1998, p. 32). C’est précisément la réflexion théologico-liturgique de Beauduin qui a favorisé la réévaluation de la liturgie, en lui donnant un caractère théologique, et a encore accru son lien avec la christologie et l’ecclésiologie
En pourvoyant – par conséquent – à la vision de la relation intrinsèque entre Christ-Église-Liturgie et à l’idée d’une redécouverte/révélation/réforme de la praxis et de la spiritualité liturgique, on aurait produit une réforme/renaissance de l’Église elle-même. Non seulement cela, mais cette synthèse sera accueillie dans l’encyclique Mediator Dei (1947) par le pape Pie XII, qui sera ressentie comme la magna charta du mouvement liturgique. (CATELLA, 1998, p. 32)
Un autre point pertinent de la vision liturgique de L. Beauduin est sa pensée sur la relation existante entre l’ecclésiologie et l’eucharistie. L’eucharistie est la conjonction du ciel et de la terre, elle est le symbole de l’Église édifiée sans cesse. Quand le chrétien vit authentiquement la liturgie et, de manière particulière, la célébration de la messe, à ce moment-là, il développe l’esprit d’appartenance à l’Église. La redécouverte de la théologie liturgique présuppose et comporte une nouvelle conception de l’Église.
En Rhénanie, le monastère de Maria Laach cherchait à poursuivre le chemin entamé, en se consacrant avant tout à la formation du milieu universitaire, des professeurs et du clergé – dans l’espoir que ces derniers pourraient faire avancer l’idéal d’une vie chrétienne comme vie liturgique –, se transformant en un centre de formation et de réforme liturgique allemande. En 1913, avant d’être nommé abbé, dom Ildefons Herwegen a rencontré un petit groupe de laïcs (avec H. Brüning et R. Schumann) qui a exprimé le désir d’une plus grande participation aux célébrations liturgiques. L’année suivante, le jeune abbé a invité un groupe un peu plus nombreux au monastère pour la Semaine Sainte de 1914, au cours de laquelle, pour la première fois, la messe dialoguée a été célébrée. Sous la direction de l’abbé Herwegen, avec deux autres moines, Cunibert Mohlberg et Odo Casel, et en collaboration avec Romano Guardini, F. R. Dolger et Anton Baumstark, ils ont ouvert la voie au Mouvement liturgique allemand. En 1918, ils ont organisé une triple série de publications : le premier volume de la collection Ecclesia orans est apparu, ainsi que les séries Liturgiegeschichtliche Quellen et Liturgiegeschichtliche Forschungen (1919). Trois ans plus tard, ils ont lancé le périodique Jahrbuch fur Liturgiewissenschaft (NEUNHEUSER, 1987, p. 25).
À l’intérieur de ce nouvel ordre d’idées, la contribution d’O. Casel, philologue des langues classiques anciennes, fut grande. Amoureux des sources, il a construit toute sa doctrine théologique sur la Sainte Écriture et sur les Pères de l’Église.
Pour Casel, l’Église est le corps mystique du Christ qui se réalise lui-même dans le culte qu’il offre au Père. Le sujet de chaque action liturgique est donc le corps du Christ. Et c’est précisément ce qui confère à la liturgie une supériorité par rapport aux autres dévotions ou pratiques pieuses. C’est dans la liturgie que se produit la présence active et vivifiante du Seigneur ressuscité. Par le biais de la liturgie, en effet, le mystère du Christ devient le mystère de l’Église, et l’Église existe dans le temps et l’espace comme mystère du Christ. Ainsi, dans la liturgie, l’Église n’annonce pas seulement le salut, mais elle l’actualise, le rendant présent aux hommes aujourd’hui réunis pour la célébration des divins mystères. Cela se produit spécialement pendant la célébration de l’eucharistie. C’est dans Il mistero della Chiesa que l’auteur exprime clairement cette ligne de pensée :
ceci est le sacrifice des chrétiens : nous, les nombreux, nous sommes un seul corps dans le Christ. L’ecclesia célèbre ce sacrifice dans le mystère de l’autel bien connu des fidèles ; ici, il lui est montré comment, dans la chose qu’elle sacrifie, elle-même est sacrifiée. […] La tête s’est d’abord sacrifiée elle-même, afin que le corps pût s’unir à elle. En vertu de son sacrifice, nous pouvons maintenant aussi sacrifier ; dans l’eucharistie, nous nous sacrifions avec le Christ, qui présente au Père sa nature humaine et nous tous en elle. Ce sacrifice de l’ecclesia, l’eucharistie, est la présentation quotidienne du mystère du sacrifice du Christ qui inclut en lui le sacrifice de tous les membres. L’ecclesia s’offre elle-même par le Christ et dans le Christ ; elle ne sacrifie pas par son propre pouvoir, ni selon un mode propre, mais par le Seigneur ; plus précisément, elle s’offre ainsi dans toute son essence, car elle est incluse dans la réalité du Seigneur, c’est-à-dire dans son corps immolé et glorifié. (CASEL, 1965, p. 408-409)
Il ne nous semble pas risqué d’affirmer que c’est précisément en raison d’une telle vision de l’Église, et en particulier du mystère de la présence active du Christ dans la liturgie, qu’elle est devenue l’idée centrale de la Constitution liturgique. Cela constituerait – après une période de dure opposition également de la part du magistère – une très haute reconnaissance de la réflexion et de l’œuvre du moine bénédictin.
1.3 Développement du Mouvement liturgique
Le renouveau liturgique ne fut pas un courant de pensée limité seulement à la Belgique, à l’Allemagne et à la France, mais il se diffusa dans d’autres régions.
En 1911, a eu lieu aux Pays-Bas, à Bréda, le congrès liturgique qui a conduit en 1912 et en 1914 à la fondation de la Société liturgique respectivement des diocèses de Haarlem et d’Utrecht, et de la Fédération liturgique néerlandaise, en 1915.
En Autriche, le Mouvement liturgique s’est développé sous la direction de l’augustin Pio Parsch de Klosterneuburg, qui a publié Das Jahr des Heils (1923), un commentaire du missel et du bréviaire pour toute l’année liturgique, et la revue Bibel und Liturgie (1926).
Le Mouvement liturgique a également commencé à prendre forme dans d’autres pays européens avec des accents divers selon le climat culturel et ecclésial propre à chaque pays. Il y eut une évolution significative en Espagne, dirigée principalement par le monastère de Montserrat, au Portugal, en Suisse, en Angleterre, dans l’ancienne Tchécoslovaquie, en Hongrie et en Pologne.
En Italie, les personnes et les milieux qui, vers ces années-là, vivaient et participaient à l’éveil liturgique et ecclésiologique en cours ne manquaient pas. Cependant, selon le jugement d’E. Cattaneo, le Mouvement liturgique en Italie n’a pas eu le même succès que dans d’autres pays. Deux raisons expliquent cette circonstance :
La première était constituée par le traditionalisme spirituel ancré à un catéchisme ancien et à une piété dévotionnelle […], la seconde fut l’absence, dans le mouvement, des évêques italiens – à quelques exceptions près […] – explicable par la coutume de notre maison d’attendre le verbe de Rome par un hommage dédié au Primat d’Italie, le Souverain Pontife, et par une dépendance accentuée vis-à-vis des organes de la curie romaine. (CATTANEO, 2003, p. 505-506)
Malgré cette considération, à notre avis, l’œuvre du Mouvement liturgique en Italie doit être considérée comme importante, tant sur le plan théologique que pastoral. Sur le plan théologique, l’œuvre développée par M. Righetti fut remarquable, il s’est consacré surtout à accroître la réflexion théologico-liturgique, en publiant des études scientifiques d’un intérêt particulier. Une place de choix est également occupée par la Revista Liturgica, fondée en 1914 près du monastère bénédictin de Finalpia (Savone) et dont le premier directeur fut dom E. Caronti. Un collaborateur insigne de la revue fut le moine dom I. Schuster, qui devint plus tard évêque de l’archidiocèse de Milan. Schuster a enrichi la revue par la publication de ses études qui, recueillies et organisées, sont devenues une partie fondamentale de son œuvre Liber sacramentorum. Du point de vue pastoral, les semaines liturgiques organisées, surtout à l’initiative de G. Bevilacqua de l’Oratoire de Brescia, furent pertinentes. La première semaine a eu lieu à Brescia, en 1922.
La même année où fut fondée la Rivista Liturgica, l’évêque d’Ivrée, dom Matteo Filippello, publia la lettre pastorale sur La liturgia parrocchiale, « un des témoignages les plus significatifs du mouvement liturgique italien » (CATTANEO, 2003, p. 497). Dans cette lettre, l’évêque invitait les fidèles de son diocèse à prendre conscience de leur appartenance ecclésiale et à vivre la vie de l’Église qui, étant « essentiellement une société religieuse », s’exprime de manière spéciale dans la liturgie. Et à la liturgie, le peuple doit participer non seulement par sa présence physique, « mais avec la voix, avec l’esprit, avec le cœur, avec toute l’âme » (CATTANEO, 2003, p. 498).
Christ – Église – liturgie : c’est le trinôme sur lequel se concentre la réflexion du également bénédictin Salvador Marsili. La liturgie est le moment salvifique à travers lequel l’action du Christ continue dans le monde et en chaque homme, une action qui est rédemptrice pour les hommes et glorificatrice envers Dieu. Ainsi comprise, la liturgie acquiert une base essentiellement christologique. Et, à cette lumière, l’Église résulte directement comme un effet de la liturgie, avant même d’en être l’exécutrice :
De la liturgie naît et de la liturgie vit l’Église. […] Les sacrements ont assemblé l’Église. Sortis du corps tourmenté et écartelé du Christ, ils ont formé un corps mystérieux pour le Christ, capable de porter toute sa vie divine. […] De la liturgie, l’Église, conséquence logique et ontologique, s’il est vrai que les sacrements réalisent et appellent l’Église à l’existence pratique. C’est la liturgie qui sanctifie la société, qui rend la société sainte, c’est-à-dire l’Église. (MARSILI, 1938, p. 232)
De sa vision théologique de la liturgie, Marsili fait jaillir une conclusion d’une considération théologique notable : la liturgie n’est pas une réalité accidentelle par rapport à l’Église, elle est, à son tour
Le principe de base et constitutif, de sorte que sans la liturgie, il ne peut y avoir d’Église […]. Non pas dans le sens où l’existence de l’Église revendique une liturgie pour satisfaire son devoir de culte envers la divinité, mais dans le sens très différent que sans la liturgie, l’Église ne peut, dans l’économie chrétienne actuelle, exister. […] La liturgie n’est pas à côté de l’Incarnation. La liturgie est le « Mystère du Christ » toujours vivant et actif. (MARSILI, 1939, p. 73-78)
En termes encore plus explicites, Marsili affirme que « comprendre la liturgie, c’est comprendre l’Église, et l’incompréhension de l’une conduit fatalement à une fausse valorisation de l’autre » (MARSILI, 1939, p. 17).
Le Mouvement liturgique se propage également aux Amériques : le moine Virgil Michel a fondé, en 1925, le Mouvement liturgique aux États-Unis, au monastère de Saint-Jean, à Collegeville. Il est également le fondateur de la revue Orate frates, qui en 1951 a changé son nom en Worship (cf. NEUNHEUSER, 1987, p. 30).
1.4 Le Mouvement liturgique au Brésil
Au Brésil, le Mouvement liturgique a vu le jour en 1933, à Rio de Janeiro, et a eu pour figure de proue le moine bénédictin Martinho Micheler. Récemment arrivé d’Allemagne, il fut chargé de donner un cours de Liturgie à l’Institut Catholique d’Études Supérieures, fondé sous l’inspiration et la direction d’Alceu Amoroso Lima, dans le but d’offrir des cours de théologie aux étudiants universitaires catholiques. Ses cours eurent une grande répercussion dans les milieux universitaires et intellectuels catholiques. Ils découvrirent avec admiration que la Liturgie est bien plus qu’un ensemble de rubriques, de gestes ou de rites : c’est la vie du Christ en nous, l’action de la Trinité, la vie de l’Église, Corps Mystique du Christ. Au sein de l’Action Universitaire Catholique se forme alors un Centre de Liturgie. Les travaux de ce centre sont inaugurés par une retraite pour un groupe de six jeunes hommes, dirigée par dom Martinho, dans une ferme de l’intérieur de l’État de Rio, sous le nom de « six jours de communauté ». Dans ce petit groupe se trouvera la figure du futur continuateur du Mouvement liturgique, avec la réforme liturgique, D. Clemente Isnard. C’est là qu’il célébra la première messe versus populum. La messe fut dialoguée et c’était aussi une nouveauté. En ces jours, ces jeunes hommes découvrirent également les richesses de l’Office Divin. Mais l’important n’était pas les innovations en matière de pratique de la célébration, qui peuvent nous paraître aujourd’hui insignifiantes, mais l’esprit qu’elles supposaient : la redécouverte de la spiritualité centrée sur la prière de l’Église. C’est cet esprit que dom Martinho a cultivé, lors d’une messe hebdomadaire célébrée au Monastère de São Bento pour un groupe d’universitaires. En 1935, fut fondée l’Action Catholique, avec Alceu Amoroso Lima comme président, qui deviendra la grande protagoniste et diffuseuse du Mouvement liturgique dans tout le Brésil. Que ce soit au Brésil ou aux États-Unis, le mouvement avait une forte inclination pastorale, avec une attention particulière à la dimension sociale de la célébration (DA SILVA, 1983, p. 40-74).
Tout était très nouveau : la liturgie était présentée au-delà des rubriques, bien plus que des allégorismes. On a commencé à découvrir au Brésil une théologie de la liturgie. Après dom Martinho Michler, une série de moines comme dom Beda Keckeisen, à Bahia, dom Polycarpo Amstalden, à São Paulo, dom Hidebrando Martins, à Rio de Janeiro, l’abbesse Luzia Ribeiro de Oliveira, au monastère féminin de Belo Horizonte, ont fait progresser les idées de la participation active des fidèles à la liturgie, conscients, évidemment, que rien ne peut être placé avant le Christ, le liturge par excellence. Nous aurons encore le P. Gregório Lutz, qui peut être considéré comme l’un des pionniers de la réforme liturgique. Bien qu’il ait étudié et ait été ordonné avant le Concile Vatican II, la découverte de la liturgie pendant les années 1960 lui a ouvert un monde nouveau. Avec dom José Clemente Isnard (1917—2011), ils peuvent être considérés comme les véritables promoteurs de la Réforme liturgique du Concile Vatican II en terres brésiliennes (Cf. GOPEGUI, pp. 21-22).
2 La contestation du Mouvement liturgique
La contestation du Mouvement liturgique ne s’est pas fait attendre. La controverse a eu lieu autour de la problématique liturgie-spiritualité, d’une part, et liturgie-engagement chrétien, d’autre part. Elle réapparaîtra à plusieurs reprises, jusqu’à nos jours.
Dès les années 1913-1914, un débat véhément a surgi entre le bénédictin Festugière, défenseur du Mouvement liturgique, et le jésuite Navatel, contestataire du Mouvement.
Au Brésil, cette discussion s’est reflétée dans la polémique prolongée entre l’Action Catholique, soutenue par les bénédictins, et les Congrégations Mariales, soutenues par certains jésuites. Dans toute cette question, le Séminaire du Cœur Eucharistique de l’Archidiocèse de Belo Horizonte a joué un rôle de premier plan (DA SILVA, 1983, p. 163-199).
La discussion se prolongera jusqu’à la publication de l’encyclique Mediator Dei, en 1947, qui a officiellement adopté les grandes idées du Mouvement liturgique. Mais, comme il arrive dans certains écrits du Magistère, en mêlant des louanges au Mouvement liturgique à des avertissements sur ses possibles excès, elle n’évitera pas la poursuite de la polémique, alimentée par des lectures divergentes de l’encyclique papale.
Ce qui est en jeu dans la discussion, c’est la conception de la Liturgie. Pour les contestataires du Mouvement liturgique, la liturgie n’est que le visage cérémoniel et décoratif de la messe, des sacrements et des sacramentaux, et cela est encore présent dans l’esprit de nombreuses personnes. Pour les défenseurs du Mouvement liturgique, la Liturgie est la présence sacramentelle de l’action salvifique de Dieu dans l’histoire humaine, c’est la prière du Christ avec son Église. Ainsi comprise, la Liturgie ne peut représenter aucune menace pour la piété personnelle, qui ne peut être conçue sans elle.
L’autre aspect qui a conduit à questionner le Mouvement liturgique fut la relation entre la célébration liturgique et l’engagement dans la transformation des réalités terrestres. Cette confrontation a eu lieu au sein de l’Action Catholique. Au Brésil, cette opposition s’est produite de manière très radicale, au rythme de la conscience croissante de l’urgence d’une action capable de transformer les situations d’injustice dans lesquelles vivait l’immense majorité de la population. Si, chez certains, cette conscience a entraîné une perte d’enthousiasme pour la vie liturgique, chez les plus conscients, elle fut la cause de son approfondissement, incitant le Mouvement liturgique à faire en sorte que les situations concrètes de la vie des hommes et des femmes configurent la forme de la célébration. Ainsi, le Mouvement liturgique passait d’une phase tournée préférentiellement vers le passé à une phase où l’on commence à postuler des réformes plus profondes, qui fassent de la célébration liturgique l’expression des angoisses et des espérances des êtres humains d’aujourd’hui.
3 Nouvelle phase du Mouvement liturgique
Alors que dans les années 1903-1914, les réformes de Pie X avaient précédé et suscité le Mouvement liturgique, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les développements du mouvement pastoral liturgique que le pape Pie XII a ratifiés, en reprenant le projet de Pie X et en l’adaptant aux nouvelles conditions. Alors qu’avant 1940, il s’agissait de mettre la liturgie existante à la portée du peuple et de promouvoir le chant grégorien, par la suite, on percevra plus clairement la nécessité d’une profonde réforme des rites et d’une introduction partielle de la langue vernaculaire dans les célébrations (BUGNINI, 2018, p. 40-44).
En 1947, avant même de consacrer à la liturgie l’Encyclique Mediator Dei, le pape Pie XII institua, au sein de la Congrégation des Rites, une commission chargée de préparer une réforme générale de la liturgie. Du reste, il avait déjà pris des mesures spécifiques pour atténuer la loi du jeûne eucharistique, afin de faciliter la célébration de la Messe le soir et la communion dans les pays en guerre, mesures qu’il généralisa en 1953, avec la Constitution Apostolique Christus Dominus. Désormais, l’usage de l’eau naturelle ne rompait plus en aucun cas le jeûne eucharistique, et ce, par rapport à tout autre aliment, en le fixant à trois heures avant la communion (CATTANEO, 2003, p. 508-515).
Le premier fruit de la réforme souhaitée par Pie XII fut l’autorisation de célébrer la Vigile pascale au cours de la Nuit Sainte (1951). Quatre ans plus tard, c’était au tour de la réforme de la Semaine Sainte (1955). Après un certain temps, avec le développement du mouvement biblique, on accorda plus d’attention à la parole de Dieu et à son usage liturgique. Mais, pour que tous aient accès, pendant la célébration, à la table de la Parole, il était nécessaire qu’elle soit proclamée en langue vernaculaire. Pie XII ne crut pas que la question était suffisamment mûre pour prendre une initiative générale, se contentant d’offrir des autorisations partielles pour lire l’Épître et l’Évangile pendant la liturgie solennelle (1953). Il permit cependant la publication de rituels bilingues, notamment en allemand et en français (1947). Comme premier pas vers la réforme du Bréviaire, il opéra une simplification des rubriques (1955) et fit élaborer un Code des rubriques, que Jean XXIII publia en 1960. C’est également Jean XXIII qui publia le rite simplifié de la Dédicace des églises et des autels (1961). Mais il avait déjà décidé de présenter au Concile en préparation les principes de la réforme générale de la liturgie (CATTANEO, 2003, p. 508-515).
Cette période constitue pour la théologie un moment assez singulier, caractérisé par une ferveur intense de recherches et d’études dans divers domaines. Il s’agit du phénomène, ainsi appelé à l’époque par Romano Guardini, de l’« éveil de l’Église dans les âmes » (GUARDINI, 1989, p. 21). L’Église, dans les multiples aspects de la vie, se rattachait au centre des intérêts religieux et théologiques. On assiste « à une sorte de maturation collective de ce qui n’avait été, au XIXe siècle, que l’intuition de quelqu’un, mais dans un nouveau contexte historique qui exigera, peu à peu, une nouvelle réélaboration du visage institutionnel de l’Église » (FRISQUE, 1972, p. 214). Et c’est pourquoi le Mouvement liturgique doit être pensé également en conjonction avec d’autres mouvements qui cherchaient en même temps à repenser d’autres aspects de la praxis ecclésiale : le mouvement théologique et christologique avec les recherches sur le Jésus historique, le mouvement catéchétique et le mouvement biblique sont quelques-uns des nombreux qui tentaient des changements.
Conclusion
Le chemin du Mouvement liturgique ne fut pas du tout facile. Les attaques et les discussions de la part des fidèles et des évêques qui n’étaient pas d’accord avec certaines tendances et certains choix faits par ceux qui promouvaient le mouvement n’ont pas manqué :
Mais la polémique la plus importante (avec des conséquences cependant très positives) fut celle qui se développa sur le plan tant de la théologie que de la spiritualité, autour de la vision « mystérique » de la liturgie, telle qu’elle était proposée et défendue par le bénédictin allemand O. Casel. (NEUNHEUSER, 1992, p. 797)
Les bénéfices et les intuitions prophétiques sont évidents aujourd’hui à la lumière de la réforme liturgique déclenchée par le Concile Vatican II. Premièrement, la redécouverte de la participation active du peuple à la célébration liturgique, la centralité du Mystère Pascal, cœur de toute la vie liturgique, et la nécessité de la formation liturgique des pasteurs et du peuple, tout cela basé sur une ecclésiologie solide et sur une recherche sérieuse et profonde de la nature théologique et pastorale de la liturgie. D’où la nécessité de rendre la célébration de la Messe et des sacrements compréhensible pour les fidèles, par la simplification des rites et l’usage de la langue locale. Avec le Mouvement liturgique renaît le désir de rendre aux fidèles l’Office Divin pour favoriser la connaissance de la Parole de Dieu et de la prière de l’Église, et pour accroître la vie spirituelle du clergé par l’engagement quotidien à l’Office Divin. Le Mouvement n’a pas négligé le grand domaine des arts, en définissant le principe de la beauté, de la sobriété et de la simplicité.
Brovelli a écrit que le Mouvement liturgique, aujourd’hui, est pour l’Église
un patrimoine important : il incite à la recherche du sens de la liturgie dans la vie de l’Église et à la compréhension de ses fonctions spécifiques dans l’ensemble du développement de la mission. À cette lumière et à partir de cette perspective, nous croyons qu’il a été définitivement éclairci l’affirmation qui parle d’un mouvement liturgique comme d’une réalité qui n’est pas seulement partiellement intégrée dans la réforme conciliaire ; en effet, il la traverse et la dépasse, offrant les délibérations conciliaires et les futures sollicitations d’intérêt pour tous les chrétiens. (BROVELLI, 1987, p. 74)
Washington da Silva Paranhos. FAJE. Texte original en portugais. Soumis le 10/10/2020. Approuvé le 30/11/2021. Publié le 30/12/2021.
Sigles
TS = Tra le sollecitudini
ML = Mouvement Liturgique
Références
BEAUDUIN, L. La piété de l’Église. Louvain: Maredsous, 1914.
BEAUDUIN, L. Mélanges liturgiques recueillis parmi les ouvres de dom Lambert Beauduin à l’occasion de ses 80 ans (1873-1953). Louvain: Centre liturgique, Abbaye du Mont Cesar, 1954.
BEAUDUIN, L. La vraie prière de l’Église. Le VIIIª congrès national des Œuvres catholiques allait se tenir à Malines du 23 au 26 Septembre 1909. Questions Liturgiques/Studies in Liturgy, n. 91, p.37-41, 2010.
BROVELLI, F. Radici, acquisizioni, istanze del movimento liturgico nel nostro secolo. In: BROVELLI, F. (Ed.). Assisi 1956-1986: Il movimento liturgico tra riforma conciliare e attese del popolo di dio. Assisi: Cittadella, 1987. p.47-74.
BUGNINI, A. A Reforma Litúrgica (1948-1975). São Paulo: Paulus, Paulinas, Loyola, 2018.
CASEL, O. Il mistero della chiesa. Roma: Città Nuova, 1965.
CATELLA, A. Dalla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium all’enciclica Mediator Dei. Un percorso interpretativo. In: CATELLA, A. (Ed.). La “Mediator Dei”. Il centro di azione liturgica. Cinquant’anni alla luce del Movimento Liturgico. Roma: CLV – Ed. Liturgiche, 1998. p.11-44.
CATTANEO, E. Il culto Cristiano in occidente. Note storiche. Roma: CLV – Edizioni liturgiche, 2003.
CONTE, N. Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Introdução alla Liturgia. Palermo: Edi Oftes, 1992.
DA SILVA, J. A. O Movimento Litúrgico no Brasil. Estudo histórico. Petrópolis: Vozes, 1983.
DI PIETRO, P. S. Giuseppe M. Tomasi: il dotto, il santo, sacerdote teatino e cardinale. Vicenza: 1986.
FRISQUE, J. L’ecclesiologia nel XX secolo. In: VANDER GUCHT, R.; VORGRIMLER. H. (Eds.). Bilancio della teologia del XX secolo, III. Roma: Città Nuova, 1972. p.2111-2262.
GOPEGUI, Juan A. R. Eukharistia. Verdade e caminho da Igreja. São Paulo: Loyola, 2008.
GRILLO, A. R. Guardini, anotações no diário de 26 de maio de 1953. In: GRILLO, A. Oltre Pio V, La riforma liturgica nel conflito di interpretazioni. Brescia: Queriniana, 2007.
GUARDINI, R. La realtà della chiesa. Brescia: Morcelliana, 1989.
MARSILI, S. Liturgia e santità. Divagazioni liturgiche. Rivista Liturgica, v. 25, p.231-233, 1938.
MARSILI, S. Il mistero di Cristo. Rivista Liturgica, v.26, p.73-78, 1939.
MARSILI, S. Il problema liturgico. Rivista Liturgica, v.26, p.15-19, 1939.
MARSILI, S. A liturgia momento histórico da salvação. In: NEUNHEUSER, B.; MARSILI, S.; AUGÉ, M.; CIVIL, R. (Eds.). Anámnesis 1. São Paulo: Paulinas, 1987. p.37-102.
MARSILI, S. Liturgia. In: SARTORE, D.; TRIACCA, A. M. (Eds.). Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992. p.638-651.
NEUNHEUSER, B. Movimento Litúrgico. In: SARTORE, D.; TRIACCA, A. M. (Eds.). Dicionário de Liturgia. São Paulo, Paulus, 1992. p.787-799.
NEUNHEUSER, B. O Movimento litúrgico: panorama histórico e linhas teológicas. In: NEUNHEUSER, B.; MARSILI, S.; AUGÉ, M.; CIVIL, R. (Eds.). Anámnesis 1. São Paulo: Paulinas, 1986. p.8-36.
PIO X. Motu proprio Tra le sollecitudini. AAS 36. 1903. p.329-331.
PIO XII. Carta Encíclica Mediator Dei et hominum, 20 novembro de 1947. AAS 39. 1947. p.521-595.
PAIANO, M. Il rinnovamento della liturgia: dai movimenti alla chiesa universale. In: ALBERIGO, G.; MELLONI, A. (Eds.). Verso il concilio Vaticano II (1960-1962). Passaggi e problemi della preparazione conciliare. Genova: Marietti,1993. p.67-140.
ROUSSEAU, O. Storia del movimento liturgico. Lineamenti storici dagli inizi del sec. XIX fino ad oggi. Roma: Paoline, 1961.