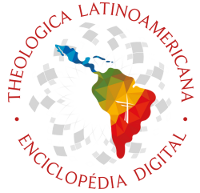Sommaire
Introduction
1 Liturgie et catéchèse dans les premiers siècles du christianisme
2 Liturgie et catéchèse dans les documents récents de l’Église
3 Interaction liturgie et catéchèse : principaux défis
4 Mystagogie : chemin d’interaction liturgie-catéchèse
Conclusion
Références
Introduction
Le mystère pascal est le cœur du christianisme. L’explicitation de sa grandeur et de sa pertinence dans notre vie est la grande tâche de la liturgie et aussi de la catéchèse. Ces deux dimensions de la vie de l’Église, par des chemins différents et essentiellement complémentaires, aident le chrétien à mûrir sa foi et à la traduire concrètement face aux défis du quotidien.
La catéchèse sans la liturgie se vide de sa dimension mystagogique et se réduit à un ensemble d’enseignements théoriques sur Dieu, sur l’Église et sur la vie chrétienne, bien articulés dans leur forme, mais peu capables de donner un sens plus profond à la vie du catéchumène. D’autre part, la liturgie sans la catéchèse manque de la compréhension nécessaire à l’accueil et à l’expérience rituelle, qui facilite l’immersion dans le mystère célébré et touche le cœur du fidèle célébrant. Bien articulées, cependant, en interaction constante, la liturgie et la catéchèse conduisent le chrétien à célébrer avec conscience et piété les rites chrétiens, comme le préconisait Sacrosanctum Concilium (SC, n. 14.19), ainsi qu’à considérer les contenus auxquels on croit comme toujours orientés vers la célébration de la foi, dont la liturgie est l’épiphanie.
En prenant comme référence cette interaction entre liturgie et catéchèse, le présent texte, après un bref survol de la manière dont cette relation s’est déroulée dans les premiers siècles du christianisme, présente ensuite les perspectives ouvertes par les documents récents de l’Église sur cette interaction, en indiquant, dans un troisième temps, les principaux défis rencontrés et en désignant le chemin de la mystagogie comme celui qui peut le mieux articuler ces deux dimensions constitutives de la vie et de l’action évangélisatrice de l’Église.
1 Liturgie et catéchèse dans les premiers siècles du christianisme
Les premiers siècles du christianisme témoignent de la richesse de l’interaction entre liturgie et catéchèse, bien attestée par l’ancien principe lex orandi lex credendi, qui exprime bien à quel point liturgie et catéchèse s’interpénètrent et concourent à modeler le cœur et la conscience du chrétien dans la perspective d’une foi bien vécue. Dès le début, c’est autour de la table eucharistique et de la Parole que les disciples de Jésus ont consolidé leur identité chrétienne et se sont fortifiés pour le témoignage de la foi, comme nous le rapporte le livre des Actes des Apôtres :
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières […]. D’un seul cœur, ils fréquentaient chaque jour le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et s’attirant la sympathie de tout le peuple. (Ac 2, 42.44.46-47)
On peut encore rappeler l’importance de la catéchèse associée à la liturgie dans le christianisme primitif, en évoquant ici les figures des saints Pères (IIIe-VIIe s.), dont les prédications, presque toujours issues de contextes de célébration, éclairaient le chemin des fidèles chrétiens et des catéchumènes. Ils furent de grands mystagogues, qui conduisaient les gens à l’expérience du mystère de Dieu, de sa grâce qui sauve, par un chemin médiatisé par la spiritualité, par la contemplation des signes sacrés, toujours illuminés par la Parole de Dieu. De cette manière, en célébrant la foi au ressuscité, la Parole était continuellement approfondie et transmise.
Cependant, des changements historiques ont fortement impacté le christianisme à partir du IVe siècle et, avec l’avènement de ce que l’on appelle la chrétienté, la liturgie et la catéchèse se sont progressivement éloignées l’une de l’autre. La liturgie s’est transformée en ritualisme, avec une préoccupation excessive pour ses aspects extérieurs et une focalisation sur le sacramentalisme. Quant aux contenus de la foi chrétienne, ils se sont dilués dans les éléments qui composaient la chrétienté, dans les définitions dogmatiques des grands conciles et, à partir du Xe siècle, dans les œuvres qui avaient pour but de systématiser la théologie et les catéchismes. On perçoit dès lors non seulement des points d’éloignement entre ces deux dimensions fondamentales de la vie de l’Église, mais aussi des conflits significatifs (PAIVA, 2020, p. 42).
Ce fut le Concile Vatican II, avec ses mouvements préparatoires, qui a jeté de nouvelles lumières sur la vie de l’Église en général, et sur la liturgie en particulier. Bien que les pères conciliaires n’aient produit aucun document spécifique sur la catéchèse, son inspiration et ses nouveaux paradigmes pastoraux ont eu et continuent d’avoir des effets rénovateurs également dans ce domaine de l’éducation de la foi. De nombreux textes précieux ont été produits par le Magistère, depuis ceux des papes et des dicastères romains jusqu’aux documents des conférences épiscopales, tous soulignant l’urgence de retrouver la précieuse interaction entre la liturgie et la catéchèse, comme le signale, par exemple, le Directoire pour la Catéchèse (DPC) de 2020 :
La liturgie est l’une des sources essentielles et indispensables de la catéchèse et de l’Église, non seulement parce que la catéchèse peut y puiser des contenus, des langages, des gestes et des paroles de la foi, mais surtout parce qu’elles s’appartiennent mutuellement dans l’acte même de croire. (DPC, n. 95)
2 Liturgie et catéchèse dans les documents récents de l’Église
Quelques documents du Concile Vatican II, même s’ils ne font que l’évoquer, offrent des contributions importantes pour penser la relation mutuelle entre la liturgie et la catéchèse. Le décret Christus Dominus, sur l’action pastorale des évêques, en demandant aux pasteurs la sollicitude pour la catéchèse, tient à affirmer que la liturgie est l’une de ses sources essentielles :
qu’ils se préoccupent de l’instruction catéchétique, qui a pour but de rendre vivante, explicite et agissante la foi éclairée par la doctrine, qu’elle soit administrée avec un soin diligent tant aux enfants et adolescents qu’aux jeunes et même aux adultes […] Que cette instruction se fonde sur la Sainte Écriture, la tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l’Église. (CD n. 14)
La déclaration sur l’éducation chrétienne, intitulée Gravissimum Educationis, en définissant les objectifs de la catéchèse, affirme qu’elle « illumine et fortifie la foi, nourrit la vie selon l’esprit du Christ, conduit à une participation consciente et active au mystère liturgique et éveille à l’activité apostolique » (GE n. 4).
Dans les domaines de la liturgie et de la catéchèse, spécifiquement, le Concile Vatican II a déclenché un processus fécond et continu de changements. Synodes, séminaires, directoires liturgiques et catéchétiques, rencontres de formation d’agents, beaucoup de matériel produit, tout cela a créé un climat favorable au renouveau nécessaire. Il convient de rappeler la VIe Semaine Internationale de Catéchèse (1968), tenue à Medellín, la publication du Directoire Catéchétique Général à Rome (1971), la publication du document Evangelii Nuntiandi (1976), par le pape Paul VI, sur l’évangélisation, et l’exhortation apostolique Catechesi Tradendae, en 1979, par le pape Jean-Paul II.
Dans ce dernier document, le pape souligne le lien nécessaire et intrinsèque entre catéchèse et liturgie, en affirmant clairement :
La catéchèse est intrinsèquement liée à toute l’action liturgique et sacramentelle, car c’est dans les sacrements, et surtout dans l’Eucharistie, que le Christ Jésus agit en plénitude pour la transformation des hommes. […] La catéchèse conduit nécessairement aux sacrements de la foi. D’autre part, une pratique authentique des sacrements a forcément un aspect catéchétique. En d’autres termes, la vie sacramentelle s’appauvrit et devient bien vite un ritualisme creux si elle n’est pas fondée sur une connaissance sérieuse de ce que signifient les sacrements. Et la catéchèse s’intellectualise si elle ne puise pas sa vie dans une pratique sacramentelle. (CT n. 23)
Au Brésil, le grand jalon dans la dimension catéchétique fut le document 26 de la Conférence Nationale des Évêques, Catequese Renovada: orientações e conteúdo (Catéchèse Rénovée : orientations et contenu). Son impact a changé le cours du cheminement catéchétique, en plus de toucher profondément d’autres dimensions de la vie pastorale de l’Église. Le nom même annonçait déjà son intention : rénover la pratique catéchétique de l’intérieur, en offrant des principes, des orientations et un contenu pour soutenir ce processus de changement.
Deux numéros de ce document, en particulier, reflètent l’importante interaction entre liturgie et catéchèse. Au numéro 89, nous pouvons lire :
Non seulement par la richesse de son contenu biblique, mais par sa nature de synthèse et de sommet de toute la vie chrétienne, la liturgie est une source inépuisable de catéchèse. En elle se trouvent l’action sanctificatrice de Dieu et l’expression priante de la foi de la communauté. Les célébrations liturgiques, avec la richesse de leurs paroles et de leurs actions, de leurs messages et de leurs signes, peuvent être considérées comme une « catéchèse en acte ». Mais, à leur tour, pour être bien comprises et vécues, les célébrations liturgiques ou sacramentelles exigent une catéchèse de préparation ou d’initiation. (CNBB, 1983, n. 89)
Et le numéro suivant ajoute :
La Liturgie, avec son organisation particulière du temps (dimanches, temps liturgiques comme l’Avent, Noël, le Carême, Pâques, etc.) peut et doit être une occasion privilégiée de catéchèse, ouvrant de nouvelles perspectives pour la croissance de la foi, par le biais des prières, de la réflexion, de l’imitation des saints, et de la découverte non seulement intellectuelle, mais aussi sensible et esthétique des valeurs et des expressions de la vie chrétienne. (CNBB, 1983, n. 90)
En 1997, le Directoire Général pour la Catéchèse (DGC) a été publié par la Sacrée Congrégation pour le Clergé, montrant une sensibilité significative à la thématique de l’interaction entre liturgie et catéchèse, en mettant l’accent sur la nécessité d’une catéchèse liturgique comme moyen d’initier les catéchumènes à la vie de célébration. On peut y lire :
La catéchèse liturgique, qui prépare aux sacrements et favorise une compréhension et une expérience plus profondes de la liturgie. Elle explique le contenu des prières, le sens des gestes et des signes, éduque à la participation active, à la contemplation et au silence. Elle doit être considérée comme « une forme éminente de catéchèse » (DGC, n. 71).
Le document 84 de la Conférence Nationale des Évêques du Brésil, Diretório Nacional de Catequese (DNC), a consacré plusieurs numéros au thème de la liturgie et de la catéchèse, en réaffirmant toujours la dépendance mutuelle de ces deux dimensions de l’action pastorale de l’Église. Il considère d’abord la liturgie comme source de la catéchèse, et cite la proclamation de la Parole, l’homélie, les prières, les rites sacramentels, le vécu de l’année liturgique et les fêtes comme des moments d’éducation et de croissance dans la foi. Sans hésiter, il affirme que « les authentiques itinéraires catéchétiques sont ceux qui incluent dans leur processus le moment de célébration comme composante essentielle de l’expérience religieuse chrétienne » (DNC, n. 118).
Juste après, le même Directoire souligne l’urgence d’une catéchèse liturgique, en disant qu’« il est de la tâche fondamentale de la catéchèse d’initier efficacement les catéchumènes et les catéchisants aux signes liturgiques et, par leur intermédiaire, de les introduire dans le Mystère Pascal » (DNC, n. 120). Ainsi, il désigne comme mission de la catéchèse de préparer le chrétien à l’initiation sacramentelle et de l’aider à vivre en bon chrétien par les prières, les gestes et les signes, le silence, la contemplation, la présence de Marie et des saints, l’écoute de la Parole, etc. (DNC, n. 120).
Digne de mention ici est l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium (EG), du pape François. En réfléchissant à la nécessité d’une catéchèse kérygmatique et mystagogique, il propose la valorisation des symboles liturgiques de l’initiation chrétienne et une catéchèse centrée sur la Parole, mais qui ne néglige pas « un cadre adéquat, une motivation attrayante, l’utilisation de symboles éloquents » (EG, n. 166), réaffirmant la traditionnelle via pulchritudinis, chemin de la beauté qui fait resplendir dans le cœur de l’homme la vérité et la bonté du ressuscité (DGC, n. 167).
Plus récemment, le document 107 de la CNBB, Iniciação à vida cristã: itinerário para formar discípulos missionários (IVC), dans un contexte plus catéchuménal, a de nouveau insisté sur cette interaction entre catéchèse et liturgie, affirmant que « les processus d’Initiation se fondent sur la Sainte Écriture et sur la liturgie, ils éduquent à l’écoute de la Parole et à la prière personnelle, par la lecture priante, mettant en évidence une relation étroite entre Bible, catéchèse et liturgie » (IVC, n. 66). Et il continue : « Une telle récupération de l’esprit catéchuménal implique l’engagement de renouer le partenariat et l’union entre liturgie et catéchèse qui, au fil des siècles, ont été compromis » (IVC, n. 74).
Le Directoire pour la Catéchèse (DC), du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation, publié en 2020, en traitant des sources de la catéchèse, consacre de précieux numéros à la liturgie (DC, n. 95-98), en plus d’autres affirmations importantes, tout au long du texte : l’interaction nécessaire de la liturgie avec la catéchèse ; la liturgie comme lieu privilégié de la catéchèse du peuple de Dieu, en conservant le caractère célébrant de la liturgie ; l’urgence d’un itinéraire mystagogique dans la catéchèse, qui mène à l’interprétation des rites à la lumière des événements salvifiques, introduit au sens des signes liturgiques et présente la signification des rites pour la vie chrétienne dans toutes ses dimensions ; l’importance de la participation des catéchisants à la liturgie dominicale et aux fêtes de l’année liturgique.
3 Interaction liturgie et catéchèse : principaux défis
L’interaction féconde de la liturgie avec la catéchèse est garantie dans les documents de l’Église et très bien enracinée dans sa tradition. Au quotidien, cependant, dans une grande partie des communautés ecclésiales, il reste encore beaucoup à faire. « Dans la situation actuelle, les aspects problématiques et les points de friction ne manquent pas, que ce soit dans le domaine de la réflexion catéchétique et liturgique, ou sur le terrain de la pratique pastorale » (ALBERICH, 2004, p. 305).
L’un des grands défis concerne une praxis catéchétique qui n’initie pas réellement à la liturgie. Malgré la bonne volonté des catéchistes et quelques pas déjà franchis en ce sens, la formation liturgique dans le cadre de la catéchèse est encore embryonnaire et limitée à la conception de « célébrer » avec les catéchumènes. On parle beaucoup de l’importance de la liturgie, mais on célèbre encore peu. Et il n’est pas possible d’initier quelqu’un à la ritualité uniquement avec des discours. Et quand on célèbre, la difficulté du catéchiste à articuler foi, vie, Parole de Dieu, symboles, gestes, bref, ces éléments qui constituent essentiellement le rite chrétien, est évidente. Cette difficulté a été soulignée il y a longtemps par le Directoire Général de la Catéchèse, lorsqu’il a attiré l’attention :
Souvent […] la pratique catéchétique présente un lien faible et fragmenté avec la liturgie : une attention limitée aux signes et rites liturgiques, une faible valorisation des sources liturgiques, des parcours catéchétiques ayant peu ou pas de relation avec l’année liturgique, une présence secondaire des célébrations dans les itinéraires de catéchèse. (DGC, n. 30)
Alberich est d’avis que les dimensions anthropologique et expérientielle, celles qui traitent des questions de l’homme et de ses expériences de vie, de charité et de service, évidemment importantes dans la catéchèse, ont fini par occulter la centralité de l’expérience liturgique dans la croissance de la foi (ALBERICH, 2004, p. 306). Ainsi, on peut parler d’une catéchèse détachée de l’expérience liturgique ou qui ne la considère que comme un appendice de ses processus.
Un autre défi non moins préoccupant est l’instrumentalisation de la liturgie à des fins didactiques et pédagogiques pour satisfaire le besoin d’expliquer les rites aux enfants et aux jeunes. Ces pratiques ne tiennent pas compte de la nature de la liturgie, essentiellement célébrative et mystagogique, lui imposant un langage et une méthodologie étrangers à son essence même, transformant la célébration en un « cours » plus animé sur la messe, par exemple. En plus de ne pas initier réellement à la dynamique célébrative de la foi, car la structure mystagogique et psychologique propre au rite n’est pas respectée, cela provoque de la résistance et un certain ennui dans les assemblées et ne leur permet pas d’être enchantées par la dimension contemplative et priante de la foi.
Les déficiences dans la manière de célébrer, tant de la part des assemblées que de beaucoup de leurs ministres, y compris les ministres ordonnés, constituent également un autre défi important pour consolider cette relation si importante entre la liturgie et la catéchèse. Nous ne pouvons pas ignorer que la liturgie est la principale transmettrice de la foi de l’Église, une véritable catéchèse en acte. Ainsi, le fait de participer à une célébration devrait être une manière privilégiée de recevoir et d’accueillir la foi transmise par la profondeur et la richesse des rites constitués au cours de deux millénaires par l’Église. Traversés par la Parole, les rites liturgiques communiquent, en eux-mêmes et dans leur vécu concret, la foi la plus authentique de l’Église, centrée sur le mystère pascal de Jésus-Christ. De cette manière, l’assemblée saisit et comprend sa foi à mesure qu’elle fait advenir le rite dans sa vie. Une liturgie célébrée de manière laxiste, improvisée ou précipitée par le volontarisme de ses ministres crée des difficultés pour qu’une authentique éducation de la foi chrétienne puisse en découler.
D’autres défis peuvent encore être énumérés, comme une vision sacramentelle de la catéchèse, la présence timide de l’année liturgique dans les processus catéchétiques, le subjectivisme allié à l’ignorance de la théologie liturgique de la part de nombreux laïcs et ministres ordonnés, le manque de préparation des catéchistes pour faire interagir les deux dimensions de la liturgie et de la catéchèse dans leur vécu, leur pratique pastorale et leur témoignage de vie, etc.
4 Mystagogie : chemin d’interaction de la liturgie avec la catéchèse
Penser l’interaction entre liturgie et catéchèse touche directement à la thématique de la mystagogie, si chère à la tradition et à la spiritualité du christianisme. En vérité, dès le judaïsme, la méthode mystagogique s’est déjà manifestée comme une voie privilégiée d’éducation de la foi des nouvelles générations et de réaffirmation de la foi pour ceux qui sont déjà initiés. Un des meilleurs exemples de cela se trouve dans la célébration annuelle de la Pâque juive. La prescription contenue dans le livre de l’Exode a toujours résonné de manière souveraine pour eux :
Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l’a promis, vous observerez ce rite. Alors vos enfants vous demanderont : « Que signifie ce rite ? ». Vous répondrez : « C’est le sacrifice de la Pâque du Seigneur, qui est passé à côté des maisons des Israélites en Égypte ». (Ex 12, 25-27)
« Que signifie ce rite ? » était la question rituellement réservée au plus jeune. Il ne s’agit pas seulement d’une formalité rituelle, mais de quelque chose d’essentiel. La réponse à cette question contenait le contenu qui soutenait et donnait sens au rite de la Pâque. Et en répondant, le plus âgé de la famille faisait mémoire des hauts faits libérateurs de Dieu en faveur de son peuple, garantissant l’historicité du rite, l’insérant dans une histoire du salut qui se continuait dans leur vie. « Que signifie ce rite ? » était la question que posaient les catéchumènes et les néophytes du christianisme primitif, cherchant à comprendre la foi qu’ils embrassaient. De la réponse dépendait l’éloquence du rite dans leur vie. Sans la réponse, le rite resterait muet et inexpressif (BOSELLI, 2014, p. 29). La réponse venait avec les catéchèses mystagogiques des saints Pères qui, partant de la Parole, unissaient l’Ancien et le Nouveau Testament et aidaient les fidèles à plonger au cœur du mystère pascal. « Que signifie ce rite ? » est la question qui aujourd’hui et toujours résonnera dans l’Église de la part des chrétiens et des non-chrétiens, cherchant un sens aux actions liturgiques, c’est-à-dire cherchant à puiser dans la ritualité une catéchèse qui les aide à dévoiler ou, du moins, à accueillir le mystère célébré.
La constitution Sacrosanctum Concilium s’est attachée à retrouver la centralité du mystère pascal dans l’action liturgique et à montrer son incidence sur toute la ritualité de l’Église. Elle a cherché à libérer la liturgie de sa conception extériorisée, vue seulement comme une cérémonie, en attirant l’attention sur son essence. Elle l’a définie comme le culte parfait que le Christ total, tête et membres, rend au Père, dans l’Esprit Saint, par des rites et des prières. Elle est le sommet et la source de la vie de l’Église (SC n. 7, 10, 48). Per ritus et preces: c’est de cette manière que l’Église, peuple de Dieu, reconnaît le crucifié ressuscité et le fait connaître par la médiation des signes sacrés, des paroles, des gestes, du silence, des prières… Et, en rassemblant ses assemblées pour ses rites, elle transmet sa foi au Christ. Les événements salvifiques, présents et actualisés dans chaque célébration, fondent et légitiment les rites, les libérant de la magie et de l’illusion (BOSELLI, 2014, p. 29). De cette manière, c’est par les signes qui touchent les sens, tels des ponts allant du cœur des chrétiens au cœur de Dieu lui-même, que l’on parvient au Sens par excellence, le Seigneur ressuscité lui-même. Mais, pour bien franchir ces ponts, il appartient à l’Église d’initier ses fidèles à l’univers liturgique et à son riche langage. Boselli, paraphrasant saint Jérôme, qui disait “Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est”, ose dire : “ignoratio liturgiae, ignoratio Christi est”, c’est-à-dire, ne pas connaître la liturgie signifie ne pas connaître le Christ (BOSELLI, 2014, p. 32).
Une catéchèse mystagogique est celle qui conduit à un approfondissement et à une plus grande conscience du mystère qui, pour nous, est « le Christ, espérance de la gloire » (Col 1,27). Elle se présente comme l’unique possibilité de libérer le catéchumène d’une relation théorique avec Dieu, l’aidant à plonger dans sa grâce et à l’expérimenter comme son Seigneur et sa vie. Selon le document 107 de la Conférence nationale des évêques du Brésil, il est impensable d’avoir un processus catéchétique qui ne tienne pas compte de la très haute valeur de l’élément mystagogique, et celui-ci passe nécessairement par la liturgie, à laquelle a incombé, depuis le début du christianisme, en pleine interaction avec la catéchèse, la mission d’initier à la foi (Doc. 107, n. 70).
Le Directoire pour la Catéchèse offre quelques éléments essentiels pour parcourir un itinéraire mystagogique dans la catéchèse, ce qui, à notre avis, contribuerait beaucoup à un rapprochement plus efficace entre la liturgie et la catéchèse : l’interprétation des rites à la lumière des événements salvifiques, en relisant la vie de Jésus, à partir de l’Ancien Testament ; l’introduction au sens des signes liturgiques, en éduquant la sensibilité des fidèles au langage des signes et des gestes qui, unis à la Parole, constituent le rite ; et la présentation de la signification des rites pour la vie chrétienne dans toutes ses dimensions (DPC, n. 98).
Conclusion
Nous avons parcouru un chemin rapide mais dense, cherchant à montrer, plus que l’importance, l’urgence de chercher des alternatives pour faire interagir les dimensions liturgique et catéchétique dans notre pratique pastorale. Nous avons vu comment les documents récents de l’Église soulignent l’enrichissement mutuel de ces deux dimensions, lorsque cette interaction est réussie, ainsi que les défis pour qu’elle se réalise effectivement. Nous avons terminé en considérant comme une réponse efficace possible une catéchèse plus mystagogique, qui parvienne à insérer le catéchumène dans l’expérience de la rencontre avec le Christ et à approfondir sa foi dans les médiations des signes et des rites sacrés, toujours éclairés par la Parole de Dieu.
Ce qui est en jeu, c’est la nécessité de reconstruire l’unité de l’expérience de la foi, sans réductionnisme d’aucune de ses dimensions, mais en cherchant à la concevoir dans sa globalité. Cela exige d’articuler liturgie, catéchèse et vie chrétienne. Si nous sommes d’accord avec l’Église lorsqu’elle affirme que la sainte liturgie constitue le « sommet et la source de la vie de l’Église » (SC, n. 10), elle se constitue comme un véritable locus theologicus, ayant toujours une fonction catéchétique pour tout le peuple de Dieu, dans la richesse et l’efficacité de ses rites. Pour que toute cette force soit vécue avec profit, il est requis de la catéchèse le soin propédeutique d’initier les enfants, les jeunes et les adultes à l’univers liturgique, moins par ce qu’elle dit que par ce qu’elle fait, en recourant au riche patrimoine que la liturgie offre pour rendre possible au chrétien l’accès au mystère de la foi qu’elle professe et célèbre continuellement.
Vanildo de Paiva. Prêtre de l’Archidiocèse de Pouso Alegre, Minas Gerais (Brésil). Master en psychologie et professeur à la Faculté Catholique de Pouso Alegre. Texte original en portugais. Envoyé : 30/07/2022 ; approuvé : 30/10/2022 ; Publié : 30/12/2022.
Références
ALBERICH, E. Catequese evangelizadora. Manual de catequética fundamental. São Paulo: Salesiana, 2004.
BOSELLI, G. O sentido espiritual da liturgia. v. 1. Brasília: CNBB, 2014. Coleção vida e liturgia da Igreja.
CNBB. Iniciação à vida cristã: itinerário para formar discípulos missionários. Documento 107. Brasília: Edições CNBB, 2017.
CNBB. Catequese renovada. Orientação e conteúdo. Documento 26. 29.ed. São Paulo: Paulinas, 2000.
CNBB. Diretório Nacional de Catequese. Documento 84. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2006.
FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. São Paulo: Loyola; Paulus, 2013.
JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica Catechesi Tradentae. 15.ed. São Paulo: Paulinas, 1982.
PAIVA, V. Catequese e liturgia: duas faces do mesmo Mistério. Reflexões e sugestões para a interação entre catequese e liturgia. São Paulo: Paulus, 2020.
PAULO VI. Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi. São Paulo: Loyola, 1976.
PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Diretório para a Catequese. São Paulo: Paulus, 2020.
SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA O CLERO. Diretório Geral para a Catequese. São Paulo: Loyola; Paulinas, 1998.
VATICANO II. Constituição Sacrosanctum Concilium. In: VIER, F. (org.). Compêndio do Vaticano II. 19.ed. Petrópolis: Vozes, 1987.
VATICANO II. Decreto Christus Dominus. In: VIER, F. (org.). Compêndio do Vaticano II. 19.ed. Petrópolis: Vozes, 1987.
VATICANO II. Declaração Gravissimum Educationis. In: VIER, F. (org.). Compêndio do Vaticano II. 19.ed. Petrópolis: Vozes, 1987.