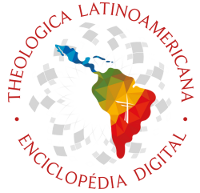Sommaire
Introduction
1 L’intelligence de la foi à partir des « rites et prières »
2 Modèles paradigmatiques de la science liturgique et sacramentelle
3 Perspectives d’une nouvelle relation
Références
Introduction
La réflexion sur la méthode de la science liturgique et sacramentelle (SLS), notamment au cours des deux derniers siècles dans le contexte culturel occidental, comporte, comme tout autre champ de la connaissance et de la condition de la raison scientifique, l’accumulation de données, la construction de paradigmes, le caractère provisoire, la spécialisation des domaines, la délimitation méthodologique, les approches différenciées et la possibilité d’absolutiser ce qui n’est qu’un aspect historique, rituel, sémantique, linguistique, phénoménologique, spéculativo-théologique et pastoral.
L’intérêt pour la réflexion sur l’action liturgique sacramentelle coïncide, peut-on affirmer, avec l’exigence évangélique même de rendre raison intelligemment des « mirabilia Dei » advenues une fois pour toutes dans le mystère pascal de Jésus-Christ. En effet, la communauté chrétienne, depuis ses débuts, a de diverses manières célébré, cru et vécu cette réalité pleine de foi. Par la suite, cette ritualité a été explicitée à travers les catégories hellénistiques par les Pères de l’Église, à l’époque patristique. Au Moyen Âge, on a constaté un éloignement entre théologie-liturgie-sacrements par le biais de catégories allégoriques et scolastiques, tandis que la période post-tridentine a été fortement caractérisée par le moment disciplinaire de la Contre-Réforme, par la crise de la théologie scolastique, par l’intérêt croissant pour les études historiques, par l’abandon progressif de l’interprétation allégorique de la liturgie et par la nécessité de répondre aux critiques des réformateurs protestants.
Aux XVIIe-XVIIIe siècles, la liturgie se découvrira avec une attention excessive à l’aspect rubriciste-juridique et, dans ce contexte, apparaissent l’intérêt et la naissance de la science liturgique (SL), surtout dans la première moitié du XIXe siècle, en Allemagne, motivée, d’une part, par la « Katholische Tübinger Schule » et la Néo-scolastique d’orientation thomiste, et d’autre part, par la perspective ecclésiologique et le renouveau de la théologie des sacrements à travers l’action rituelle à partir de l’événement christologique. Cela déclenchera, progressivement, un nouveau processus dans la manière de penser la réalité liturgico-sacramentelle. De là naîtront la réflexion et la maturation de certaines constantes qui deviendront un véritable foisonnement d’idées, surtout en Europe, et qui sera appelé le Mouvement liturgique. Pour Ubbiali (1993), ce mouvement réagira au manque d’attention que le manuel de sacramentaire réservait à la praxis liturgique, et approfondira la relation entre la théologie–liturgie-sacrements, acquérant consistance et qualité dans les intuitions et les réponses à la « Question liturgique » et qui, avec l’approfondissement de concepts fondamentaux comme la participation active, la pensée totale, le mystère du culte, la connaissance symbolique, contribuera fortement à la réflexion avant, pendant et après le Concile Vatican II.
1 L’intelligibilité de la foi à partir des « rites et prières » (MEDEIROS, 2011, p. 15-42)
La Théologie des sacrements, déjà avant l’événement conciliaire de Vatican II, avait dégagé quelques axes de l’intelligence de ces sacrements, surtout dans les domaines de l’ecclésiologie et de l’anthropologie. En premier lieu, l’ecclésiologie a été orientée à partir de la perspective de Rahner (1965). Dans cette optique, l’Église est lue comme le symbole permanent de l’action salvifique divine, la réalité historique visible dans laquelle Dieu se donne lui-même. Dans le domaine anthropologique, l’attention à l’humain est certainement la première intention de soustraire le sacrement à l’éloignement par rapport à la culture moderne. En ce sens, une telle réflexion a produit une décision nette d’élargir la dimension anthropologique du sacrement et a ainsi ajouté une position propre pour compléter le discours théologique déjà structuré et unifié en clé sacramentaire. Spécifiquement dans la séquence : la christologie (Jésus-Christ sacrement primordial), l’ecclésiologie (l’Église sacrement fondamental, ou radical), la sacramentologie (les sept sacrements), on a ajouté encore l’anthropologie (la personne et le monde, sacrement naturel).
Le versant proprement scientifique de la liturgie, pour sa part, peut être considéré comme ayant trouvé en Guardini (1921) l’un des principaux représentants dès la première heure du Mouvement liturgique. Il fut le premier à aborder la question épistémologique, concluant que la science liturgique exigeait deux niveaux complémentaires, qu’il qualifia d’investigation historique et d’investigation systématique. Selon lui, l’investigation historique se déroulerait à un niveau diachronique-évolutif et aurait pour objet l’étude du devenir du culte, sans quoi nous tomberions dans des affirmations gratuites. Et l’investigation systématique, à un niveau synchronique, aurait pour objet l’étude de l’Église, en tant que sujet du culte, et de ses éléments contraignants et permanents. Sans la réflexion systématique, l’histoire se perdrait dans des données éparses.
Actuellement, nous pouvons résumer en trois grandes tendances méthodologiques l’approfondissement épistémologique de la liturgie, comme des domaines où l’on peut puiser son especificum en tant que science structurée, avec des méthodes et des lois propres : la systématique, l’historique et la pastorale.
Par conséquent, on peut dire que ces trois directions sont présentes simultanément dans la réflexion de la recherche liturgique, avec leurs représentants légitimes, dans la quête d’une plus grande consistance épistémologique, ce qui est attesté par une pluralité de théologies liturgiques et sacramentelles contemporaines. Cependant, le principe directeur doit garder à l’esprit que l’intellectus fidei a toujours été, depuis le début, en relation avec l’action liturgique de l’Église. Par conséquent, la réflexion théologique ne peut jamais ignorer l’ordre sacramentel institué par le Christ lui-même et, d’autre part, l’action liturgique ne peut jamais être considérée de manière générique, en laissant de côté le mystère de la foi (Sacramentum caritatis, n. 34).
Indéniablement, la théologie sacramentaire et la théologie liturgique se sont rapprochées au cours des dernières décennies, ayant comme « locus » commun l’attention au rite, en plaçant la question du symbole dans son contexte propre : l’action rituelle. Par conséquent, la perspective logique pour réfléchir à la question du symbole en clé herméneutique pour la compréhension des sacrements devient l’action rituelle. Assurément, la SLS considère que l’un des fruits les plus significatifs du Mouvement liturgique fut de percevoir que le rite est la forme dans laquelle le sacrement advient. C’est là que se situe le « locus » de la rencontre avec le Seigneur, de la profession de foi, de la synergie, de la visibilité, de l’invisibilité et la source de la théologie comme moment d’investigation rationnelle de la foi à la lumière de ce qui est aujourd’hui appelé la nouvelle frontière de la « question liturgique », selon la contribution de Grillo dans sa « liturgie fondamentale : introduction à la théologie de l’action rituelle » (2022a).
Par conséquent, le concept de forme entre dans la théologie contemporaine comme une nouvelle catégorie, inaugurant, au sens moderne du mot, la compréhension de la SL et du processus de réforme liturgique mis en œuvre tout au long du XXe siècle, comme l’affirme J. Ratzinger (2019). Un tel concept est capable d’établir des connexions avec divers domaines qui forment l’ensemble de la réflexion liturgique et sacramentelle.
De cette manière, la réflexion de la SLS contemporaine surmonte progressivement les catégories inappropriées dans la définition et la compréhension de l’action liturgico-sacramentelle de l’Église et, en même temps, met à l’épreuve les catégories (rite, forme, langages, mystagogie) en vue d’une réélaboration du savoir unitaire et d’une alliance solide entre une sacramentaire qui découvre le genre rituel et les nouveaux ordines liturgiques.
2 Modèles paradigmatiques de la Science liturgique et sacramentelle (MEDEIROS, 2014, p. 145-168)
Nous pouvons recueillir, à partir de quelques propositions de modèles ou paradigmes contextualisés, l’horizon des études sur la SLS de ces dernières décennies. C’est pourquoi nous nous proposons de parcourir l’évolution du sujet à l’étude dans les contextes allemand, francophone, espagnol, anglophone et brésilien.
2.1 Contexte allemand
La contribution de Guardini (1921) sur la méthode systématique de la science liturgique a été très significative pour l’étude de la SLS. En effet, il entrevoit la liturgie comme étant en consonance et intégrée à la théologie, étant donné que celle-ci est liée à la vie surnaturelle, qu’elle devient compétente par l’action de l’Esprit Saint et qu’elle est orientée par le Magistère. De plus, l’aspect théologique de la liturgie doit toujours être présent dans tout type d’étude systématique que l’on réalise. Pour Guardini, la liturgie en tant que théologie possède une méthode propre qui la différencie non seulement des autres sciences, mais aussi au sein du domaine théologique, et elle ne peut même pas être considérée comme faisant partie de la théologie pastorale qui s’élabore et se développe à partir de la praxis et qui entre dans une étude systématique de la liturgie. Nous pouvons dire que, pour Guardini, la liturgie est théologie, et c’est pourquoi cette perspective de voir et de connaître recueille le contenu de la foi dans la manifestation cultuelle de la vie de l’Église.
De plus, Casel (1941) affirme que l’œuvre du salut de Jésus-Christ, présente dans la célébration liturgique, n’est pas seulement un dogme à croire, mais une « mise en acte de la foi » selon une forme symboliquement sacramentelle déterminée, c’est-à-dire que l’on fait de la théologie au sens propre lorsque l’on cherche à approfondir la connaissance de cette œuvre de salut à travers le symbole rituel. Ce n’est pas une connaissance abstraite, mais l’approfondissement de cette « réalité salvifique » présente dans le moment liturgique, c’est-à-dire comme salut dans une perspective symbolico-rituelle. Ainsi, pour Casel, la théologie liturgique n’existe que lorsque la donnée de la foi assume la dimension de communication concrète du mystère du Christ à l’Église, lorsqu’il y a un dialogue sur « Dieu à partir de Dieu ».
La théologie liturgico-sacramentelle, dans le contexte allemand, a également cherché le contact avec les sciences humaines, en affinant son discours, à la recherche d’une catégorisation plus scientifique. Évaluant la science liturgique vingt ans après le Concile Vatican II, Häussling (1982) analyse les vicissitudes par lesquelles elle est passée, principalement en confrontation avec les sciences humaines, l’athéisme, la réalité œcuménique et les défis des liturgies pour jeunes. De plus, Gärtner et Merz (1984) cherchent à émettre les principes d’une méthode intégrative de la SL, partant des paradigmes traditionnels mais dialoguant avec les sciences humaines, valorisant l’aspect de l’expérience, en vue d’une méthode empirico-critique de la SL. Pour sa part, Stenzel approfondit le thème en référence, en discourant sur la liturgie comme lieu théologique.
D’autre part, Häussling (1982) constate que la liturgie a besoin de dialoguer avec les autres disciplines théologiques, comme la dogmatique, l’exégèse et la théologie morale. Pour lui, une autre cause du manque de considération pour la liturgie dans le domaine théologique est une fausse idée de ce qu’est la liturgie, maintenant réformée et compréhensible. De plus, Lehmann (1980) écrit sur la célébration en tant qu’expression de la foi et considère que les « loci theologici » sont le résultat d’une méthodologie scolastique, et que la science théologique, au fil des ans, a perdu son lien avec la liturgie de l’Église. Lehmann s’aligne sur la position des théologiens qui voient une telle collaboration étroitement liée à la théologie pratique homilétique, la théologie pastorale, la pédagogie religieuse et la catéchétique, et en relation avec la théologie des sacrements, principalement en ce qui concerne la perspective dogmatique et la théologie morale, le droit des Sacrements et l’œcuménisme. Vorgrimler (1992), quant à lui, défend la liturgie comme argument de la dogmatique. Et il s’interroge sur certaines questions relatives à la liturgie dans le but de déployer des efforts pour une plus grande coopération entre liturgie et dogmatique.
La théorie sur les sacrements, en Allemagne, a gagné du terrain dans les années soixante-dix du siècle dernier, selon Seils (1994), au point de devenir d’usage courant. En ce sens, la sacramentaire a trouvé une nouvelle inspiration et a connu un profond changement, ce qui semblait justifié par la nouvelle attention élargie portée à la compréhension de la sacramentalité. De telles transformations peuvent être substantiellement ramenées à la théologie de l’« Église-sacrement » qui a marqué le déclin de la méthodologie manualistique, incapable de montrer la coexistence des signes efficaces de la grâce avec le mystère de la rédemption. Selon la lecture de Bozzolo (1999), les courants devenus les plus significatifs dans l’optique d’un approfondissement de l’identité symbolique allaient dans trois directions : le sacrement comme symbole dans la perspective anthropologique d’ouverture au sens de l’existence (Ratzinger (1966) et Kasper (1969)) ; le sacrement comme « praxis de l’espérance », c’est-à-dire comme symbole dans les dynamiques sociales et culturelles (Schupp (1974), Schaeffler (1991), Schneider (1979) et Vorgrimler (1992)) ; le sacrement comme symbole communicatif dans la vie de l’Église (Hünermann (1982), Ganoczy (1984) et Lies (1990)).
Selon Gerhards (2002), les recherches récentes postulent de plus en plus la question de la méthode, en tenant compte des défis posés à la science liturgique par le contexte culturel et ecclésial d’aujourd’hui, qui impliquent la communauté ecclésiale dans sa compréhension et sa participation liturgiques, la question œcuménique, la question historico-génético-rituelle de la liturgie, la question de la ritualité, de la liturgie théologique elle-même ou de la théologie de la liturgie, de la pastorale liturgique et des sciences humaines. Ainsi, dans le contexte allemand, il n’y a pas une seule science liturgique, mais diverses tendances avec des recherches dans le domaine de la philologie-histoire, de la théologie systématique ou de l’anthropologie et de la dimension pratique.
Une observation que l’on peut souligner, dans ce contexte, est le fait de l’absence d’une littérature sur le rite. Une telle absence peut être considérée peut-être en raison de la moindre incidence du débat liturgique, ou peut-être du fait que l’on se soit consacré au symbole, qui a une parenté avec le rite. Une telle réflexion aurait certainement offert des éléments significatifs et une réorientation de la sacramentalisation qui s’est produite en milieu allemand.
2.2 Contexte francophone
En France, la théologie post-conciliaire a été marquée par un dialogue intense avec la théologie allemande. Cependant, elle enregistre aussi sa marque originale, à savoir le profond renouveau patristique et liturgique, un dialogue œcuménique très fécond, tant avec les fidèles de la Réforme qu’avec les orthodoxes. La préoccupation théologique française, plus précisément, s’est tournée vers les questions christologiques, la théologie de la rédemption et le projet théologique lui-même destiné à aborder les questions émergentes avec la culture moderne et la post-modernité.
Selon Winling (1989), la théologie catholique française a un profil qui la distingue de celles d’autres régions. La France s’est caractérisée comme un centre de recherche et d’enseignement pour les congrégations religieuses, par le dialogue avec des penseurs représentant divers courants et par la réévaluation d’une spiritualité adulte pour les laïcs de l’Action Catholique. Il convient de souligner le dialogue avec la philosophie qui, cependant, ne doit pas être compris comme un service de celle-ci par rapport à l’élaboration d’une théologie systématique, mais comme une fermentation de la théologie à partir de nombreux thèmes et problématiques typiques de la philosophie française qui produit « la théologie herméneutique, la théologie de l’alterité de Dieu, la théologie pratique », chez des auteurs comme Duquoc, Chauvet, Moingt qui, influencés par la pensée de Lévinas (1961), parlent de Dieu, non pas en termes ontologiques, mais en termes d’« altérité », en gardant à l’esprit le lien étroit qui subsiste entre la théologie trinitaire et la théologie de la croix.
Dans le domaine spécifiquement théologico-liturgique, nous assistons à la naissance de l’Institut Supérieur de Liturgie, en octobre 1956, avec pour premier directeur le père B. Botte et, pour chargé d’études, le père J.-M. Gy. On peut dire que l’Institut a vécu intensément deux phases distinctes : de 1956 à 1968, puis de 1968 à nos jours. La première, caractérisée par une méthode plus historico-positive ; la seconde, marquée par le colloque organisé par le Centre National de Pastorale liturgique, tenu à Louvain en juin 1967, sur le thème Liturgie et sciences humaines, qui fut le jalon décisif pour ce second moment d’existence de l’Institut. À partir de là, les nouvelles sciences comme la sociologie, la psychologie et la sémiologie sont devenues indispensables pour l’étude de la liturgie.
C’est dans ce climat de dialogue entre sciences humaines et liturgie que nous trouvons Chauvet, enseignant depuis 1972 à l’Institut Supérieur de Liturgie, ainsi que dans d’autres centres d’études parisiens. L’interrogation la plus profonde n’est plus : comment célébrer les sacrements ? Mais pourquoi les sacrements existent-ils ? On peut dire que Chauvet, ainsi que plusieurs autres chercheurs tels que Gy, Didier, Bouyer, Dye, Hameline, Vergote, Dalmais, Lukken, ont contribué au renouveau de la liturgie et de la théologie sacramentelle en dialogue avec les sciences humaines.
Du point de vue de la théologie sacramentaire, on peut considérer trois étapes significatives : dans la première étape, dans les années 1960, naîtrait la recherche entre sacramentaire et anthropologie autour de la revue La Maison-Dieu, à travers une intégration au débat liturgique des résultats des sciences humaines, principalement la sociologie de l’assemblée, l’anthropologie du symbole et du rite, la sémiotique, l’histoire et la psychanalyse. Dans la deuxième étape, dans les années 1970, sont apparus plusieurs efforts de synthèse, notamment les travaux de Vergote, Didier – ce dernier a eu le mérite d’adopter un point de vue résolument anthropologique, considérant le sacrement sur la base de la ritualité et du symbole. Et enfin, la contribution de Chauvet (1979), qui étudie la liturgie à partir de la dimension anthropologique du symbole. Considérant que la théologie classique de l’efficacité des sacrements n’est plus pertinente pour l’homme d’aujourd’hui, il se propose d’aborder sa réalité dans une perspective symbolique, créant ainsi les conditions d’une nouvelle compréhension de la théologie sacramentelle.
La proposition de Chauvet accepte pleinement la contribution des sciences humaines : de l’utilisation de la philosophie du langage à l’inversion de la relation entre sujet et objet, ce qui révolutionne complètement les conceptions anthropologiques antérieures. Elle se réfère à toute la problématique de la relation entre l’homme/la femme et la réalité : quelle que soit la manière d’aborder la question, les choses sont significatives dans la mesure où elles entrent en communication avec la condition existentielle elle-même et la mettent directement en question. Si la vie est un problème pour le fidèle, si rien n’est simple pour lui, c’est parce que rien n’est immédiat : le royaume de l’homme/la femme est celui de la médiation. La réflexion théologique, qui a les sacrements pour objet d’étude, ne doit plus les considérer comme des objets-intermédiaires, qui agiraient comme un pont entre le sujet croyant et le Dieu transcendant, but comme un acte de langage ecclésial, dans lequel se réalise la condition de la foi qui s’y exprime.
La position épistémologique de Chauvet, en ce qui concerne la configuration du sacramentel, trouve un terrain d’entente dans les nouveaux scénarios épistémiques de plusieurs pays européens, mais, en même temps, la nouveauté de son approche a également suscité des critiques. D’une manière générale, dans la réflexion de Chauvet, nous voyons, sans aucun doute, un effort pour aller au-delà de la compréhension de l’extrinsécisme entre signum et res du point de vue du symbolique et dans le dépassement de ce qui pourrait paraître chosifiant ou magique au profit d’une compréhension réelle de la relation sacrement-célébration, où le croyant a une place indispensable, comme élément constitutif, avec sa participation, surmontant la séparation qui peut exister entre expérience et action célébrative.
Récemment, Belli, avec le résultat de sa recherche sur l’« Intérêt de la phénoménologie française pour la théologie des sacrements » (2013), approfondit la crise ontologique et épistémologique de la théologie sacramentaire au XXe siècle, présente une réflexion herméneutique analytique sur la « Question liturgique », la réponse donnée par le Mouvement liturgique et avec la contribution de la théologie sacramentaire. De sorte que la « quaestio sacramentis » est profondément repensée et exposée à de nouvelles interrogations. Le succès d’une telle analyse ouvre la voie à la contribution récente de la phénoménologie française à l’étude des sacrements sous l’angle de trois auteurs : J.-L. Marion, M. Henry et E. Falque. Sans aucun doute, la recherche de Belli (2013) offre une contribution à la détermination méthodologique interdisciplinaire du travail de réflexion sur le sacrement dans la médiation entre théologie et philosophie, liturgico-sacramentelle.
2.3 Contexte espagnol
Concernant la relation entre liturgie et théologie dans ce contexte culturel, la première étude à citer est celle de 1966, lors du IIe Congrès liturgique de Montserrat, au cours duquel Vilanova (1966) a donné une conférence sur les cinquante ans de la théologie de la liturgie. Vilanova fait une rétrospective de la théologie de la liturgie, en tenant compte principalement de l’orientation donnée dans ce domaine par les pionniers du Mouvement liturgique, tels que : Festugière, Beauduin, Cabrol, Gomà, Brinktrine, Oppenheim, Cappuyns, Dalmais, Pinto, Parscher.
Dans la phase post-conciliaire, López Martín (1982) réfléchit sur la relation entre liturgie et foi, en particulier la liturgie comme transmettrice de la foi, et établit des domaines dans lesquels il esquisse une situation encore peu claire à ce sujet. Le premier est celui de la compréhension théologique de la liturgie elle-même, le deuxième est la place de la liturgie dans la structuration de la théologie et le troisième est l’implication mutuelle entre la liturgie et la catéchèse dans l’ordre de la pédagogie de la foi. De plus, Fernández (1985) esquisse, de manière didactique, la distinction entre ce qui est liturgie et ce qui est théologie liturgique. L’auteur poursuit en affirmant que les sacrements, avant d’être une réflexion, sont des actions liturgiques. Avec une telle affirmation, Fernández ouvre sa section de sacramentologie fondamentale dans la revue Phase et indique clairement quelle serait l’orientation prévalente de la recherche sacramentelle dans le contexte espagnol. En Espagne, selon Bozzolo (1999), plus que dans d’autres aires culturelles, le contact entre la sacramentaire systématique et la discipline liturgique est devenu si étroit au point qu’il n’est presque plus possible de distinguer le spécifique des compétences. On peut ajouter qu’entre les années 1991 et 1995, au moins cinq traités de sacramentaire fondamentale sont apparus.
L’Institut de Liturgie du Centre de Barcelone a joué un rôle important sur la scène liturgique post-conciliaire et, par conséquent, dans la sphère de la SLS. Dans ce contexte, la collaboration de Borobio (1978) est emblématique. Bien que se situant dans un horizon rahnérien, il assume en fait les thèses décisives dans une perspective anthropologique et rituelle proposée par les auteurs français. Son programme trouve son expression non seulement dans ses publications personnelles, mais aussi dans l’ouvrage La celebración en la Iglesia. v. I (1985), qu’il a coordonné, et qui a pour objectif de surmonter la séparation traditionnelle entre liturgie et sacrement. Ce qui surprend dans cet ouvrage, c’est la coexistence pacifique de modèles aussi hétérogènes, à savoir l’anthropologique avec référence au symbole et au rite, considérant les sacrements comme une expression symbolique du salut dans les situations fondamentales de la vie, et le modèle des disciples de Rahner, qui attribue la sacramentalité au Christ, à l’Église, à l’homme/femme et au monde avant de passer à une sacramentalité concentrée dans les sept sacrements. Et ce qui prévaut n’est pas un projet systématique entre la liturgie et les sacrements, en prenant en considération le sacrement à partir de la célébration, mais la théorie du sacrement d’inspiration rahnérienne.
2.4 Contexte anglophone
La relation entre la théologie et la liturgie est approfondie, que ce soit dans le domaine catholique ou évangélique. Cependant, la réflexion a suivi et réagi à ce qui se passe, principalement sur le continent européen. Ainsi, nous n’avons pas substantiellement de proposition qui sorte des paramètres présentés jusqu’à présent.
Taft (1982) présente dans un article la synthèse de sa conférence à l’Université de Notre-Dame – USA sur la Liturgy as Teology. L’auteur considère que l’évaluation de la liturgie comme science théologique n’est pas courante et que la liturgie est un objet d’investigation théologique. De même, Lacugna reprend la question de savoir si la Liturgie peut devenir une source pour la théologie. Et Driscoll (1994), d’autre part, cherche à établir une nouvelle relation entre liturgie et théologie fondamentale. Il considère que dans cette relation existent des pistes de travaux possibles en partie déjà établies, notamment à partir de la théologie liturgique de Marsili (1974).
De même, Irwin (1994) élabore une proposition de théologie liturgique et présente quelques observations sur la méthode utilisée dans la théologie liturgique contemporaine. Pour lui, la méthode de l’acte liturgique devrait s’articuler avec la Parole, le symbole, l’euchologie et l’art liturgique. Il discute de la contribution avec laquelle la théologie qui dérive de la liturgie peut mener une discussion contemporaine sur la nature de la théologie. La proposition d’Irwin constitue un approfondissement, en vue d’une compréhension globale de la liturgie, à partir d’une première liturgie et d’une seconde liturgie, c’est-à-dire une composante, toujours théologico-liturgique, qui naît de la relation des deux susmentionnées, et qu’il appelle une troisième théologie, c’est-à-dire une théologie qui concerne la vie, la spiritualité, la morale, par rapport aux mystères de Dieu et de l’Évangile, mais expérimentés et célébrés dans la liturgie. Cette troisième liturgie est en relation intrinsèque avec la « lex orandi, lex credendi » et apporte une perspective doxologique.
En résumé, nous pouvons accepter le point de vue d’O’Connell (1965), qui considère que la recherche américaine post-conciliaire a été caractérisée, d’une part, par la discussion conciliaire et la réception de Sacrosanctum concilium, et d’autre part, par la traduction des œuvres de Rahner et Schillebeeckx. En Amérique du Nord, surtout, le point de départ pour repenser la nouvelle sacramentaire fut l’abandon de la synthèse classique du De sacramentis in genere et l’introduction de la perspective personnaliste et existentialiste, centrée sur la notion de Christ-sacrement et d’Église-sacrement. Cependant, dans les années 1980-1990, il y eut un excès de nouvelles données, selon Levesque (1995), rendant ainsi impossible une synthèse au point qu’Hellwig (1978) affirma que la théologie sacramentaire, au sens strict, avait disparu. Dans l’analyse de Bozzolo (1999), on détecte même une littérature diffuse sur le concept de symbole, assumé comme concept idoine pour l’interprétation de la réalité sacramentelle. Toutefois, en ce qui concerne la recherche théorique, l’intention pratico-pastorale et le choix d’une « vulgarisation théologique » des concepts qui circulaient en Europe semblent prévaloir.
2.5 Contexte brésilien
La réflexion liturgique post-conciliaire au Brésil est nettement marquée par les caractéristiques suivantes : une dépendance de la théologie européenne, dans ses différentes branches, mais principalement celle d’Europe centrale ; une profonde empreinte de la situation socioculturelle dans laquelle vit le peuple latino-américain ; une orientation pastorale par les conférences épiscopales du continent, de Medellín, Puebla, Saint-Domingue et Aparecida ; un grand nombre de jeunes Églises ; les défis des minorités ethniques, en particulier les Noirs et les indigènes ; une théologie tournée vers les défis pastoraux, plus qu’impliquée dans la fondation théorique universitaire, malgré une recherche constante et croissante dans le contexte latino-américain, une théologie qui vit de l’instant, de la créativité, soucieuse de répondre aux défis urgents des communautés et de l’inculturation liturgico-sacramentelle.
Du point de vue théologico-liturgique, on doit beaucoup à la création du Centro de Liturgia (Centre de Liturgie), à São Paulo, en 1987 (Adão, 2008). Grâce à lui, s’est constituée par la suite l’Associação de Professores de Liturgia do Brasil (Association des Professeurs de Liturgie du Brésil), en 1987. De là est partie, mais pas seulement, une réflexion liturgique nettement pastorale, avec un grand esprit d’animation et de créativité dans tous les domaines de la pastorale liturgique.
Indubitablement, du point de vue de l’approfondissement de la SL, le travail d’Ione Buyst est tout à fait significatif. En effet, l’activité liturgico-pastorale de Buyst avait pour objectif principal la participation du peuple à la préparation et à la célébration d’une liturgie populaire, priante, et qui soit l’expression d’une foi engagée dans la transformation du continent latino-américain, ainsi que dans la recherche œcuménique de la paix mondiale, dans la quête d’une pédagogie active, qui impliquerait la participation des personnes concernées et avec une méthodologie scientifique qui partirait de la réalité liturgique et articulerait théorie et pratique, théologie et pastorale.
De plus, elle a cherché à répondre à deux motifs fondamentaux : premièrement, la particularité des liturgies célébrées, qui forment l’objet réel de la SL et qui sont une expression de la particularité de l’Église sur ce continent – le changement de l’objet réel exige de nouvelles méthodes d’approche et d’analyse. En effet, la liturgie comme « sommet et source » de toute la vie ecclésiale (SC n.10) accompagne les changements qui se produisent dans la manière d’être ou de concevoir l’Église sur ce continent. Buyst (1989) écrit que l’Église latino-américaine est celle qui s’est exprimée et a tenté de se définir elle-même et sa mission à travers les assemblées de la conférence épiscopale latino-américaine, qui ont profondément marqué la vie ecclésiale post-conciliaire sur ce continent. Pour l’auteur, le modèle ecclésial latino-américain est caractérisé par la perspective que l’Église naît des bases populaires, suscitée par la force de l’Esprit Saint. L’irruption des pauvres dans l’Église, la croissance vertigineuse du nombre de communautés ecclésiales, leur dynamisme et leur vitalité sont considérés comme l’œuvre de l’Esprit Saint et non seulement comme l’effort évangélisateur de l’Église-institution sur ordre du Christ, c’est-à-dire que l’ecclésiologie de la libération ne se base pas seulement sur la christologie, mais principalement sur une pneumatologie (Buyst, 1989).
De cette nouvelle pratique liturgique, émergente dans l’Église des pauvres et véhiculée par l’évangélisation, la catéchèse et la prédication, une nouvelle théologie liturgique a vu le jour, qui devra être reprise, évaluée et fondée ou rejetée par une théologie liturgique élaborée scientifiquement à partir de cette théologie première vécue dans les communautés. Quelques thèmes commencent déjà à poindre : le sujet privilégié, convoqué par Dieu pour l’assemblée liturgique, est le peuple pauvre et opprimé, réuni en communautés ; ce même peuple est aussi le premier destinataire de la Bonne Nouvelle, l’évangile annoncé dans la liturgie ; le cri et la plainte du peuple, exprimés dans la prière des fidèles, ont une force auprès de Dieu, qui entend leur clameur et descend pour faire justice et libérer ; la liturgie est l’action communautaire : toute la communauté est un peuple sacerdotal, participant au sacerdoce de Jésus-Christ ; le Christ, présent dans l’assemblée liturgique, est le Christ qui s’identifie aux pauvres ; il a compassion du peuple, pour voir et entendre ses problèmes, aujourd’hui comme hier.
La publication du Manuel de Liturgie promu par le CELAM, A celebração do mistério pascal (2004-2007), en quatre volumes, manifeste le degré de maturité théologico-liturgico-sacramentelle sur le continent et est élaboré à partir de la dimension célébrative du mystère pascal du Christ, enrichi par la mosaïque de cultures, d’ethnies et de traditions religieuses présentes en Amérique latine et dans les Caraïbes, en plus de considérer l’expression symbolique du corps, la danse et la dramatisation dans la liturgie. Une telle œuvre, pionnière dans ce domaine, postule encore un approfondissement plus grand des thèmes abordés dans une optique anthropologique, dans le sens d’une éducation au rite et par le rite, et à partir non seulement des actes verbaux, mais aussi non verbaux, comme une forme mystagogique pour une contribution à l’intellectus ritus.
En ce sens, Taborda enrichit le débat théologico-liturgique brésilien avec une réflexion sur une « approche mystagogique des sacrements » (2004). Une telle considération est motivée par la nécessité postulée également par la culture de la post-modernité, de l’attention à la progression de la célébration vers la théologie, ce qui conduit à reconnaître la liturgie comme lieu théologique. En soi, le chemin n’est pas nouveau, ayant été parcouru par beaucoup, à commencer par les Pères de l’Église. Cependant, ce qu’il nous plaît de souligner, c’est le fait que le théologien jésuite travaille la liturgie comme lieu d’expression de la foi, où la révélation nous devient accessible. La source de la théologie est la foi de l’Église, non seulement celle explicitée dans les dogmes et autres verbalisations, mais aussi la foi vécue concrètement dans les actions, les œuvres, les symboles, les rites. Ces expressions de la foi ou lieux théologiques constituent la théologie première, la théologie dans la fraîcheur de son expression la plus légitime et la plus vivante. En elle se fondent et s’unissent intrinsèquement la théologie et la vie. Ce que font les théologiens et le magistère, c’est de la théologie seconde. De telles conditions amènent l’auteur à travailler la question sacramentelle du baptême et de l’eucharistie dans une approche mystagogique, en réponse aux défis d’aujourd’hui (Taborda, 2004).
2.6 Contexte italien
Les contributions significatives dans le domaine italien reprennent la richesse du Mouvement liturgique ainsi que le renouveau théologico-liturgique déclenché par le Concile Vatican II. Parmi les noms, nous pouvons citer au cours des quatre dernières décennies : de Cipriano Vagaggini à Zeno Carra, de Salvador Marsili à Ubaldo Cortoni, de Pelagio Visentin à Pierpaolo Caspani, d’Emanuel Caronti à Manuel Belli, d’A. M. Triacca à Elena Massimi, d’Aldo Terrin à Giorgio Bonaccorso, de Silvano Maggiani à Loris Della Pietra, de Roberto Tagliaferri à Andrea Grillo.
Le contexte italien est sans aucun doute privilégié, en ce sens qu’il a compté de nombreux et excellents liturgistes pionniers du Mouvement liturgique. Il a trouvé dans le Centro di Azione Liturgica un instrument important pour la diffusion de la réforme liturgique dans un contexte de pastorale liturgique. De plus, le Pontificio Istituto di Liturgia di Santo Anselmo lui-même, inauguré à Rome en 1961 dans le but de former à l’engagement de la SL, a été un partenaire compétent et audacieux, offrant de nouveaux horizons à parcourir. Une autre référence significative a été la création de l’Associazione di Professori di Liturgia, qui, à travers ses thèmes d’étude, a cherché à répondre aux défis de la liturgie dans une perspective pastorale et théologique. Et plus récemment, la création de l’Institut de Pastorale Liturgique de Sainte-Justine*, à Padoue, qui se consacre à l’étude de la pastorale, avec une attention significative au versant anthropologique, a qualitativement qualifié le débat liturgico-sacramentel.
La contribution de plusieurs maîtres marque la consistance de la réflexion théologique dans ce contexte. Vagaggini (41965) et Marsili (1971) approfondissent la place de la liturgie dans la structuration des études théologiques et comme locus theologicus. Visentin (1971) affirme que la liturgie elle-même n’a pas toujours su tirer profit de son statut de locus theologicus et revendique qu’aujourd’hui, on ne peut pas faire de la science théologique comme un compartiment fermé, quelque chose réservé aux seuls spécialistes dans un environnement uniquement intra-ecclésial. Il parle également d’une dimension liturgique de la théologie dogmatique. De manière analogue, la contribution de Triacca (1986) se caractérise par cette préoccupation de saisir la réalité salvifique intégrale : mysterium-actio-vita. En fait, Triacca passe par la compréhension de la dimension diaconale de la théologie, dans une ligne de redécouverte de la fonction de l’acte liturgique lui-même.
Tagliaferri (1996), d’autre part, centre sa recherche sur la phénoménologie du rite chrétien. Le chercheur relit Sacrosanctum Concilium et constate que l’objet de la science liturgique est le rite. Il se consacre à la formulation d’une proposition qu’il nomme « progetto di una scienza liturgica », dans laquelle il cherche à fonder son travail, considérant que l’objet de la SL, interrogé dans son aspect de médiation, semble donc être le rite, qui s’inscrit dans le dynamisme sacramentel fondamental du Christ et de l’Église, mais qui conserve sa propre configuration anthropologico-culturelle. Nous pouvons souligner, dans la recherche de SLS chez Tagliaferri, que la liturgie est un rite chrétien, conservant sa propre originalité. Ce rite doit porter les marques de tous les autres rites, c’est-à-dire qu’il doit être symbolique et ludique, s’il veut rester dans la sphère rituelle, et avoir la possibilité de transgresser le premier sens ; le rite, en tant que tel, ne perturbe en rien la rencontre avec le Christ ; au contraire, il exprime ses richesses infinies, précisément par son implication anthropologique incontournable ; à la fin, il se révèle comme la possibilité la plus authentique offerte à l’homme pour entrer dans le mystère.
D’autre part, Bonaccorso (1996) réalise son approche épistémologique liturgique concernant le temps, le langage et l’action rituelle, où la liturgie est considérée dans sa structure expressive et communicative, selon la dimension sacramentelle unie au concept de signe. Cet auteur est donc attentif à l’univers du langage sémiotique.
Cependant, c’est Grillo (1995) qui met en lumière le fait que le ritus a toujours été nécessaire à la fides – tandis que l’intellectus fidei s’est développé dès le début dans la réflexion de l’Église, l’intellectus ritus se manifeste comme un nouveau type de discours, encore vu avec méfiance et crainte par la théologie d’aujourd’hui, car il n’a fait émerger ses exigences qu’au siècle dernier et s’est imposé à l’attention et à la pratique ecclésiale au cours des cinquante dernières années. Dans la sphère ecclésiale, il y a eu une véritable marginalisation du rite, même avec des attitudes de présupposition, d’éloignement et de réintégration. La nécessité de réintégrer le rite dans le fondement de la foi vise à reconstruire, au moins théoriquement, l’expérience globale de la foi dans tous ses présupposés, qui incluent nécessairement, bien que jamais exclusivement, des expériences rituelles spécifiques.
Plus récemment, Della Pietra (2012) a examiné la question de la rituum forma liturgique comme source de la vie chrétienne et a souligné la possibilité d’une réflexion pour la mise en œuvre d’une véritable « réforme ». En effet, dans le parcours historique de la réflexion théologique et de la pratique célébrative, le changement du concept de forma a radicalement innové la compréhension du sacrement et de son efficacité structurellement liée à son aspect rituel : cette nouvelle perception, qui réhabilite de manière significative la rituum forma, ne peut plus être négligée ou oubliée par la théologie des sacrements, par l’expérience spirituelle, par la pastorale ordinaire et extraordinaire et par la relation mutuelle entre les disciplines théologiques.
Un tel cadre conceptuel a également été utilisé dans les recherches de Paranhos (2017) et de Buziani (2021), aboutissant à la reconnaissance de la corrélation intrinsèque entre la théologie sacramentelle, la liturgie et les sciences humaines. Sans un renouveau courageux de la SLS, la réforme liturgique perd son sens et se referme sur elle-même, laissant place aux nostalgies et aux improvisations, comme le souligne de manière sans équivoque sa réflexion sur la forme célébrative et la forme théologique.
Dans sa récente publication, Eucaristia, azione rituale, forme storiche e essenza sistematica, Grillo (2019) propose un Manuel dans lequel il met l’accent sur l’action rituelle originelle, à travers l’interprétation systématique de la signification et du développement historique, parallèle et enraciné, entre les actions et leurs interprétations. Un tel croisement de niveaux permet de restituer aujourd’hui, de manière cohérente, une intelligence de la foi impliquée et nourrie par le phénomène eucharistique. Elle reconnaît la réalité de l’intelligence rituelle de la foi dont l’eucharistie est la source, opérant précisément per ritus et preces. En ce sens, la proposition du Manuel de Grillo (2019) fait un saut qualitatif en passant d’une séparation rigide entre la signification théologique et cérémonielle du rite, dans le domaine eucharistique, à une construction d’une théologie du rite et à la découverte de l’action rituelle, restituant ainsi la valeur de forme du sacrement.
3 Perspectives d’une nouvelle relation (MEDEIROS, 2019, p. 598-603)
Les approches actuelles et ouvertes pour une nouvelle relation entre liturgie et théologie sacramentelle, entre action rituelle et sens de la foi, entre liturgie et vie de l’Église, entre phénoménologie et liturgie marquent sans aucun doute un scénario de changement paradigmatique, c’est-à-dire le passage épistémologique d’une perspective théologico-liturgico-sacramentelle généralement signi et causae à une nouvelle approche généralement symboli et ritus, comme une convergence initiée par le Mouvement liturgique, approfondie par Sacrosanctum Concilium et qui mûrit au cours des deux dernières décennies par rapport à la SLS.
La relecture récente de la relation entre liturgie et rite nous a fait prendre conscience de la question du présupposé du rite par la théologie classique, d’un éloignement du rite par la théologie moderne et d’une réintégration du rite par la théologie contemporaine pour la récupération du présupposé immédiat en ce qui concerne la médiation théologique.
En effet, il faut admettre qu’entre le genre du ritus et le genre du signi il n’y a pas d’alternative substantielle authentique, mais seulement une différence conceptuelle : cette différence, cependant, constitue un passage obligatoire et nullement optionnel ou accessoire pour la théologie contemporaine. Par conséquent, si l’un des nouveaux aspects de la compréhension des sacrements est la possibilité de les comprendre dans le rite, il est nécessaire de mieux clarifier quelles conséquences cette difficile évolution peut avoir pour la théologie.
Certes, la nouvelle pratique rituelle inaugurée par la réforme liturgique, fondée sur une nouvelle théologie sacramentelle systématique, est en même temps le principe d’une nouvelle élaboration systématique, avec l’entrelacement de la théorie et de la praxis, éclairée par la conscience de la « révolution linguistique » qui nous permet d’approfondir la valeur ultime de la systématisation de la participation active.
Le changement paradigmatique que cette transformation a apporté à la sensibilité théologique contemporaine, que nous n’avons pas encore intégré dans notre pensée liturgico-sacramentelle, a cependant conduit au passage à la nouvelle considération du sacrement dans la sphère du rite, comme forme de réappropriation de la théologie par l’un des présupposés de l’expérience chrétienne du Dieu de Jésus-Christ, et non plus l’approche traditionnelle de la SLS, qui plaçait le sacrement uniquement dans la sphère du signe-signifié. La limite de cette tradition était la compréhension du sacrement selon laquelle le « rite pouvait être décodé et transcrit dans un langage discursif, ce qui permet sa compréhension plus facilement » (GRILLO, 2022b). Par conséquent, si l’un des nouveaux aspects de la compréhension des sacrements est la possibilité de les recomprendre dans la sphère du rite, c’est précisément parce que les sacrements ne sont pas des signes à lire, mais des actions à réaliser, et il incombe précisément à la théologie de faire du moment rituel une interaction décisive de la relation entre Dieu et l’humanité, entre la grâce et l’histoire, entre la miséricorde et la pratique éthique, entre la révélation et la foi.
Conclusion
Nous pouvons dire que, parmi les diverses approches de la SLS considérées ci-dessus, pour le contexte latino-américain, les perspectives envisagées par les œuvres de : Maggiani (2002), dans sa proposition de lecture d’un Ordo liturgique à partir d’une lecture linéaire, de l’analyse performative et de l’analyse symbolico-fonctionnelle à travers lesquelles le texte liturgique n’existe pas seulement en tant que « texte », mais est un texte caractérisé pour « l’action », c’est-à-dire que le texte écrit est destiné à être traduit « en action », deviennent significatives et stimulent la recherche. Le Manuel de Liturgie, vol. II : A celebração do Mistério Pascal, du CELAM (2007), avec plusieurs collaborateurs, valorise la forme rituelle du sacrement et la proposition de Buyst (1989) avec son itinéraire sur la manière d’étudier la liturgie. Taborda (2004), à partir de la célébration à la théologie des sacrements avec une approche mystagogique, répond aux défis postmodernes sans s’y soumettre, mais travaille avec le grand récit de l’histoire du salut, la valorisation du sacré, la tradition ecclésiale et pour la rencontre avec le mystère dans les signes sacramentels. Grillo, dans sa proposition récente d’un Manuel sur Eucharistie, à partir de l’action rituelle (2019), inaugure une nouvelle période visant un scénario unitaire entre action liturgique et sacramentelle.
L’itinéraire parcouru, de manière diachronique et synchronique, nous a fait toucher la provisorieté de la méthode. La liturgie et les sacrements sont des moyens. Non une fin. De cette manière, la SLS s’oriente vers un but tandis que les sacrements vivent de/dans la source, comme les poissons dans le fleuve, qui est la célébration elle-même. Et la célébration sera toujours un moyen, à travers lequel les fidèles célèbrent, vivent et pensent essentiellement les mystères du salut du Christ dans l’actuosa participatio.
Damásio Medeiros – Unisal-Pio XI, São Paulo. Texte reçu le 20/05/2022 ; approuvé le 25/09/2022 ; posté le 30/12/2022. Texte original en portugais.
Références
ADÃO, A. J. História do Centro de Liturgia e suas contribuições para a Igreja do Brasil. São Paulo: Paulus, 2008.
BELLI, M. Caro Veritatis Cardo. L’interesse della fenomenologia francese per la teologia dei sacramenti. Milano: Glossa, 2013.
BONACCORSO, G. Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia. Padova: Messaggero, 1996.
BOROBIO, D. La liturgía como expresión simbólica. Phase, n. 18, p. 405-422, 1978.
BOROBIO, D. La celebración en la Iglesia, I / Liturgía y sacramentología fundamental. Salamanca: Sígueme, 1985 (trad. portugaise : A celebração na Igreja, I: liturgia e sacramentologia fundamental. São Paulo: Loyola, 1990).
BOZZOLO, A. La teologia sacramentaria dopo Rahner. Roma: LAS, 1999.
BUYST, I. Como estudar liturgia: princípios de ciência litúrgica. São Paulo: Paulinas, 1989.
BUZIANI, D. G. Uma “forma fundamental” também para a Penitência? Analogias e diferenças com a eucaristia e elaboração a partir de dois modelos teóricos. Tese (Ad Doctoratum in Sacra Liturgia), Pontificium Athenaeum S. Anselmi de Urbe. Roma: Pontificium Institutum Liturgicum, 2021.
CASEL O. Glaube, Gnosis und Mysterium. Jahrbuch für Liturgiewissesnchaft, n. 15 p. 155-305, 1941.
CHAUVET, L.-M. Du symbolique au symbole. Essai sur les sacrements, Paris: Cerf, 1979.
CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO (CELAM). A celebração do mistério pascal, I-IV. São Paulo: Paulus, 2004-2007.
DELLA PIETRA, L. Rituum forma. La teologia dei sacramenti alla prova della forma rituale. Padova: Edizioni Messaggero, 2012.
DRISCOLL, J. Liturgy and Fundamental Theology: Frameworks for a dialogue. Ecclesia Orans, p. 70-71, 1994.
FERNÁNDEZ, P. La celebración litúrgica: Fenomenología y teología de la celebración. In: BOROBIO, D. (ed.). La celebración en la Iglesia. Liturgía y sacramentología I. Salamanca: Sígueme, 1985, p. 297-308.
GANOCZY, A. Einführung in die Katholische Sakramentenlehre. Darmstadt: Wissenschatliche Buchgesellschaft, 21984.
Gärtner, H. W.; Merz, M. B. Prolegomena für eine Integrative Methode in der Liturgiewissenschaft. Archiv für Liturgiewissenschaft, n. 24, p. 165-189, 1982.
GERHARDS, A. Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. In: CARR, E. (ed.). Liturgia Opus Trinitatis. Epistemologia liturgica. Atti del VI Congresso Internazionale di Liturgia. Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo, 2002. p. 235-249.
GRILLO, A. Teologia fondamentale e liturgia. Il rapporto tra immediatezza e mediazione nella riflessione teologica, Padova: Messaggero – Abbazia S. Giustina, 1995.
GRILLO, A. Eucaristia. Azione rituale, forme storiche, essenza sistematica. Brescia: Queriniana, 2019.
GRILLO, A. Il rapporto tra forma celebrativa e forma teologica dell’eucaristia. Ipotesi teorica, verifica e apertura pastorale. In: TRUDU F. (ed.). Teologia dell’eucaristia. Nuove prospettive a partire dalla forma rituale. Roma: Messaggero, 2020. p. 15-33.
GRILLO, A. Liturgia fondamentale. Una introduzione alla teologia dell’azione rituale. Assisi: Cittadella editrice, 2022a.
GRILLO, A. Il genere del sacramento. Introduzione alla teologia sacramentaria generale. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2022b.
GUARDINI, R. Über die Systematische Methode in der Liturgiewissenschaft. Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 1 (1921) 87-108.
Häussling, A. Liturgiewissenschaft zwei Jahrzehnte nach Konzilsbegin. Archiv für Liturgiewissenschaft, n. 24, p.1-18, 1982.
HELLWIG, M. K. New Understandig of the Sacraments. Commonweal, n. 105, p. 375-380, 1978.
HÜNERMANN, P. Die sakramentale Struktur der Wirklickeit. Auf dem Weg zu einem erneurten Sakramentenverständnis. Herder Korrespondenz n. 36, p. 340-345, 1982.
IRWIN, K. Context and Text: Method in Liturgical Theology. Collegeville-Minnesota: Liturgical Press, 1994.
KASPER, W. Wort und Symbol in sakramentalen Leben. Eine anthropologische Begründung. In: HEINEN W. (ed.). Bild – Wort – Symbol in der Theologie. Würzburg: Eichter, 1969, p. 157-175.
Lehmann, K., Gottesdienst als Ausdruck des Glaubens. Liturgisches Jahrbuch, n. 30, p. 197-214, 1980.
LEVESQUE, P. J. A Simbolical Sacramental Methodology: an application of the Thought of Louis Dupré. Questions Liturgiques, n. 76, p. 161-181, 1995.
LÉVINAS, E. Totalité et infini. Essai sur l’extériorité. La Haye:Martinus Nijhoff, 1961.
LIES, L. Sakramententheologie. Eine personale Sicht. Graz: Styria, 1990.
López Martín, J. La fe y su celebración. Relaciones entre liturgía y fe, y en particular de la liturgía como trasmissora de la fe. Burguense, n. 23, p. 141-196, 1982.
MAGGIANI, S. Epistemologia Liturgica. Come studiare l’azione liturgica? In: CARR, E. (ed.). Liturgia Opus Trinitatis. Epistemologia liturgica. Atti del VI Congresso Internazionale di Liturgia. Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo, 2002. p. 153-186.
MARSILI, S. Verso una teologia della liturgia. In: NEUNHEUSER, B. et al. Anàmnesis. La Liturgia, momento nella storia della salvezza, I. Torino: Marietti, 1974.
MARSILI, S. La liturgia nella strutturazione della teologia. Rivista Liturgica, n. 58, p. 153-162, 1971.
MEDEIROS, D. Azione rituale e fede. Prospettive di un nuovo rapporto in Salesianum, Roma, v. 81/4, p. 597-603, ott./dec. 2019.
MEDEIROS, D. Teologia Liturgica tra “actio” e “Intellectus fidei”. In: SODI, M. et al. (ed.). La teologia liturgica tra itinerari e prospettive. L’economia sacramentale in dialogo vitale com la scienza della fede. Roma: If Press, 2014. p. 145-168.
MEDEIROS D. A ciência litúrgica contemporânea. Itinerários genético-epistemológicos do “actus liturgicus”. Roma: LAS, 2011. p. 15-42.
MEDEIROS D. La natura della liturgia nella discussione odierna. In: CARR, E. (ed.). Liturgia Opus Trinitatis. Epistemologia liturgica. Atti del VI Congresso Internazionale di Liturgia. Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo Roma, 2002. p. 62-91.
O’CONNEL, M. New Perspectives in Sacramental Theology. Worship, n. 39, p. 196-206, 1965.
PARANHOS, S. W. Teologia sacramentária e a liturgia em perspectiva metodológica. O caso da Iniciação cristã entre 1990-2015. Tese (Dissertação de Doutorado), Universidade Pontifícia Salesiana, Roma, 2017.
RAHNER, K. Sulla teologia del simbolo in Saggio sui sacramenti e sull’escatologia. Roma: Paoline, 1965, 51-107.
RATZINGER, J. Die sacramentale Begründung christliche Existenz. Freising: Kyrios-Verlag, 1966.
RATZINGER, J. A forma e conteúdo da celebração eucarística. In: RATZINGER, J. Obras Completas XI, Teologia da liturgia. O fundamento sacramental da existência cristã. Brasília: Edições CNBB, 2019, p. 221-241.
SCHAEFFLER, R. Kultur und Kult. Liturgisches Jahrbuch, n. 41, p. 73-87, 1991.
SCHNEIDER, T. Zeichen der Nähe Gottes. Grundriß der Sakramententheologie. Mainz: Grünewald 1979.
SCHUPP, F. Glaube – Kultur – Symbol. Versuch einer kritischen Theorie sakramentaler Praxis. Düsseldorf, 1974.
SEILS, M. Sakramententheologie. Verkündigung und Forschung, n. 39, p. 24-44, 1994.
TABORDA, F. Da celebração à teologia. Por uma abordagem mistagógica dos sacramentos. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 255, p. 588-615, jul 2004.
TAGLIAFERRI, R. La violazione del mondo. Ricerche di epistemologia liturgica. Roma: CLV, 1996.
TAFT, R., Liturgy as Theology. Worship, n. 56, p. 113-117, 1982.
TRIACCA, A. M. Liturgia “locus theologicus” o Theologia “locus liturgicus”? Da un dilemma verso una sintesi. In: Farnedi, G. (ed.). Paschale Mysterium: Studi in memoria dell’abate prof. Salvatore Marsili (1910-1983) = Studia anselmiana 91: Analecta Liturgica 10. Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo, 1986, p. 193-234.
UBBIALI, S. La riflessione sui sacramenti in epoca moderna e contemporanea. In: ASSOCIAZIONE PROFESSORI DI LITURGIA (ed.). Celebrare il mistero di Cristo. v. I: La celebrazione. Introduzione alla liturgia cristiana. Roma: Edizioni Liturgiche, 1993. p. 303-336.
VAGAGGINI, C. Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale. Roma, 41965 (trad. portugaise: O sentido teológico da liturgia. São Paulo: Loyola, 2009).
Vilanova, E. Cinquenta anys de teología de la liturgía. In: Congrés litúrgic de Monteserrat, I , Monteserrat, 1966, p. 195-214.
Visentin, P. Per l’insegnamento della dogmatica in rapporto alla liturgia. Rivista Liturgica, n. 58, p. 186-211, 1971.</p
Winling, R. La théologie catholique en France au Xxe siècle. Nouvelle Revue Théologique, n. 111, p. 553-554, 1989.