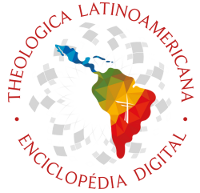Sommaire
1 Thèmes, processus et périodes
2 Un sain relativisme
3 Références bibliographiques
L’histoire du christianisme est différente de l’ecclésiologie, qui est la réflexion théologique sur l’Église. Curieusement, cette histoire est un champ de savoir commun aux croyants et aux non-croyants. Les croyants peuvent produire une historiographie du christianisme, à condition de faire preuve de rigueur dans la méthode et de ne pas se laisser emporter par des élans apologétiques acritiques. Les non-croyants peuvent également en produire, à condition de posséder la culture religieuse nécessaire pour comprendre cette croyance, une affinité avec ses thèmes et la même rigueur méthodologique. Les croyants peuvent être perplexes face à certaines réalités du passé, lorsqu’elles sont connues plus en profondeur. Mais s’ils accueillent leur propre perplexité, ils peuvent surmonter les naïvetés et parvenir à une foi plus mûre. Les non-croyants, quant à eux, peuvent aller au-delà d’un agnosticisme de sens commun, qui se base non rarement sur des simplifications du passé. Tous deux peuvent élargir leurs horizons, en grandissant en connaissance et en sagesse.
C’est au fil de l’histoire que les personnes et les collectivités, y compris les chrétiens et leurs institutions, sont devenues ce qu’elles sont aujourd’hui. C’est pourquoi on peut beaucoup apprendre d’elle. Cependant, aujourd’hui, on ne considère pas rigoureusement l’histoire comme une maîtresse, car elle n’a pas un sens univoque comme une professeure qui enseigne des leçons en classe. Il existe de nombreuses perspectives possibles, qui peuvent être également valables. Toute histoire naît toujours des questions formulées dans le présent à l’égard du passé. Sans interrogations, il n’y a pas d’histoire. Ses divers champs sont intimement liés. C’est pourquoi l’histoire du christianisme est liée à l’histoire sociale, culturelle et des mentalités.
1 Thèmes, processus et périodes
Au cours du XXe siècle, l’écriture de l’histoire a connu des changements dans ses thèmes et ses intérêts. Elle s’est d’abord tournée vers les grands événements, les biographies de personnalités illustres et la chronique politique, en se concentrant sur des sujets et des événements qui attiraient beaucoup l’attention. Ensuite, elle s’est tournée vers les structures de la vie quotidienne, comme les sociétés, les gens ordinaires, les économies, la vie matérielle et les mentalités. Des thèmes comme l’alimentation, l’habillement, le logement, les transports, la vie privée, les femmes, l’enfance, la peur, la sécurité et l’espérance ont commencé à intéresser l’histoire. Ce changement de perspective affecte également l’histoire du christianisme. Elle s’est beaucoup intéressée à l’institution ecclésiastique, aux conciles œcuméniques, aux documents pontificaux, à la création d’évêchés et aux hagiographies (vies de saints). L’autocompréhension de l’Église comme société parfaite, une société où aucun élément ne manque pour être complète, y a contribué. La composante institutionnelle a prévalu. Mais avec le Concile Vatican II (1962-1965), qui a défini l’Église comme peuple de Dieu, le laïcat et le christianisme vécu ont pris plus d’importance. Des thèmes comme la religiosité populaire, les associations de laïcs et la réception des conciles dans les Églises locales ont gagné en importance.
Les processus de permanences et de changements dans les sociétés et les civilisations, largement étudiés par l’historien Fernand Braudel, s’appliquent également au christianisme. Il a développé le concept de « longue durée ». Au centre de la réalité sociale, il y a une opposition vivante, intime, répétée sans cesse entre ce qui change et ce qui insiste à demeurer, une dialectique de la durée (BRAUDEL, 1992a, p.41-78). Dans les mouvements qui affectent la masse de l’histoire actuelle, il y a un héritage fantastique du passé. Le passé barbouille le temps présent. Toute société est touchée par les eaux du passé. Ce mouvement n’est pas une force consciente, il est, d’une certaine manière, inhumain, l’inconscient de l’histoire. Le passé, surtout le passé ancien, envahit le présent et d’une certaine manière s’empare de notre vie. Le présent est, en grande partie, la proie d’un passé qui s’obstine à survivre ; et le passé, par ses règles, ses différences et ses ressemblances, est la clé indispensable à toute compréhension sérieuse du temps présent. En général, il n’y a pas de changements sociaux rapides. Les révolutions elles-mêmes ne sont pas des ruptures totales.
Une révolution aussi profonde que la Révolution française est loin d’avoir tout changé du jour au lendemain. Le changement compose toujours avec le non-changement. Comme les eaux d’un fleuve condamné à couler entre deux rives, passant par des îles, des bancs de sable et des obstacles, le changement est surpris dans un piège. S’il parvient à supprimer une partie considérable du passé, il faut que cette partie n’ait pas une résistance trop forte et qu’elle soit déjà usée par elle-même. Le changement adhère au non-changement, suit ses faiblesses et utilise ses lignes de moindre résistance. À côté des querelles et des conflits, il y a des compromis, des coexistences et des ajustements. Dans les fréquentes divisions entre le pour et le contre, il y a, d’un côté, ce qui bouge ; de l’autre, ce qui s’obstine à rester au même endroit (BRAUDEL, 1992b, p.356-7). Dans le christianisme, les permanences et les changements sont toujours présents et interagissent mutuellement, tantôt en s’opposant, tantôt en s’articulant.
Dans la périodisation de l’histoire du christianisme, on peut adopter la division en quatre unités de Hubert Jedin sur l’histoire de l’Église :
1 – le christianisme dans la sphère culturelle hellénistico-romaine (Ier au VIIe siècle) ;
2 – le christianisme comme fondement des peuples chrétiens occidentaux (environ 700 à 1300) ;
3 – la dissolution du monde chrétien occidental et le passage à la mission universelle (1300 à 1750) ;
4 – le christianisme à l’ère industrielle (XIXe et XXe siècles).
Une autre périodisation similaire est celle de Marcel Chappin :
1 – jusqu’à 400 : un christianisme distant du monde ;
2 – Entre 400 et 1800 : un christianisme presque pleinement identifié au monde ; que l’on peut subdiviser :
a) 400-1000 : les empereurs et les rois dominent ;
b) 1000-1500 : le clergé domine ;
c) 1500-1800 : l’État absolu domine ;
3 – 1800-1960 : un certain isolement face à un monde hostile à l’Église, avec le rêve d’un retour à la situation antérieure ;
4 – À partir de Vatican II : insertion dans le monde comme instance critique (CHAPPIN, 1990, p.127-8).
2 Un sain relativisme
Le regard rétrospectif de l’histoire montre les différentes compréhensions d’un même concept au fil du temps. La sainteté, par exemple, qui est la fidélité à Dieu dans l’accomplissement de Sa Parole, était comprise dans l’ancien Israël comme la stricte observance de la Loi de Moïse, y compris l’abstention de la chair d’animaux, de reptiles et d’oiseaux considérés comme impurs (Lév 20, 25-26). Dans le Nouveau Testament, en revanche, la sainteté est la vie en Christ, accessible aux païens convertis, sans avoir besoin de cette Loi. Au Moyen Âge, saint Louis, roi de France, se lança dans les croisades contre les Maures, où il trouva la mort. Saint Ignace de Loyola, au XVIe siècle, fut un farouche opposant à la Réforme protestante, exhortant les gouvernants à appliquer toutes les lois existantes contre les hérésies, y compris la peine de mort là où elle existait (LOYOLA, 1963, p. 877-84). Le pape Jean XXIII, récemment canonisé, a affirmé la « très haute pertinence » de la Déclaration universelle des droits de l’homme, faite par les Nations unies en 1948, contenant la liberté de conscience et la liberté religieuse (JEAN XXIII, 1963, n.141-144). Ce pape a contredit l’enseignement de beaucoup de ses prédécesseurs. En tout cela, il est clair que l’esprit authentique de l’Évangile est compris différemment à chaque époque.
La science historique permet de dépasser le sens commun concernant les croisades, la colonisation, l’inquisition et les guerres de religion. Le juste encadrement des lois, des sociétés et des mentalités dans leurs époques respectives évite l’anachronisme pervers, la surveillance idéologique du passé et le lynchage moral des individus. Pour la théologie, l’histoire est un « lieu théologique », une source de connaissance dans ce domaine du savoir. Selon Yves Congar, l’histoire ouvre la voie à un « sain relativisme ». C’est quelque chose de bien différent du scepticisme ; c’est la juste perception de la relativité de ce qui est effectivement relatif, afin de ne qualifier d’absolu que ce qui l’est véritablement. Grâce à l’histoire, on peut comprendre l’exacte proportion des choses, en évitant de considérer comme la Tradition ce qui date d’avant-hier, et qui a changé plus d’une fois au cours des temps. On peut affronter le drame de nombreuses inquiétudes suscitées par l’émergence d’idées et de formes nouvelles. Avec l’histoire, il est possible de mieux se situer dans le présent, avec une conscience plus lucide de ce qui se déroule réellement, et de la signification des tensions que l’on vit (CONGAR, 1970, p.886-94).
La révélation biblique du nom de Dieu, Yahvé (Ex 3,14), signifie « je serai là avec vous ». Dieu est le Dieu vivant, qui se manifeste dans ses œuvres, dans l’histoire qui ne s’achèvera qu’à la fin. Le Christ n’est pas seulement l’Alpha, il est aussi l’Oméga (Ap 1,8). Sa vérité est encore à accomplir. Il y a quelque chose d’inexprimé, de non-dit, de sa Parole qui, pour être dit, requiert la variété de l’histoire et des peuples, variété qui n’est pas encore acquise. La Parole divine, en gestes ou exprimée, comporte un approfondissement illimité. Elle est proposée aux êtres humains dans la diversité des temps et des lieux, des expériences, des problèmes et des cultures. L’histoire humaine, avec sa nouveauté et son inédit permanent, d’un côté, réclame toujours une réponse à des questions encore inconnues et, de l’autre, contribue avec des moyens d’expression qui n’existaient pas encore (CONGAR, ibidem déc 8, 2014). La plénitude du Christ se manifeste au fil de l’histoire et exige l’histoire pour se manifester. D’où l’importance de reconnaître les « signes des temps », comme l’enseigne le Concile Vatican II (Gaudium et Spes, 1965, n.44).
L’expérience des siècles passés, les progrès scientifiques, les richesses culturelles des divers peuples, qui manifestent la condition humaine et ouvrent de nouvelles voies à la vérité, bénéficient également à l’Église. Depuis le début de son histoire, l’Église formule le message du Christ à travers les concepts et les langues des peuples, recourant même au savoir philosophique, dans le but d’adapter l’Évangile à la capacité de compréhension des gens et aux exigences des sages. Une telle manière adaptée de propager le message chrétien, affirme le Concile, doit être la loi de toute évangélisation. De cette manière, dans chaque nation surgit la possibilité d’exprimer ce message à sa manière, favorisant un échange intense entre l’Église et les diverses cultures des peuples. Pour cet échange, qui se fait au long de l’histoire, l’Église a besoin de personnes insérées dans le monde qui connaissent bien l’esprit et le contenu des diverses institutions et savoirs, qu’elles soient croyantes ou non (GS n.44).
Le peuple chrétien, en particulier ses pasteurs et ses théologiens, est exhorté à écouter, discerner et interpréter les divers langages et expressions des temps actuels, et à les juger à la lumière de la parole de Dieu, avec l’aide de l’Esprit Saint, afin que la Révélation divine puisse être de plus en plus intimement perçue, mieux comprise et présentée de manière convenable. Comme l’Église a une structure sociale visible, elle peut aussi s’enrichir de l’évolution de la vie sociale dans l’histoire. Tous ceux qui promeuvent le bien de la communauté humaine dans divers domaines aident également la communauté ecclésiale, dans la mesure où celle-ci dépend des réalités extérieures. En tout cela, reconnaît le Concile, il y a une aide que l’Église reçoit du monde. De plus, elle a beaucoup bénéficié, et peut encore bénéficier, de l’opposition de ses adversaires et de ses persécuteurs (GS n.44). Cette riche interaction entre l’Église et le monde, au cours du temps, est un vaste champ de recherche et d’étude pour l’historien.
Le sain relativisme de Congar concerne également la mutabilité des formulations doctrinales. Pour lui, la seule manière de dire la même chose dans un contexte qui a changé est de la dire différemment (CONGAR, 1984, p.6). Cette même idée est exprimée par le pape Jean XXIII, qui a ouvert le Concile en proposant que l’enseignement de l’Église soit approfondi et exposé de manière à répondre aux exigences des temps actuels. Une chose sont les vérités contenues dans la doctrine, et une autre est la formulation avec laquelle elles sont énoncées, en leur conservant le même sens et la même portée. Il faudrait accorder beaucoup d’importance à cette forme et insister avec patience sur son élaboration (JEAN XXIII, 1962). Le dogme et l’histoire sont toujours intimement liés. La formulation du dogme, la préservation et l’approfondissement de son sens, et les nouvelles formes de son énonciation dépendent de l’histoire et de ses contextes.
En ce qui concerne les personnes impliquées dans les drames et les conflits historiques, la réflexion du cardinal Carlo M. Martini sur le jugement divin est pertinente. Il affirme qu’il existe un « relativisme chrétien », qui consiste à comprendre toutes choses par rapport au moment où l’histoire sera ouvertement jugée. Alors les œuvres des hommes apparaîtront avec leur vraie valeur. Le Seigneur sera le juge des cœurs, et chacun recevra de lui la louange qui lui est due. On ne sera plus sous les applaudissements et les sifflets, l’approbation ou la désapprobation des autres. Ce sera le Seigneur qui donnera le critère ultime et définitif de la réalité de ce monde. Le jugement de l’histoire s’accomplira et l’on verra qui avait raison. Beaucoup de choses s’éclairciront, s’illumineront et se pacifieront, également pour ceux qui souffrent encore dans ce monde, plongés dans l’obscurité, sans encore comprendre le sens de ce qui leur arrive. C’est à partir du moment culminant où l’histoire sera jugée par Dieu que l’être humain est invité à interpréter sa petite histoire de chaque jour. L’histoire n’est pas un processus infini replié sur lui-même, sans sens et débouchant sur le néant. C’est quelque chose que Dieu lui-même rassemblera, jugera et pèsera avec la balance de son amour et de sa miséricorde, mais aussi de sa justice (MARTINI, 2005).
Ces considérations de Martini trouvent un appui dans l’exhortation de l’apôtre Paul : ne pas juger avant le temps, mais attendre que vienne le Seigneur, car il mettra en lumière tout ce qui se cache dans les ténèbres et manifestera les intentions des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui correspond (1 Co 4,5). Avec ce relativisme chrétien, on peut regarder avec plus de sérénité les événements complexes du passé et leurs imbrications, sans l’empressement de désigner qui avait raison et qui ne l’avait pas.
De cette manière, Martini énonce sous un autre nom le sain relativisme, en soulignant la pleine manifestation de l’absolu à la fin de l’histoire. La juste perception de ce qui n’est pas absolu ou intouchable est une tâche nécessaire pour ceux qui désirent montrer l’actualité permanente du mystère chrétien et le rendre crédible dans la société sécularisée actuelle. Le sain relativisme est inévitable si l’on admet que l’Église a beaucoup bénéficié, et peut encore bénéficier, de l’opposition de ses adversaires.
Luís Corrêa Lima, SJ, PUC-Rio, Brésil. Texte original en portugais.
3 Références bibliographiques
BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a história. São Paulo: Perspectiva, 1992.
____. Reflexões sobre a história. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
CHAPPIN, Marcel. Introdução à história da Igreja. São Paulo: Loyola, 1990.
CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Pastoral Gaudium et spes sobre a Igreja no mundo actual. Roma, 1965. Disponible sur : <www.vatican.va>.
CONGAR, Yves-Marie. A história da Igreja, “lugar teológico”. Concilium: revista internacional de teologia, 1970, n.7, p. 886-94.
____. La tradition et la vie de l’Église. Paris: Cerf, 1984.
FRANZEN, August. Breve história da Igreja. Lisboa: Presença, 1996.
JOÃO XXIII. Discurso de sua santidade papa João XXIII na abertura solene do SS. Concílio. Roma, 1962. Disponible sur : <www.vatican.va>.
____. Carta encíclica Pacem in terris. Roma, 1963, n.141-144. Disponible sur : <www.vatican.va>.
LIMA, Luís Corrêa. The historian between faith and relativism. In: Ignacio Silva. (Org.). Latin american perspectives on science and religion. Londres: Pickering & Chatto, 2014. p.43-55.
LOYOLA, San Ignacio de. Al P. Pedro Canisio (Roma, 13 ago. 1554). In: Obras completas de San Ignacio de Loyola. Madri: Biblioteca de Autores Cristianos, 1963. p.877-84.
ROGIER, L. J.; AUBERT, R.; KNOWLES, M. D. (org.). Nova história da Igreja. v.1 e 2. Petrópolis: Vozes, 1973-1976.
BELLITTO, Christopher M. História dos 21 Concílios da Igreja: de Niceia ao Vaticano II. São Paulo: Loyola, 2010.
FRÖHLICH, Roland. Curso básico de história da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1987.
LINDBERG, Carter. Uma breve história do cristianismo. São Paulo: Loyola, 2008.
MARTINI, Carlo Maria. Omelia del cardinale Carlo Maria Martini per il XXV anniversario di episcopato. Milão, 8 maio 2005. Disponible sur : .
REMOND, René (org.). As grandes descobertas do cristianismo. São Paulo: Loyola, 2005.
Pour en savoir plus:
COMBY, J.
Para ler a história da Igreja. v.I e II. São Paulo: Loyola, 1996.
LENZENWEGER, J.; STOCKMEIER, P.; AMON, K.; ZINNHOBLER, R. História da Igreja Católica. São Paulo: Loyola, 2006.
POTESTÀ, G. L.; VIAN, G. História do cristianismo. São Paulo: Loyola, 2013.