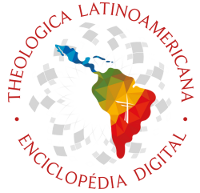Sommaire
1 Nomenclature
2 Classification et tendances
3 Herméneutique Patristique
4 Références bibliographiques
L’intérêt pour les enseignements des Pères de l’Église marque notre époque par un retour aux sources originelles du christianisme. En tant qu’antécédent déterminant, avec le mouvement liturgique, le mouvement patristique a été fondamental pour la convocation et la célébration du Concile Vatican II, qui n’a cessé d’affirmer la valeur incontestable des Pères de l’Église pour le renouvellement de la foi aujourd’hui. Parallèlement à l’histoire des dogmes, l’Église croit en la contribution des Pères de l’Église à « l’interprétation et à la transmission fidèle de chacune des vérités de la Révélation » (cf. Optatam Totius n.16).
1 Nomenclature
Avec les progrès de la recherche théologique, les terminologies élémentaires relatives aux Sciences Patristiques se sont multipliées et diversifiées, de sorte que la concession des concepts a fini par être redéfinie, faisant en sorte que le terme « patristique » rassemble des éléments conceptuels plus larges. Jusqu’alors, il était courant de dire que la patristique était l’étude qui s’occupait de la pensée théologique des pères de l’Église, tandis que la patrologie se maintenait dans la perspective de la recherche sur la vie et les écrits des mêmes auteurs (cf. Cong. Éducation Catholique, 1990, n.49). Ainsi, la patristique se redéfinit comme un terme technique utilisé pour déterminer la science chargée d’analyser et d’interpréter l’ensemble des documents anciens entre le Ier siècle ap. J.-C. et les premiers signes clairs de la méthodologie médiévale.
Parallèlement aux sources bibliques qui constituent le matériau d’une science propre à l’étude des Saintes Écritures, la documentation de cette phase patristique peut également être classée comme sources patristiques, ce qui sera établi par le matériel littéraire, iconographique, topographique, épigraphique ou archéologique lorsque ces informations se rapportent et représentent des éléments qui élucident la réalité sociale ou religieuse de cette période.
Par définition, il appartient à l’archéologie chrétienne d’identifier, de déchiffrer et d’expliquer les plus anciennes sources chrétiennes trouvées, par exemple, dans les sarcophages, les catacombes, lorsque celles-ci commencent à identifier la présence du phénomène religieux chrétien, dans les statues, les objets courants de la vie antique et, à grande échelle, dans la fonction que les divers édifices possédaient pour le culte, le domicile, l’administration, la charité sociale, entre autres. La pierre tombale d’Abercius est associée aux plus importantes découvertes archéologiques de tous les temps et figure en tête de la liste des documents les plus précieux pour le christianisme (MORESCHINI, 1995, p.307). L’évêque de Hiérapolis est mort en 216 ap. J.-C. Trois ans avant sa mort, il a fait construire sa propre inscription mortuaire, l’enrichissant d’allusions christologiques et ecclésiologiques, transmettant un sentiment clair de dévotion des églises dispersées dans le monde envers l’église romaine, discourant sur l’eucharistie et sur un possible groupe homogène d’écrits pauliniens et, enfin, la datant et la signant. C’est pourquoi la pierre d’Abercius est aussi appelée Regina Scriptarum, et se trouve dans la collection permanente du musée paléochrétien du Vatican.
À son tour, le concept de « patrologie » doit être compris comme le produit dogmatique et le contenu orthodoxe présents dans les enseignements des écrivains anciens, indépendamment de leur fonction à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre ecclésiastique. D’autre part, face aux mouvements novateurs et hérétiques qui ont établi une relecture indépendante, déformée et fausse de l’enseignement que Jésus et les Apôtres avaient institué, la communauté des fidèles chrétiens a compris que le critère d’authenticité incontestable à suivre était le critère de l’« antiquité chrétienne », dont l’application ne se basait pas tant sur des aspects temporels, mais sur les éléments fondamentaux de la vérité doctrinale établie par les racines juives et chrétiennes.
Quant à la terminologie « Pères de l’Église », elle a été forgée pour la première fois dans un contexte protestant, par le théologien allemand Johann Gerhard en 1637, dans le but de défendre une prétendue antiquité des concepts théologiques des Réformateurs contre les dogmes catholiques. En réévaluant ce concept à partir du critère de l’antiquité chrétienne, l’Église catholique l’a incorporé à son langage théologique pour indiquer l’authenticité de la foi chrétienne vérifiée dans le développement de la doctrine catholique. Au Brésil, Padres da Igreja est devenu la traduction la plus fréquemment utilisée par les éditeurs et auteurs catholiques, tandis que les livres et articles protestants ont tendance à traduire le même terme par “Pais da Igreja”. On entend par « Histoire de l’Église » la forme de reconstruction approximative des événements de l’antiquité chrétienne dont les mentions se fondent sur des données littéraires présentes dans des documents anciens. Cependant, cette reconstruction patristique exige de la prudence pour que les concepts anciens ne soient pas mal interprétés ou appliqués aux situations actuelles comme des règles générales, car l’accès à ces mêmes événements historiques par la littérature se limite à environ vingt pour cent des documents dont les titres ont été cités dans les livres des Pères de l’Église, ce qui signifie que quatre-vingts pour cent des livres cités par les écrivains anciens ne nous sont pas parvenus (GRECH, 2005, p.37). Certaines erreurs deviennent courantes dans l’évaluation des sources patristiques, que ce soit par anachronisme, lorsque le jugement est porté hors du contexte dans lequel le texte a été écrit, ou lorsqu’une donnée du passé est proposée de manière arbitraire par le fondamentalisme historique de ceux qui tentent de reprendre des situations passées déjà obsolètes ou des structures caduques.
On parle également de « Littérature patristique » pour désigner les formes littéraires étudiées par ceux qui cherchent à comprendre les règles de la typologie, des allégories, de la rhétorique et de la pédagogie qui élargissent et permettent une meilleure compréhension de ce que les écrivains anciens voulaient dire en rédigeant leurs textes. Des œuvres originales et des traductions de très grande valeur enrichissent l’ensemble de la littérature patristique dans un paysage linguistique aussi vaste que les limites géographiques du christianisme antique. Ces œuvres ont été produites dans les langues suivantes : grec, latin, syriaque, copte, arménien, éthiopien, géorgien, arabe et paléoslave.
2 Classification et tendances
En général, les critères pour identifier un Père de l’Église sont l’antiquité, l’approbation ecclésiastique, la sainteté de vie et l’orthodoxie (SANTINELLO, 1973, p.6). Au début, les limites de la période patristique étaient établies jusqu’à Isidore de Séville (†636) pour l’Occident et jusqu’à Jean Damascène (†749) pour l’Orient. Cependant, en percevant la continuité et l’évidence de la méthodologie patristique à des périodes atteignant la production littéraire de la cour de Charlemagne, des études récentes révisent ces limites, les proposant jusqu’au IXe siècle (LUISELLI, 2003, p.9-17).
Les Pères Apostoliques sont les premiers personnages de la patristique, ainsi nommés parce qu’ils étaient disciples des Apôtres du Christ. Les œuvres principales et les plus anciennes sont : « L’Épître de Barnabé », « Le Pasteur d’Hermas », les lettres de Clément de Rome, l’épistolaire en sept œuvres d’Ignace d’Antioche, les lettres de Polycarpe de Smyrne, « Papias » et la « Didachè », également connue sous le nom de « Doctrine des Apôtres ». On souligne ainsi l’accent mis sur les structures et les réflexions ecclésiastiques de ces textes, d’où l’on peut extraire des informations importantes sur les aspects sociaux entourant les réunions des chrétiens lors de leurs célébrations à domicile et le vaste éventail des ministères exercés lors de ces célébrations. Le thème de l’importance irréfutable de l’épiscopat y est constamment traité. Ainsi, dans les écrits des Pères Apostoliques, on note ce que les spécialistes appellent normalement la conscience de soi chrétienne, c’est-à-dire la manière dont les chrétiens se distanciaient des pratiques religieuses du paganisme, du gnosticisme et du judaïsme, formant ainsi une religion avec des éléments clairement distincts.
La génération suivante a fait face aux grandes persécutions de l’Empire romain au deuxième siècle, alors que les chrétiens étaient accusés d’opposition à l’ordre public (pax deorum), puisque les fidèles de l’Église s’opposaient à offrir des sacrifices aux dieux païens, refusant d’observer les principes gouvernementaux par lesquels on croyait préserver le bien-être des citoyens. L’apologétique chrétienne naît de la nécessité de défendre les accusés de christianisme devant les tribunaux de la persécution. Quant aux auteurs apologistes, on cite saint Justin, Tatien, Athénagore, Méliton de Sardes, Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Origène, Tertullien, Cyprien, Lactance, entre autres.
Après la période la plus dure des persécutions, vers la fin du troisième siècle, la communauté primitive a dû se préoccuper de sauvegarder la foi face à l’intensification des questions théologiques et politiques. Or, Origène et Clément d’Alexandrie promeuvent leurs œuvres en Orient, tandis que de l’Occident, déjà latinisé, surgissent d’importantes œuvres comme celles rédigées par Tertullien. De nombreuses questions restent en suspens en raison de la difficulté et de l’obscurité pour lesquelles les textes bibliques n’offraient pas de plus amples explications. Ainsi, la typologie, en tant qu’anticipation des événements historiques, et l’allégorie, en tant que signification des éléments des textes (SIMONETTI, 1985, 14), montrent, par exemple, que Jésus meurt avec la couronne d’épines, comme cela avait été anticipé typologiquement par l’agneau qui apparaît pris dans les buissons lors du sacrifice d’Isaac, ou que le cordon – serviette ou drap pour Clément de Rome et d’autres – de couleur rouge que Rahab avait suspendu à sa fenêtre représenterait l’allégorie du sang du Christ pour le salut des pécheurs. Cependant, tous les termes bibliques ne comprennent pas le vaste contenu du mystère révélé par le Christ à son Église, comme on peut l’observer lors de la polémique arienne, raison pour laquelle le Concile de Nicée fut proclamé par l’empereur Constantin en 325. La question qui opposait Arius et les chrétiens de doctrine orthodoxe portait sur la divinité et la provenance de Jésus-Christ du Père, sous la forme d’une terminologie biblique insuffisante que les opposants présentaient pour défendre leur opinion. Pour les pères conciliaires de Nicée, la meilleure façon de résoudre cette impasse fut la promulgation d’un symbole de foi, c’est-à-dire la production de directives qui clarifieraient la manière orthodoxe de croire et d’enseigner la foi de l’Église. Tous les efforts des pères conciliaires ont mis en lumière le terme « consubstantiel », qui ne se trouvait pas dans la Bible, mais qui aidait au discernement de la vérité que l’Église avait toujours prêchée sur la divinité du Fils de Dieu. Parmi les Pères les plus célèbres de cette période, on distingue Eusèbe de Césarée, Athanase et Hilaire de Poitiers.
Remarquables furent également les Pères de Cappadoce – Basile le Grand, Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome – qui jouèrent un rôle fondamental dans la compréhension de la foi trinitaire dans la seconde moitié du IVe siècle. En effet, dans l’œuvre « Contre Eunomius » de saint Basile, apparaît clairement la question de la divinité du Saint-Esprit, vision contre laquelle les hérétiques établissaient que, tout comme le Fils, le Saint-Esprit était aussi une créature de la divinité. Les Cappadociens répondirent aux menaces contre le Saint-Esprit et devinrent des références essentielles pour le Concile de Constantinople en 381, au cours duquel fut proclamé le symbole connu jusqu’à ce jour sous le nom de credo de Nicée-Constantinople.
Après les conciles de Nicée et de Constantinople, fut célébré à Éphèse le concile qui mit en discussion, entre autres thèmes, le dogme de la theotókos, sur Marie, Mère de Dieu, en l’an 431. Par conséquent, le christianisme se divisa entre ceux qui acceptaient l’interprétation orthodoxe de Cyrille d’Alexandrie, par laquelle le concile d’Éphèse déclara que Marie est la mère de Dieu, et la position hérétique de Nestorius, qui insistait pour nier la maternité de Marie par rapport à la divinité du Christ ; c’est pourquoi la Vierge ne devait être connue que comme « mère du Christ » selon l’opinion des hérétiques. Les problèmes théologiques inhérents à cette question étaient typiquement christologiques, tandis que la compréhension des nestoriens créait de grands obstacles à la compréhension de la véritable divinité du Christ, répétant ainsi les erreurs de l’arianisme et du sabellianisme. Vaincu par les arguments de Cyrille, Nestorius fut déposé du siège de Constantinople. Malheureusement, le nestorianisme gagna de nombreux adeptes tout au long de l’antiquité.
À l’aube du cinquième siècle, la littérature latine de l’Église s’enrichit des œuvres d’Ambroise, Augustin et Jérôme. C’est la phase où les autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire les évêques, sont confrontées à des situations sociales importantes pour la contextualisation et le développement de la vie de l’Église : a) l’Empire romain organise son administration gouvernementale à partir des principes chrétiens établis par l’édit de Théodose en 380, qui instituait définitivement le christianisme comme religion officielle de l’Empire. D’ailleurs, malgré l’importance accordée à l’édit de Milan décrété par l’empereur Constantin en 313, il ne faut pas oublier que cet édit ne prévoyait que la licéité du christianisme jusqu’à ce moment. L’édit de Milan prescrivait que la religion chrétienne était licite, tandis que l’édit de Théodose la rendait officielle pour le citoyen romain. b) la dévotion aux martyrs est renforcée par la régularisation promue par les évêques, lorsque leurs reliques sont transférées des catacombes aux autels des églises, instituant ainsi le culte de dévotion aux saints, dans la perspective de ceux qui avaient vécu l’intégrité de la foi chrétienne dans toutes ses exigences. c) en 410, les barbares arrivèrent à Rome et déterminèrent ainsi, par leur déplacement, une nouvelle forme pour les villes de l’Empire romain. Par conséquent, les besoins pastoraux et théologiques subiront des conséquences essentielles qui détermineront le chemin que l’Église choisira pour sa mission dans le monde.
D’une importance capitale fut le Concile de Chalcédoine, en 451, qui défendit, contre les monophysites, la foi en Jésus-Christ par laquelle se définissait l’union des deux natures (humaine et divine) en une seule personne, clarifiant ainsi ce que l’Église enseigne sur l’union hypostatique. Des siècles plus tard, en 681, avec le troisième Concile de Constantinople, on mit fin aux difficultés du monothélisme et du monoénergisme. Enfin, se multiplièrent les grandes homélies et traités théologiques produits par les saints pères sous la lumière de la grâce, de la vie morale et sacramentelle. En ce sens, Paschase Radbert s’insère parmi les auteurs de la clôture de la période patristique avec sa grandiose et importante œuvre sur l’eucharistie intitulée De Corpore et Sanguine Domini en 831.
3 Herméneutique Patristique
Les Pères de l’Église reconnaissaient unanimement les difficultés qui surgissaient de la lecture des Saintes Écritures et finirent par tracer des voies par lesquelles ils croyaient que ces difficultés pouvaient être surmontées. Pour eux, il était fondamental de respecter les lois de base de la composition pour comprendre le vrai sens que l’auteur biblique aurait donné à son texte. C’est pourquoi, à de nombreuses reprises, la solution aux difficultés bibliques s’appuyait sur la compréhension de base que la grammaire et la rhétorique donnaient aux mêmes textes. Bien que les interprétations bibliques soient diverses par rapport à l’exégèse contemporaine, depuis les temps reculés du christianisme, les lecteurs des Saintes Écritures étaient invités à s’interroger sur le genre littéraire des textes et l’intention des auteurs en les écrivant. La base de l’investigation biblique des premiers siècles – comme le démontre Irénée de Lyon – résidait dans l’évaluation de la véracité du texte que les chrétiens devaient utiliser, car la pseudo-littérature chrétienne et les écrits apocryphes se multipliaient. Entre autres déterminations, l’interprétation biblique à ce moment ne pouvait pas se passer de la règle de foi de l’Église. Aucune proposition d’interprétation ne pouvait être considérée comme valide si elle contredisait les enseignements de la foi chrétienne, transmise par le Christ à ses Apôtres et par les Apôtres aux générations successives.
Au troisième siècle, le lecteur des Saintes Écritures est invité à lire une même péricope progressivement selon le sens littéraire, qui l’alerte sur les circonstances matérielles qui y sont décrites ; selon le sens éthique, qui le place devant les valeurs morales pas nécessairement mentionnées dans le texte ; enfin, selon le sens spirituel, valeur véritable vers laquelle le texte inspiré veut orienter chaque homme. L’école d’Alexandrie – avec Clément et Origène – fut la grande promotrice de cette méthode herméneutique.
Parmi les propositions herméneutiques patristiques, on distingue les règles de Tyconius, corrigées et expliquées par Augustin dans le troisième livre du De Doctrina Christiana, où le saint d’Hippone admet qu’il est nécessaire de partir des textes clairs – dont la compréhension ne laisse aucun doute – pour comprendre les textes obscurs. Selon Augustin, il n’y a aucune contradiction de quelque genre que ce soit entre les textes des Saintes Écritures. Les difficultés naissent de la limitation du langage humain, par lequel Dieu a voulu transmettre ses vérités. Selon Augustin, le lecteur attentif considère, par exemple, que tous les textes bibliques traitent de l’unité inséparable entre le Christ et l’Église, trouvant dans cette unité la réponse aux difficultés et aux apparentes contradictions bibliques.
Dans le processus d’instruction de la foi, le mystagogue joue le rôle de révéler au catéchumène les mystères que celui-ci doit embrasser au moment du baptême. Étant donné les difficultés mentionnées ci-dessus, le contenu de la foi chrétienne est considéré comme arcanum, c’est-à-dire que sa transmission prévoit l’accès à des informations secrètes (mystères), que seuls les initiés, c’est-à-dire les catéchumènes, pouvaient recevoir. Vingt-quatre catéchèses mystagogiques de Cyrille de Jérusalem (†387) sont parvenues jusqu’à nos jours en groupes de textes qui décrivaient une période pré-catéchétique durant laquelle les aspirants étaient appelés les ‘illuminés’ et où on leur offrait une introduction au baptême, transmise en une catéchèse. Le plus grand groupe de textes, avec 18 catéchèses, servait de référence pour les rencontres qui avaient lieu pendant le carême. Enfin, juste après le baptême qui était célébré la nuit de Pâques, 5 catéchèses étaient destinées aux néophytes pour tenter de leur exposer ce qu’ils n’étaient pas encore capables de comprendre.
André Luiz Rodrigues da Silva. Brésil.
4 Références bibliographiques
ALTANER, B. Patrologia: vida, obra e doutrina dos padres da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1988.
CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Instrução sobre o estudo dos Padres da Igreja na formação sacerdotal. Petrópolis: Vozes, 1990.
CONTRERAS, E.; PEÑA, O. Introducción al estúdio de los Padres. Período pre-niceno. Azul: Monastério Trapese de Azul, 1991.
DROBNER, H. R. Patrologia. 2.ed. Casale Monferrato: Piemme, 2002.
FLORIAMO, G; MENOZZI, D. Storia del Cristianesimo. L’antichità. Bari: Laterza, 1997.
GOMES, C. F. Antologia dos Santos Padres. São Paulo: Paulinas, 1979.
GRECH, P. Il messaggio bíblico e la sua interpretazione: saggi di ermeneutica, teologia ed esegesi. Bologna: RevBSup, 2005.
GROSSI, V.; DIBERARDINO, A. La chiesa antica: ecclesiologia e istituzioni. Roma: Borla, 1984.
HAMMAN, A. Os padres da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1985.
LIVINGSTONE, E. A. Studia Patrística. Vol. XXII: Cappadocian Fathers, Chrysostom and his greek contemporaries, Augustin, Donatism and Pelagianism. Leuven: Peeters, 1989.
LUISELLI, B. La formazione della cultura europea occidentale. Roma: Herder, 2003.
______. Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico. Roma: Herder, 1992.
McGRATH, A. E. Christian theology. An introduction. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
MORESCHINI, C.; NORELLI, E. Manuale di letteratura cristiana antica greca e latina. Brescia: Morcelliana, 1999.
______. História da literatura cristã antiga grega e latina. I: De Paulo à era constantiniana. São Paulo: Loyola, 1995.
______. Storia della letteratura cristiana antica greca e latina. II: Dal concilio di Nicea agli inizi del Medioevo. Brescia: Morcelliana, 1996.
ORBE, A. La teologia dei secoli II e III: Il confronto della Grande Chiesa con lo gnosticismo. Vol. 1: Temi veterotestamentari. Roma: Gregoriana, 1996.
______. La teologia dei secoli II e III. Vol. 2: Temi neotestamentari. Casale Monferrato: Piemme, 1995.
PADOVESE, L. Introdução à teologia patrística. São Paulo: Loyola, 2004.
PENNA, R. Le prime cominità cristiane. Roma: Carocci, 2011.
SANTINELLO, G. Storia del pensiero occidentale. Vol. 2. Milano: Marzorati, 1973.
SESBOUE, B.; WOLINSKI, J. O Deus da Revelação. São Paulo: Loyola, 1997.
SIMONETTI, M. Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi patrística. Roma: SEA, 1985.
______. Letteratura Cristiana antica. Testi originali a fronte. 3: La separazione fra Oriente e Occidente (dal quinto al settimo secolo) . Casale Monferrato: Piemme, 2000.
______. Letteratura Cristiana antica. Testi originali a fronte. 2: Dall’epoca costantiniana alla crisi del mondo antico (quarto secolo). Casale Monferrato: Piemme, 2000.
______. Letteratura Cristiana antica. Testi originali a fronte. 1: Dalle origini al terzo secolo. Casale Monferrato: Piemme, 1996.
SIMONETTI, M.; PRINZIVALLI, E. Letteratura Cristiana antica. Profilo storico, antologia di testi e due saggi inediti in appendice. Casale Monferrato: Piemme, 2003.
______. Storia della letteratura Cristiana antica. Casale Monferrato: Piemme, 2002.