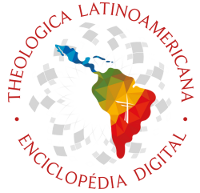Sommaire
1 Qu’est-ce que c’est ?
2 Histoire
3 Œcuménicité, les Églises et la participation des laïcs
4 La doctrine actuelle
5 Références bibliographiques
1 Qu’est-ce que c’est ?
La tenue de grandes assemblées d’évêques est une pratique qui traverse l’histoire millénaire de l’Église, l’animant continuellement. Les conciles sont nés spontanément, influencés par les modèles du Sanhédrin hébraïque et du Sénat romain. Tout indique que les rencontres d’évêques d’une même région, sanctionnant la désignation d’un nouvel évêque faite par la communauté locale par la consécration, se trouvent au cœur de cette praxis qui germait déjà depuis le IIe siècle.
La périodicité des conciles n’est pas régulière et peut donner l’impression de quelque chose d’aléatoire. La raison de leur convocation est la résolution de problèmes doctrinaux, tels que l’affrontement des hérésies, le besoin urgent de réformes, les défis à l’autorité de l’Église ou la réflexion et la délibération sur d’autres questions significatives à certaines périodes historiques. C’est dans les conciles que l’Église réfléchit sur elle-même, en se tournant vers les questions qui affectent sa vie. En général, ils marquent les moments les plus significatifs de sa vie ecclésiale. Il faut également tenir compte du long temps de préparation et, surtout, de mise en œuvre et de réception (ALBERIGO, 1997, p.5). Dans tout concile, l’Église étudie comment résoudre ses problèmes, établit des principes ou des normes, et organise leur application.
Sur la base de cette histoire de la praxis conciliaire, le pape Paul VI s’est adressé aux participants du Concile Vatican II en déclarant :
Il vous appartiendra, Vénérables Frères, de nous indiquer les mesures à prendre pour purifier et rajeunir le visage de la sainte Église. Mais nous vous redisons notre volonté de favoriser une telle réforme : combien de fois dans les siècles passés cette intention apparaît-elle associée à l’histoire des Conciles ! Qu’il en soit ainsi une fois encore, et cette fois non pas pour extirper dans l’Église certaines hérésies et désordres généraux qui, grâce à Dieu, n’existent plus maintenant, mais pour insuffler une vigueur spirituelle nouvelle au Corps Mystique du Christ, comme organisation visible, en le purifiant des défauts de nombreux de ses membres et en le stimulant à de nouvelles vertus (PAUL VI, 1964, n.22).
2 Histoire
Dans les archives historiques, synode et concile se réfèrent souvent au même type de réunion. L’Église catholique possède une liste de 21 conciles considérés comme généraux ou œcuméniques. Le concile souvent pris comme modèle ne fait pas partie de cette liste. Il s’agit du « Concile de Jérusalem », qui a réuni Pierre, Jacques, Paul, Barnabé et d’autres en l’an 49 ou 50. Moins de deux décennies après la résurrection de Jésus, les chrétiens ont été confrontés à la question : faut-il être juif pour pouvoir devenir chrétien ? Certains défendaient avec véhémence que oui, d’autres que non. Pour résoudre cette controverse, « ils décidèrent que Paul, Barnabé et quelques autres monteraient à Jérusalem pour traiter cette question avec les apôtres et les anciens. Pourvus et envoyés par la communauté (…) » (Ac 15,2-3). Cette procédure se répète constamment. Des responsables venus de divers endroits se rendent en un même lieu, en tant que représentants de leurs communautés, pour discuter d’un problème qui affecte tout le monde et chercher des solutions.
Des siècles plus tard, la controverse arienne, répandue en Orient, a provoqué le premier synode œcuménique de Nicée (325), reconnu comme premier concile œcuménique. Celui-ci et les autres conciles œcuméniques jusqu’au huitième, en 869, ont été convoqués par l’empereur et se sont déroulés sous la protection et la surveillance de l’Empire romain, devenu chrétien. Leurs décisions devenaient des lois impériales. Durant le premier millénaire, des empereurs et une impératrice ont convoqué et parfois présidé certains conciles. La plupart du temps, cela s’est fait avec la connaissance et la bénédiction du pape. En général, les évêques présidaient les sessions. L’évêque de Rome n’a pas participé personnellement à aucun des premiers conciles, mais ses représentants jouissaient d’une position de privilège et signaient les actes en premier. Dans les quatre premiers conciles œcuméniques, la doctrine trinitaire et christologique a été formulée. Ils ont consolidé et renforcé la foi de l’Église naissante, dans une relation dialectique avec la culture classique. Ils ont été comparés par saint Grégoire le Grand (†604) aux quatre Évangiles, mais sans leur être assimilés en termes d’autorité (JEDIN, 1970, p.242).
De manière générale, les premiers conciles ont été convoqués pour établir des règles doctrinales visant à combattre les hérésies. Après le schisme d’Orient, au XIe siècle, les conciles généraux sont devenus occidentaux et pontificaux. Ils étaient convoqués par l’évêque de Rome, présidés personnellement par lui ou ses représentants, et confirmés par lui. Ces conciles généraux s’efforçaient de réglementer la societas christiana de l’Occident. Trente et Vatican I ont choisi de défendre le catholicisme romain contre les thèses des réformateurs et les menaces de la culture sécularisée, générant surtout une théologie anti, c’est-à-dire d’opposition. Les deux conciles du Vatican ont des accents très différents : le premier définit l’infaillibilité papale ; le second se caractérise par un engagement pastoral marqué, compris comme un dépassement de la longue période durant laquelle l’Église s’est opposée à la société et a multiplié les condamnations. Le Concile Vatican II s’est abstenu non seulement des anathèmes, mais aussi des définitions. Il s’est passé du binôme doctrine-discipline et a cherché une mise à jour globale de l’Église (aggiornamento), en réponse aux signes des temps et aux grandes transformations de la société contemporaine (ALBERIGO, 1997, p.7-8).
Certains conciles ont repris des thèmes ou des problèmes abordés par le concile précédent, cherchant à les résoudre complètement. Les huit premiers conciles, de Nicée I (325) à Constantinople IV (869-870), ont été convoqués dans une séquence relativement rapide, car le credo et les affirmations fondamentales de la foi énoncés par un concile soulevaient souvent de nouvelles questions, qu’il fallait impérativement affronter. Certains conciles se sont suivis presque immédiatement pour traiter d’un même problème persistant. Quatre conciles latéraniens ont été convoqués en 1123, 1139, 1179 et 1215 pour réformer l’Église (BELLITTO, 2010, p.15-16). En d’autres occasions, un concile a conclu les travaux entamés par le précédent, qui, en raison de circonstances défavorables, n’avaient pas pu être poursuivis. Cette relative continuité existe entre les conciles Latéran V et Trente, et entre Vatican I et Vatican II.
À première vue, le nombre de 21 conciles donne l’impression erronée que les conciles généraux se réunissaient une fois par siècle au cours des deux mille ans d’histoire du christianisme. En réalité, la fréquence des conciles généraux a été sporadique ou en blocs, avec de longues périodes sans réunion. Les conciles généraux pouvaient durer seulement une semaine, comme Latran II (1139), ou jusqu’à trois ans et demi sans interruption, comme Constance (1414-1418). Cependant, une durée plus longue ne signifie pas nécessairement une plus grande importance ou davantage de réalisations. Le concile de Latran IV n’a duré que vingt jours, mais fut le plus remarquable des conciles médiévaux réformateurs. Le Concile Vatican II s’est réuni pendant 281 jours au total, répartis en quatre sessions d’automne. Toutefois, comme dans tous les conciles, une grande partie des travaux a eu lieu en coulisses, dans les commissions préparatoires avant ou après les sessions plénières. Le concile de Latran V s’est réuni pendant presque cinq années complètes (1512-1517), mais a accompli très peu (BELLITTO, 2010, p.25-26).
3 Œcuménicité, les Églises et la participation des laïcs
Techniquement, un concile œcuménique est celui qui réunit des représentants de l’Église du monde entier. Sur cette base, les sept premiers conciles majeurs sont considérés comme œcuméniques, comme s’est autoproclamé le concile de Chalcédoine en 451. Aux sept premiers conciles, de Nicée en 325 à Nicée II en 787, participaient presque toujours des évêques des parties orientale et occidentale de l’Empire romain, considéré à l’époque comme le monde entier, d’où le nom « œcuménique ». Mais seuls quelques évêques occidentaux y participaient. Le concile de Nicée I, par exemple, comptait 220 évêques, mais seuls quelques-uns venaient de l’Occident. Le concile de Constantinople I (381) ne réunissait que des évêques orientaux. Ces derniers étaient majoritaires aux conciles d’Éphèse (431), de Chalcédoine (451), de Constantinople II (553) et de Constantinople III (680-681).
Les Églises orthodoxes ne reconnaissent que les sept premiers conciles comme œcuméniques, contrairement aux 21 reconnus par l’Église catholique comme généraux ou œcuméniques. Le concile de Latran I (1123), premier après le schisme d’Orient, s’est autoproclamé général, car aucun évêque oriental n’y a participé. En revanche, le concile de Bâle-Florence-Ferrare-Rome (1431-1445) s’est autoproclamé œcuménique, car à cette occasion, évêques occidentaux et orientaux ont traité de la réunification de l’Église (BELLITTO, 2010, p.22-23).
Les laïcs ont participé aux actes officiels de nombreux conciles œcuméniques. L’empereur Constantin ouvrit le Concile de Nicée par un discours en latin. Les commissaires impériaux veillaient à l’ordre extérieur. Au Moyen Âge et au Concile de Trente, des princes séculiers étaient présents ou représentés par leurs ambassadeurs. La fonction de l’empereur romain dans les anciens conciles était externe, de tutelle de l’ordre. Au Moyen Âge et au Concile de Trente, les laïcs représentaient les puissances séculières, dont la collaboration apparaissait nécessaire pour les travaux concernant l’ordre public et les matières mixtes. Au Concile Vatican I, aucun gouvernement ne fut invité.
Certaines questions émergent : les laïcs, en vertu du sacerdoce universel et de leur collaboration à l’apostolat, pourraient-ils ou devraient-ils être au moins entendus sur les sujets qui les concernent, tels que l’apostolat des laïcs ou le mariage ? Une fois invités, les laïcs devraient-ils être admis comme experts ou comme membres ayant droit de vote ? Il n’y a aucune raison pour que les laïcs ne puissent pas être entendus sur les thèmes qui les concernent, tout comme les prêtres spécialistes en théologie ou en droit canonique sont entendus, même s’ils ne sont pas membres du concile avec droit de vote. Un pas vers une solution a été fait par Paul VI, en admettant des laïcs qualifiés comme auditeurs aux Congrégations Générales à partir de la deuxième session du Concile Vatican II.
Les conciles ont toujours veillé à l’unité de l’Église, mais n’ont pas toujours pu la réaliser. Après le premier et le quatrième conciles œcuméniques, de longues disputes ont suivi. Ni le schisme d’Orient ni la division de l’Église au XVIe siècle n’ont pu être empêchés par les conciles. Aux Conciles de Lyon II et de Ferrare-Florence, l’union avec les orientaux fut officiellement restaurée, mais ne se concrétisa pas, car dans les deux cas elle reposait sur des motifs politiques, sans que les résistances internes dans l’Église grecque soient surmontées. Le Concile de Trente ne put être un concile d’union, car au moment de sa réunion, la rupture ecclésiale était déjà une réalité. Les négociations avec les protestants allemands (1551-1552) ont montré que les conceptions sur l’autorité et la structure des conciles œcuméniques étaient très divergentes. À la veille du Concile Vatican I, l’appel de Pie IX aux protestants à revenir dans l’Église catholique fut rejeté. Lors de la préparation du Concile Vatican II, un secrétariat pour l’unité des chrétiens fut fondé, avec des résultats positifs au sein du concile lui-même et dans les démarches de rapprochement entre les Églises (JEDIN, 1970, p.249-250).
4 La doctrine actuelle
Les principales traditions du christianisme ont des conceptions différentes de l’autorité conciliaire, de l’organisation interne des conciles et de l’effet de leurs décisions. Comme mentionné précédemment, les chrétiens orthodoxes ne reconnaissent que les sept premiers conciles et ont du mal à admettre un nouveau synode pan-orthodoxe. La tradition réformée occidentale a des positions fluctuantes, tant sur les conciles passés que sur un éventuel concile œcuménique futur. La tradition catholique romaine a accentué la référence au pape, surtout à partir du Haut Moyen Âge, à qui revient la direction du concile, y compris la convocation, la détermination du règlement, le fonctionnement quotidien, le transfert et la clôture. L’histoire semble montrer une réduction progressive de l’œcuménicité des conciles : de conciles universels à occidentaux, du premier au deuxième millénaire ; d’occidentaux à romains, de la première à la seconde moitié du deuxième millénaire (ALBERIGO, 1997, p.9). Le rapprochement et le dialogue œcuménique à partir du Concile Vatican II pourraient, à l’avenir, inverser cette tendance.
Dans l’Église catholique, le rôle des conciles œcuméniques est lié au collège des évêques et à son chef, c’est-à-dire au groupe stable et permanent formé par les évêques et leur chef, l’évêque de Rome. Selon le Concile Vatican II :
La nature collégiale de l’ordre épiscopal, clairement attestée par les Conciles œcuméniques célébrés au cours des siècles, se manifeste déjà dans la discipline primitive, selon laquelle les évêques du monde entier communiquaient entre eux et avec l’évêque de Rome dans le lien de l’unité, de la charité et de la paix ; ainsi que dans les réunions conciliaires, où des décisions importantes furent prises en commun après mûre réflexion fondée sur l’avis de nombreux participants ; cela est clairement démontré par les Conciles œcuméniques célébrés au cours des siècles. […] Le pouvoir suprême sur l’Église universelle, que possède ce collège, s’exerce solennellement dans le Concile œcuménique. Il ne peut jamais y avoir de Concile œcuménique sans qu’il soit confirmé ou du moins accepté comme tel par le successeur de Pierre ; et c’est la prérogative du Pontife romain de convoquer ces conciles, de les présider et de les confirmer (LG n.22).
Les conciles œcuméniques conservent et développent le depositum fidei. Ce « précieux dépôt » de la doctrine de la foi qui a été confié (1 Tm 6,20 ; 2 Tm 1,14) n’est pas un simple catalogue d’articles ou un inventaire de choses juxtaposées. Mais, en raison de la nature du message de la révélation et de l’événement salvifique du Christ, il s’agit de la totalité des richesses et des biens du salut remis à l’Église. Celle-ci les communique aux croyants, en actualisant leur contenu avec une prudence remarquable, afin de rendre intelligible, crédible et fécond le patrimoine immuable de cette vérité, tout en répondant aux exigences et aux interrogations des hommes et de leur temps (POZZO, consulté le 21 déc. 2014). Les conciles œcuméniques adaptent également l’exercice du ministère sacerdotal et pastoral, ainsi que la législation de l’Église, aux diverses exigences de chaque époque. Plus cette adaptation est grande, plus son efficacité et son importance dans l’histoire seront notables.
En ce qui concerne son interprétation, la perte des protocoles des travaux conciliaires, dans le cas de Nicée, leur précarité dans les conciles médiévaux, et même leur longue indisponibilité, dans le cas du Concile de Trente, ont renforcé une herméneutique faisant abstraction du contexte historique des décisions, ainsi que de la nature de l’événement conciliaire qui les a exprimées. Il y eut un enfermement dans une interprétation juridico-formelle, longtemps soutenue par la congrégation romaine responsable des conciles (ALBERIGO, 1997, p.10). L’assistance du Saint-Esprit, sur laquelle repose l’inerrance du concile œcuménique en matière de foi et de mœurs, ne doit pas être confondue avec l’inspiration de l’Écriture Sainte. Parmi les théologiens, il est débattu si cette assistance doit être comprise seulement de manière négative, comme préservation de l’erreur, ou comme coopération positive. Cette dernière position correspond mieux à la pensée des anciens conciles (JEDIN, 1970, p.248-250).
Luís Corrêa Lima, SJ. PUC Rio. Texte original en portugais.
5 Références bibliographiques
ALBERIGO, G. (éd.). Histoire des conciles œcuméniques. São Paulo : Paulus, 1997.
BELLITTO, C. M. Histoire des 21 conciles de l’Église : de Nicée à Vatican II. São Paulo : Loyola, 2010.
CONCILE VATICAN II. Constitution dogmatique Lumen gentium sur l’Église (LG). Rome, 1964. Disponible sur : www.vatican.va. Consulté le : 21 déc. 2014.
JEDIN, H. Concile. In : FRIES, H. (éd.). Dictionnaire de théologie : concepts fondamentaux de la théologie actuelle. vol. I. São Paulo : Loyola, 1970. p.242-251.
PAUL VI. Lettre encyclique Ecclesiam suam. Rome, 1964. Disponible sur : www.vatican.va. Consulté le : 20 déc. 2014.
POZZO, G. Depositum fidei. Disponible sur : www.mercaba.org/VocTEO/D/depositum_fidei.htm. Consulté le : 21 déc. 2014.