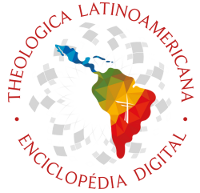Sommaire
1 Première communauté chrétienne
1.1 Ce que l’on entend par christianisme ancien
1.2 La question de la datation chrétienne
1.3 Première communauté chrétienne ou premières communautés chrétiennes ?
1.4 Kérygme, conversion, foi et baptême
2 Première expansion chrétienne
2.1 Le contexte de l’expansion chrétienne
2.2 Un christianisme pluriel dans un monde pluriel
2.3 Les protagonistes de la mission chrétienne
2.4 Ministères
3 Paul : voyages missionnaires
3.1 Traits biographiques de l’Apôtre Paul
3.2 Les voyages missionnaires
3.3 Les lettres pauliniennes
3.4 Paul : véritable fondateur du christianisme ?
4 Christianisme dans le monde romain
4.1 Un monde pluriel
4.2 Citoyens d’une autre cité
4.3 Les premières dissensions et hérésies
4.4 Les conciles et la naissance de la théologie chrétienne
5 Les persécutions dans l’Antiquité
5.1 Causes des persécutions
5.2 Les différentes phases des persécutions
5.3 Le sang des martyrs : semence de nouveaux chrétiens
5.4 La fin des persécutions et le “tournant constantinien”
6 Références bibliographiques
1 Première communauté chrétienne
1.1 Ce que l’on entend par christianisme ancien
De manière générale, on entend par christianisme ancien celui des quatre premiers siècles de l’Ère chrétienne, depuis la naissance de l’Église, lors de l’événement de la Pentecôte (cf. Ac 2), où les disciples de Jésus-Christ reçoivent l’Esprit Saint pour annoncer son Évangile (vers 30 apr. J.-C.) jusqu’à la chute de l’Empire romain d’Occident (476 apr. J.-C.). Cette période de quatre siècles et demi est elle-même divisée en deux grandes étapes : de la prédication apostolique (vers 30) au “tournant constantinien” (313) ou jusqu’au Concile de Nicée (325), puis de là jusqu’à la chute de Rome (476). Dans cette section, nous considérons la première étape du christianisme ancien. Certains auteurs préfèrent parler de cette première étape comme du “christianisme primitif” ou “pré-nicéen”, comme R. Markus, J. Hill ou H. Drobner.
1.2 La question de la datation chrétienne
Les chrétiens, insérés dans le monde gréco-romain, utilisaient au début la datation commune des cultures dans lesquelles ils vivaient. Il existait plusieurs calendriers, basés sur le cycle lunaire ou solaire. Les plus courants étaient le calendrier julien et celui qui comptait les dates à partir de la fondation de Rome (vers 753 av. J.-C.). Au VIe siècle, le moine Denys le Petit organisa les événements de l’histoire connue à partir de l’événement central du christianisme : l’Incarnation du Christ. D’où l’usage courant en Occident des expressions “avant Jésus-Christ” (av. J.-C.), “après Jésus-Christ” (apr. J.-C.), ou encore “Ère chrétienne” ou “Ère commune” (EC). Dans ses calculs, le moine a commis quelques erreurs, qui furent corrigées au XVIIe siècle. En réalité, Jésus-Christ serait né 5 ou 6 ans avant la date proposée par Denys.
1.3 Première communauté chrétienne ou premières communautés chrétiennes ?
Jésus a prêché en Galilée, en Judée, en Samarie et dans quelques territoires païens, terminant sa mission à Jérusalem. La première communauté chrétienne, présentée de manière idéalisée dans les Actes des Apôtres (cf. Ac 2,42-47 et 4,32-35), reflète non seulement la communauté de Jérusalem, mais aussi les autres. L’événement de la Pentecôte (cf. Ac 2,1-13), qui a donné naissance à l’Église, avec la venue de l’Esprit Saint, en présence de personnes venues de toutes les régions, illustre probablement les lieux où les chrétiens avaient déjà constitué des communautés. On peut ainsi parler, dès la première décennie après “l’événement pascal” (mort et résurrection de Jésus), de la naissance de communautés chrétiennes là où il avait proclamé la Bonne Nouvelle du Royaume.
1.4 Kérygme, conversion, foi et baptême
Le christianisme primitif se manifeste dès le début avec une grande vitalité, au point d’accueillir continuellement de nouveaux convertis (cf. Ac 2,41.47 ; 6,7). L’enthousiasme de la prédication sur Jésus ressuscité et le témoignage de vie fraternelle des premières communautés chrétiennes attirèrent rapidement non seulement les juifs, mais aussi les païens. L’annonce du kérygme, centrée sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus (cf. Ac 2,24-36 ; 3,13-26 ; 4,10-12 ; 5,30-32 ; 10,36-43 ; 13,17-41), constituait la prédication fondamentale, qui suscitait la conversion des auditeurs. La foi en la personne et le message de Jésus conduisait à l’entrée dans la communauté chrétienne par le baptême. Autour de la catéchèse baptismale se développa une formule résumant la doctrine des Apôtres : le Credo ou Symbole des Apôtres. Rapidement, la catéchèse fondamentale de préparation au baptême fut organisée dans le catéchuménat.
2 Première expansion chrétienne
2.1 Le contexte de l’expansion chrétienne
La majorité des disciples de Jésus étaient des juifs. La première expansion du christianisme s’est produite dans ce contexte : langue, coutumes, traditions et pratiques juives furent réinterprétées à la lumière du message de Jésus. Depuis le IIe siècle av. J.-C., les juifs étaient dispersés dans le monde hellénisé (diaspora). À Antioche, capitale de la province de Syrie, les disciples du Christ furent appelés pour la première fois “chrétiens” (cf. Ac 11,26). À partir des synagogues et communautés juives hellénisées, le christianisme s’est étendu au-delà du contexte juif traditionnel. Finalement, il atteignit Rome et les frontières de l’Empire romain, dans le contexte du monde gentil ou païen.
2.2 Un christianisme pluriel dans un monde pluriel
Le système routier efficace de l’Empire, la koinè (une forme de grec populaire), le monde urbain de la Méditerranée et la culture hellénisée favorisèrent l’annonce chrétienne. Le judaïsme dans lequel Jésus et ses premiers disciples étaient insérés était déjà diversifié. Après la destruction de Jérusalem (70 apr. J.-C.) et la révolte de Bar Kokhba (130 apr. J.-C.), la branche pharisienne représenta le judaïsme traditionnel. Le monde de l’Empire romain était encore plus diversifié. Le christianisme de la première expansion se présente donc lui aussi comme très pluriel et diversifié. Les textes du Nouveau Testament, la littérature des Pères apostoliques et des apologistes (Ier et IIe siècles), ainsi que la littérature chrétienne hétérodoxe des IIe et IIIe siècles suscitent un vif intérêt pour l’étude du christianisme ancien.
2.3 Protagonistes de la mission chrétienne
Jésus était entouré de nombreux disciples : des foules le suivaient lors de ses déplacements ; il y avait des disciples temporaires et d’autres permanents (cf. Mt 8,18-21 ; Lc 6,12-13.20 ; 8,2-3 ; 10,1 ; Jn 11,1 ; 12,1-11). Ces hommes et femmes furent les premiers protagonistes de la mission chrétienne. Parmi eux, il choisit Douze, institués comme les leaders du “nouvel Israël” (cf. Mt 10,1-4 ; 20,17 ; Mc 3,14 ; 6,7 ; 10,32.35-40 ; 11,11 ; 14,17 ; Lc 8,1 ; 22,28-30 ; Jn 6,67-68). Le mandat de Jésus de “faire des disciples de toutes les nations” (cf. Mt 28,19) exprime la conviction que son message ne se limitait pas à la maison d’Israël. Le message du Maître de Galilée a trouvé un écho non seulement dans le monde juif, mais aussi dans le judaïsme hellénisé et le grand monde païen. Dans chacun de ces contextes, de nouveaux disciples sont apparus. La tradition chrétienne raconte qu’après la Pentecôte, les Douze, après avoir prié ensemble, se sont répartis dans les différentes régions du monde connu pour accomplir ce mandat. Accompagnés de disciples, ils fondaient des communautés. À la fin du Ier siècle et au début du IIe, on trouve des traces de la présence chrétienne au-delà des frontières de l’Empire, notamment à Édesse, centre commercial important du royaume d’Osroène. De là, le christianisme s’est étendu vers l’Asie, atteignant la Perse et l’Inde.
2.4 Ministères
Le Nouveau Testament présente une gamme variée de ministères, ou services de coordination et d’organisation des communautés chrétiennes. Au Ier siècle, dans chaque contexte de l’expansion chrétienne, on voit apparaître différentes formes d’organisation de ces services. Dès le début, le groupe des Douze choisis par Jésus jouissait d’une sorte de primauté d’honneur parmi les disciples. Ils ne doivent pas être confondus avec les apôtres ; la tradition postérieure, à la fin du Ier siècle, les a identifiés comme les “douze apôtres”. Après la trahison de Judas, il fallut en choisir un autre pour le remplacer et compléter le nombre “douze” (cf. Mt 28,16 ; Mc 16,14 ; Lc 24,9.33 ; Jn 20,19.24.26 ; 1 Co 15,5 ; Ac 1,15-26). Dans le contexte juif, dont le modèle est la communauté de Jérusalem, on adopta le modèle du conseil des anciens (presbytres), présidé par un ancien (une sorte de prêtre-évêque). Dans le contexte du judaïsme hellénisé, les diacres, une sorte d’administrateurs des biens, furent rapidement associés aux Douze et aux presbytres (Ac 6,1-6). Dans les communautés fondées par Paul, se distinguent les Apôtres (missionnaires itinérants, fondateurs et responsables généraux des communautés : cf. Ac 13,2 ; 14,27 ; 15,27 ; 18,22), les Prophètes (dirigeants locaux et présidents des célébrations : cf. 1 Co 14,15-17.29-32) et les Docteurs (une sorte de catéchistes : Ac 13,1 ; 18,4 ; 22,3). À la fin du Ier siècle, lorsque surgissent des dissensions, avec les “faux prophètes” et autres prédicateurs (cf. Ac 20,29-31), sont institués les gardiens de la “tradition” et du “dépôt de la foi”, les epískopoi (évêques). Les missionnaires commencent à être appelés évangélistes (Ep 4,11 ; 2 Tm 4,5). L’évolution des ministères aboutira, à la fin du IIe siècle, à une structure qui sera généralement adoptée par toutes les Églises : évêque-prêtre-diacre.
3 Paul : voyages missionnaires
3.1 Éléments biographiques de l’Apôtre Paul
L’Apôtre Paul est, sans aucun doute, la figure la plus marquante du premier siècle chrétien. Les deux principales sources à son sujet, pas toujours faciles à concilier, sont les Actes des Apôtres et le groupe d’écrits appelé corpus paulinum. Paul est originaire de Tarse, ville proche d’Antioche. Il est contemporain de Jésus, bien qu’il ne l’ait pas rencontré. Habile fabricant de tentes, il est un juif typique de la diaspora, un pharisien authentique, qui a fréquenté l’école du pharisien Gamaliel à Jérusalem. Il fut l’un des leaders de la persécution des chrétiens, tentant de supprimer la nouvelle religion, et assista au martyre d’Étienne (cf. Ac 9). Cependant, sur le chemin de Damas, il fit une expérience mystique extraordinaire, au cours de laquelle il rencontra Jésus. Après sa conversion, il changea son nom de Saül en Paul. Peu après son baptême, il commença à prêcher le Christ, d’abord en Arabie, puis à Damas. Après une première arrestation, il se rendit à Jérusalem pour rencontrer les Apôtres, puis alla à Tarse, où il resta plusieurs années.
3.2 Les voyages missionnaires
Vers l’âge de 40 ans, Paul entame ses célèbres trois “voyages missionnaires”. En réalité, il s’agit d’allers-retours dans l’Empire oriental, un véritable périple missionnaire, prêchant l’Évangile, fondant des communautés, formant des dirigeants, écrivant des lettres, développant sa théologie. Une aventure qui culminera avec sa détention définitive et sa mort à Rome, vers 64-67 apr. J.-C. Lors de son premier voyage, Paul se rendit en Anatolie, puis à Jérusalem et Antioche. Lors des deux suivants, il parcourut la péninsule grecque. Les principales villes visitées furent : Athènes, Corinthe, Éphèse, Thessalonique et Philippes. De retour à Jérusalem, attaqué par une foule, Paul invoqua ses droits de citoyen romain et demanda à être jugé à Rome, où il fut emmené prisonnier. Il espérait être libéré et poursuivre sa mission. Des traditions ultérieures mentionnent un voyage en Ibérie et en Gaule. Toutefois, il est plus probable qu’il ait été exécuté à Rome.
3.3 Les lettres pauliennes
Lors de ses voyages, Paul fut accompagné de plusieurs collaborateurs, parmi lesquels Timothée, Tite, Barnabé et Luc. Treize lettres ou épîtres du Nouveau Testament portent son nom. Les chercheurs modernes considèrent comme authentiques les suivantes : l’épître aux Romains, la 1re et la 2e aux Corinthiens, celle aux Philippiens, aux Galates, la 1re aux Thessaloniciens et la plus courte, une sorte de billet à Philémon. Ces lettres révèlent ses expériences missionnaires et témoignent de ses préoccupations théologiques. Beaucoup de ses idées furent formulées en réponse aux problèmes pastoraux de ses communautés. Le rôle du Christ crucifié et ressuscité dans l’histoire du salut occupe une place centrale dans la théologie paulinienne.
3.4 Paul : véritable fondateur du christianisme ?
On a parfois affirmé que Paul fut “le véritable fondateur du christianisme”, allant jusqu’à occulter le message original de Jésus et le rôle des Apôtres, comme s’il avait fondé une “nouvelle religion”. Paul occupe, sans aucun doute, une place exceptionnelle dans la diffusion du christianisme primitif. Cependant, il reconnaît lui-même avoir eu des difficultés à être accepté comme Apôtre (cf. Ga 1,15-24 ; 1 Co 15,8 ; Ep 3,1-9). L’une des questions fondamentales soulevées par Paul est de savoir si, pour être un authentique disciple du Christ, il était nécessaire d’accepter toutes les prescriptions de la tradition juive. Le conflit trouva une solution lors de la réunion avec les Apôtres à Jérusalem, au cours de laquelle un consensus fut atteint sur les points fondamentaux de la vie et de la doctrine chrétiennes (cf. Ac 15 ; Ga 2,1-10). Cet accord reconnut la légitimité de la mission auprès des païens, garantissant l’expansion du christianisme et établissant des critères pour la résolution des conflits et l’unité entre les Églises.
4 Le christianisme dans le monde romain
4.1 Un monde pluriel
Le monde dans lequel s’est développé le christianisme ancien, malgré certains signes de décadence, était un monde vigoureux. Au Ier siècle de l’ère chrétienne, la civilisation romaine, héritière de la civilisation hellénistique, avait atteint son plein essor. Nous sommes sous le règne d’Auguste (30 av. J.-C.) et de Tibère (14-37 apr. J.-C.). Rome étend son pouvoir civilisateur, avec la pax augusta, une paix militarisée, jusqu’aux confins de l’Orient. Au IIe siècle, avec les empereurs Antonins, on observe encore l’ordre, le droit et une administration efficace, au sein d’un État relativement libéral. Même avec la grande crise du IIIe siècle, sous Dioclétien (284-305), son histoire prend un nouveau tournant : sous son gouvernement s’instaure une monarchie absolue, soutenue par un puissant appareil administratif.
De nombreuses cultures, de nombreux peuples, de nombreux dieux. L’Empire romain faisait preuve d’une grande tolérance envers les religions des peuples dominés. Il existait même à Rome un “panthéon”, un temple dédié à toutes les divinités de l’Empire. Les Romains exigeaient seulement qu’on observe le culte impérial, de caractère civique, avec ses cérémonies publiques auxquelles tous les citoyens de l’Empire devaient participer, afin d’offrir des sacrifices et de prier pour l’Empereur : dominus ac divus (seigneur et dieu). La religion officielle était la base de l’unité impériale. Y porter atteinte était un crime. Les chrétiens, en affirmant que leur seul Seigneur était le Christ, furent considérés comme suspects, étrangers et ennemis de l’État.
Dans un monde marqué par de nombreuses insécurités, la misère, l’oppression et l’esclavage, proliféraient de nombreuses religions venues d’Orient qui devinrent très populaires. Il s’agissait des cultes d’Horus, Isis et Osiris (Égypte), Mithra (Perse), Asclépios et Esculape figuraient parmi les divinités “sauveuses” les plus populaires. Ces religions avaient un caractère initiatique : elles exigeaient une conversion ou un passage, une nouvelle naissance, une période d’initiation aux “mystères” et une cérémonie d’initiation. Les “initiés” entraient dans la “fraternité”, devenaient des frères, associés à la divinité, leur vie prenait un nouveau sens et l’éternité leur était promise. L’Empire les considérait comme des superstitio, des religio nova, et les déclarait illicites. Le christianisme fut classé parmi ces religions.
Les philosophes considéraient le polythéisme comme une “allégorie” des réalités supérieures, qu’ils avaient dépassées par l’exercice de l’ascèse et de la raison, à la recherche de la véritable doctrine ou philosophie. De nombreux systèmes philosophiques cherchaient à répondre aux grandes questions concernant l’origine et la finalité de l’univers, de toutes choses, des problèmes liés à l’homme et à ses relations dans la polis et avec le monde divin, sur le sens de la justice, du bonheur, de l’immortalité. Ils postulaient généralement l’existence d’un Dieu, principe ou cause transcendant, avec un monde supérieur et immatériel. De nombreuses personnes issues de cet univers culturel chercheront la “véritable philosophie”, qu’elles trouveront dans le christianisme.
Dans cet univers pluriel, naquit au Ier siècle un mouvement de caractère syncrétique, qui amalgamait des éléments de nombreuses traditions culturelles, religieuses et philosophiques. Il s’agissait du gnosticisme : par la gnose, une connaissance supérieure révélée à ceux capables de la recevoir, les gnostiques, l’homme pouvait connaître les mystères du monde divin et se sauver. Aux IIe et IIIe siècles, on assiste à une explosion de sectes et de groupes gnostiques, présents tant chez les païens que chez les juifs et les chrétiens.
4.2 Citoyens d’une autre cité
Les premières générations chrétiennes, bien qu’elles s’opposassent radicalement au “monde”, à la civilisation ambiante, n’étaient pas insensibles à ses valeurs. Elles condamnaient les limites et les vices de cette civilisation païenne : les cruautés (combats de gladiateurs, abandon des nouveau-nés et des personnes âgées), l’immoralité des mœurs (débauches, luxure, orgies : cf. Rm 1,2-32) ainsi que l’idolâtrie et l’attachement à ce monde éphémère.
L’Église accueillit dès le début les humbles, les pauvres, les femmes, les esclaves. Mais bientôt, commerçants, soldats, fonctionnaires de l’Empire et même des membres de l’aristocratie et de la maison impériale se convertirent à la religion du Nazaréen. Tous habitaient ce monde, mais se sentaient citoyens d’une cité impérissable (cf. Lettre à Diognète).
4.3 Les premières dissensions et hérésies
Jésus a annoncé et inauguré la Bonne Nouvelle du Royaume dans un contexte pluriel. Son message s’est diffusé dans un monde pluriel. Son message et sa personne, sa vie ont d’abord été transmis dans une mentalité sémitique, avant de chercher un langage hellénisé pour se faire comprendre, puis successivement germanique, celtique, etc. Il est naturel qu’il y ait eu différentes interprétations de sa personne et de son œuvre. Déjà dans le Nouveau Testament, on trouve diverses “théologies” et des avertissements contre les antéchrists, les faux prophètes. Parmi les premières “options” partielles (“hérésies”), qui ne parvenaient pas à comprendre correctement Jésus-Christ et son message ou qui en déformaient le contenu, on trouve les docètes (Jésus avait l’“apparence” d’un homme, niant ainsi son “humanité”) et les ébionites (il était le Messie, un homme venu de Dieu, mais non le Fils de Dieu, niant ainsi sa “divinité”). Autour de ces deux vérités proclamées et de la manière de vivre et de pratiquer le message de Jésus, sont apparues, aux trois premiers siècles, de nombreuses hérésies et dissensions ou schismes : gnosticisme (divers courants), montanisme, millénarisme, subordinatianisme, adoptionisme, modalisme, manichéisme, parmi tant d’autres.
4.4 Les conciles et la naissance de la théologie chrétienne
Pour faire face à ces défis, dès la fin du IIe siècle et tout au long du IIIe siècle, les Églises tiennent des réunions avec leurs dirigeants afin de résoudre les problèmes et de trouver l’unité sur les questions essentielles. Ce sont les synodes ou conciles. En ce sens, la réunion qui a eu lieu à Jérusalem vers l’an 49 apr. J.-C. est symboliquement considérée comme le premier concile du christianisme. Ces conciles traitaient de questions doctrinales et de questions de vie pratique. À la fin, ils émettaient des décisions sur les sujets traités, à travers des canons dogmatiques et disciplinaires, accompagnés d’une “lettre synodale” envoyée aux Églises sœurs. Fort de cette expérience heureuse, l’empereur Constantin convoquera, en 325, le premier Concile œcuménique pour affronter le problème de l’arianisme.
Dans leur quête pour comprendre le Christ et son message, le salut, la signification de l’Église, en répondant aux hérésies et dissensions et en approfondissant la foi chrétienne, les premiers chrétiens ont développé une théologie chrétienne. Dans ce processus, l’élaboration de la doctrine chrétienne a recours aux ressources culturelles de la civilisation gréco-romaine : la langue grecque et latine, la rhétorique, la philosophie, le droit, les pratiques, les coutumes, les institutions. Ce processus d’appropriation de la culture, utilisant ce qu’elle a de meilleur pour exprimer le message du Christ, de l’intérieur, est communément appelé inculturation. Ce phénomène sera une caractéristique constante de l’expansion du christianisme. La prochaine étape se déroulera dans le monde germanique.
5 Les persécutions dans l’Antiquité
5.1 Causes des persécutions
Au cours des trois premiers siècles de l’ère chrétienne, le christianisme fut persécuté, d’abord par les juifs, puis par les romains. Jusqu’à l’incendie de Rome sous le règne de Néron (vers 64), les chrétiens passaient pratiquement inaperçus, étant confondus avec une secte du judaïsme, qui jouissait d’une certaine liberté et de quelques privilèges. Il est possible que ce soient les juifs qui aient dénoncé les chrétiens à Néron comme étant les responsables de l’incendie.
À cela s’ajoutaient les préjugés populaires, qui voyaient les chrétiens comme des gens détestant le genre humain, athées, impies, sacrilèges, accusés de commettre des abominations et des infamies. En réalité, les chrétiens n’étaient pas “séparatistes”, mais ils ne suivaient pas les coutumes idolâtres et païennes, telles que certaines fêtes publiques, la fréquentation des théâtres, la lutte des gladiateurs, la prostitution, l’adoration des statues ou la divinisation de l’empereur.
Des rumeurs circulaient parmi le peuple selon lesquelles, lors de leurs réunions secrètes, les chrétiens adoraient une tête d’âne, pratiquaient des sacrifices d’enfants, suivis de cannibalisme, avec des unions incestueuses et des orgies (tous s’appelaient “frères” et pratiquaient le “baiser de paix” !).
Les intellectuels et les autorités classaient la religion des chrétiens comme une superstitio, étant ensuite condamnée par l’État comme une associatio illicita, religio nova et religio illicita, pour atteinte à l’unité et à la sacralité de l’Empire. La législation a évolué, au cours du premier siècle, d’une certaine tolérance envers le fait d’être chrétien jusqu’à la condamnation pour le simple fait d’être chrétien. Être chrétien devenait un crime de lèse-majesté.
5.2 Les différentes phases des persécutions
Les persécutions des deux premiers siècles furent sporadiques, locales ou régionales, intermittentes, motivées par des dénonciations ou des actions ponctuelles. Celles du troisième siècle et du début du quatrième furent déclenchées par l’autorité impériale, au moyen de décrets généraux, dans le but d’exterminer le christianisme.
Dans la première phase, elles survenaient à la suite d’incitations populaires, soumises ensuite à l’appréciation des magistrats. Les autorités visaient à contrôler la fureur populaire et les désordres publics. Cependant, le christianisme était déjà considéré comme illégal. Mais elles restaient encore de nature intermittente, suivies de longues périodes de tolérance et de paix.
Avec Septime Sévère, en 202, une nouvelle pratique commence : dans certaines occasions, l’autorité elle-même organise les persécutions. À ce moment, la cible est constituée des catéchumènes (ceux qui se préparaient au baptême), des néophytes (les nouveaux baptisés) et des catéchistes (ceux qui les préparaient). L’objectif était d’empêcher que l’on devienne chrétien.
Au milieu du IIIe siècle, commencent les persécutions systématiques, visant à exterminer effectivement le christianisme. Dèce fut le premier à décréter une persécution générale (250-251). Bien que courte, elle atteignit une intensité et une ampleur jamais vues auparavant. L’objectif, plus que de créer des martyrs, était de faire des apostats. En effet, beaucoup succombèrent et trahirent leur foi ou leur communauté (les lapsi), ouvrant un problème à l’intérieur de l’Église. En 257, Valérien déclencha une nouvelle persécution : elle visait principalement le clergé et les biens de l’Église, mais affectait aussi le peuple, avec une série d’interdictions mettant en péril leur sécurité, confiscation de biens, exils, emprisonnements. La dernière persécution violente fut celle de Dioclétien (303-313).
On estime que le nombre de martyrs variait entre cent et deux cent mille. Quoi qu’il en soit, durant toute cette période, les chrétiens vécurent dans une insécurité permanente et subirent des hostilités de la part du peuple.
5.3 Le sang des martyrs : semence de nouveaux chrétiens
Tertullien de Carthage ( 220) observe que c’est à l’ombre du judaïsme que le christianisme a pu faire ses premiers pas sans affronter l’Empire. Avec Justin de Rome, Athénagoras d’Athènes, Théophile d’Antioche, Irénée de Lyon et Origène d’Alexandrie, il est un penseur, philosophe et théologien qui fait l’apologie du christianisme : défense contre les attaques provenant du peuple, des juifs, des philosophes et des autorités ; contre-attaque contre l’immoralité de la religion païenne, les incohérences du peuple de l’ancienne loi, l’absurdité des théories sur Dieu et la décadence de l’Empire, pour présenter la beauté, la sublimité et l’honnêteté de la religion du Christ.
Plus les chrétiens sont persécutés et martyrisés, plus ils se multiplient. Dans ce contexte, le simple fait d’entrer dans le groupe des catéchumènes ou de demander le baptême démontrait déjà le sérieux des candidats. Ce n’est qu’après les persécutions que l’institution du catéchuménat est devenue plus rigoureuse, dans un contexte de liberté et de plus grande relâchement.
Le premier modèle de sainteté que l’on trouve dans le christianisme ancien est le martyre. Le martyr est le témoin par excellence, qui imite le Christ jusqu’au versement de sang. Martyrs furent plusieurs des disciples qui vécurent avec Jésus, des apôtres, des chefs d’Église et des personnes inconnues, hommes, femmes, enfants, jeunes, adultes, vieillards. Dès les débuts se développe une “spiritualité du martyre”. Le tombeau des martyrs devient rapidement un lieu de pèlerinage et de culte.
Outre diverses sources anciennes, les sources privilégiées pour connaître les martyrs chrétiens sont les acta martyrum : documents rédigés par les autorités elles-mêmes lors du jugement des condamnés et ensuite lus dans les communautés ; les gesta : récits écrits à l’époque des persécutions mêlant éléments historiques et romancés ; et les legenda, pour la plupart postérieures, avec de nombreux éléments fantastiques, constituant une littérature d’édification.
5.4 La fin des persécutions et le “tournant constantinien”
En 313, les empereurs Licinius et Constantin signèrent conjointement un document, l’Édit de Milan, qui accorda la liberté de culte aux chrétiens et à d’autres religions. Prenait ainsi fin l’ère des persécutions contre les chrétiens. Une nouvelle étape commençait, appelée par certains historiens le tournant ou la conversion constantinienne (cf. F. Pierini, H. Matos et D. Mondoni). Constantin accorda aux chrétiens, en plus de la liberté de culte, une série d’exemptions et de privilèges, octroyant des terres, des propriétés, du prestige et du pouvoir à l’Église catholique. En 380, l’empereur Théodose fit du christianisme la religion officielle de l’Empire romain : c’est la phase de “l’Église impériale” ou “l’Âge d’or de la Patristique”.
Dans cette nouvelle étape, le catéchuménat est réformé ; la liturgie et la discipline ecclésiastique se développent ; la théologie patristique atteint son apogée ; c’est aussi la période des grands schismes et hérésies ; les dogmes christologiques et trinitaires atteignent leur formulation la plus complète ; l’organisation de l’Église dans le territoire impérial s’affine, avec les diocèses, paroisses et patriarcats ; la vie religieuse émerge, avec le monachisme ; un nouvel élan missionnaire s’oriente vers les peuples “barbares”. C’est l’époque des conciles œcuméniques : Nicée (325), Constantinople I (381), Éphèse (431) et Chalcédoine (451).
Luiz Antônio Pinheiro, OSA. ISTA. Texte original portugais.
6 Références bibliographiques
MATOS, Henrique Cristiano José. Introduction à l’histoire de l’Église. v.1. 5e éd. Belo Horizonte : O Lutador, 1997. p.7-90.
MONDONI, Danilo. Le christianisme dans l’Antiquité. São Paulo : Loyola, 2014.
PIERINI, Franco. Cours d’histoire de l’Église I. L’âge ancien. São Paulo : Paulus, 1998. p.5-129.
Pour en savoir plus
COMBY, J. ; LEMONON, J.-P. Vie et religions dans l’Empire romain au temps des premières communautés chrétiennes. Documents du Monde de la Bible 5. São Paulo : Paulinas, 1988.
COTHENET, E. Saint Paul et son temps. Cahiers Bibliques 26. 2e éd. São Paulo : Paulinas, 1985.
DANIÉLOU, J. ; MARROU, H. Des origines à Saint Grégoire le Grand. Nouvelle Histoire de l’Église. Tome I. 3e éd. Petrópolis : Vozes. p.23-250.
DROBNER, Hubertus R. Manuel de patrologie. Petrópolis : Vozes, 2003.
GONZÁLEZ, Justo L. L’ère des martyrs. Une histoire illustrée du christianisme. v.1. 3e éd. São Paulo : Vida Nova, 1986.
HAMMAN, A.-G. La vie quotidienne des premiers chrétiens (95-197). Patrologie. São Paulo : Paulus, 1997.
HILL, Jonathan. Histoire du christianisme. São Paulo : Rosari, 2009. p.12-77.
HOORNAERT, Eduardo. La mémoire du peuple chrétien. Collection Théologie et Libération. Série I. Expérience de Dieu et Justice. Petrópolis : Vozes, 1986.
MARKUS, Robert A. La fin du christianisme ancien. São Paulo : Paulus, 1997.
MARROU, Henri Irénée. L’Église au sein d’une civilisation hellénistique et romaine. In : Concilium, n.67, p. 840-50, Petrópolis. 1971/7.
MEEKS, Wayne A. Les premiers chrétiens urbains. Le monde social de l’apôtre Paul. Bible et Sociologie. São Paulo : Paulinas, 1992.
PIERINI, Franco. Cours d’histoire de l’Église I. L’Âge Ancien. Paulus : São Paulo, 1998.
POTESTÀ, G. L. ; VIAN, Giovanni. Histoire du christianisme. São Paulo : Loyola, 2013. p.11-62.