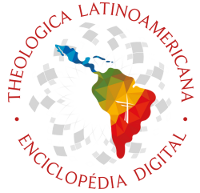Sommaire
1 Introduction
1.1 Qui sont les Pères Apostoliques
1.2 Formation de la collection
1.3 Nature de la collection
2 Caractéristiques Générales
3 Brève présentation de chaque œuvre en particulier
4 Références bibliographiques
1 Introduction
1.1 Qui sont les Pères Apostoliques
L’expression Pères Apostoliques désigne aujourd’hui un corpus d’écrits des Ier et IIe siècles, rédigés par des auteurs qui auraient connu directement les apôtres ou qui auraient été en contact avec des témoins directs de leur enseignement. Pour cette raison, ces œuvres jouissaient d’une grande autorité dans l’Antiquité, au point que certaines figuraient dans les premiers catalogues des Écritures canoniques (comme le Canon de Muratori ou le Codex Sinaiticus du IVe siècle). Ce corpus, aujourd’hui, est considéré de manière variable dans les éditions modernes. Il comprend la Première Épître aux Corinthiens de Clément de Rome, les sept lettres authentiques d’Ignace d’Antioche, l’Épître aux Philippiens de Polycarpe de Smyrne, et le Martyre de Polycarpe, les fragments de Papias d’Hiérapolis, l’Épître de Pseudo-Barnabé, le Pasteur d’Hermas, et la Didaché. Aujourd’hui, À Diognète et l’Homélie de Pseudo-Clément sont également souvent considérés comme faisant partie de ce corpus.
1.2 Formation de la collection
La particularité de ce corpus est qu’il n’a pas été formé dans l’Antiquité, mais qu’il a émergé au XVIIe siècle. Le terme lui-même, autant que nous le savons, a été utilisé pour la première fois par un auteur du VIIe siècle, Anastase le Sinaïte, abbé du monastère Sainte-Catherine au Sinaï (cf. EHRMAN, 2003, p.1), pour désigner le corpus d’écrits attribués à cette époque à Denys l’Aréopagite, une œuvre certainement postérieure à la fin du Ve siècle, que l’on appelle aujourd’hui Pseudo-Denys. Mais ce n’est qu’à partir de 1672, avec la publication par J. Cotelier de l’œuvre SS. Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt etc., que ce groupe d’écrits a commencé à se former. Cotelier, qui utilise pour la première fois, deux fois, dans son œuvre le terme consacré par l’usage apostolicorum patrum collectio (« collection des Pères Apostoliques »), inclut dans cette collection cinq auteurs : Barnabé, Clément de Rome, Hermas, Ignace d’Antioche et Polycarpe de Smyrne. Le critère utilisé par Cotelier pour former ce groupe était que les auteurs aient connu les apôtres ou Paul, ou qu’ils aient été leurs disciples directs (cf. EHRMAN, 2003, p.8-9). En 1765, A. Galandi, dans Bibliotheca veterum patrum, y ajoute les fragments de Papias d’Hiérapolis et À Diognète. En 1883, un manuscrit est découvert, révélant le texte de la Didaché, qui est immédiatement incorporé à cette collection.
1.3 Nature de la collection
Une difficulté soulevée par certains auteurs contemporains est que ce corpus ne suit pas de critères univoques. En effet, on y trouve divers genres littéraires (il y a des lettres; le Pasteur est considéré par de nombreux auteurs comme un exemple de littérature apocalyptique; Pseudo-Clément est une homélie; À Diognète est une apologie, etc.). Si le critère est d’avoir connu les apôtres ou Paul, la difficulté réside dans le fait que l’Épître de Barnabé (qui est plutôt un traité), par exemple, est un cas de pseudépigraphe, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été écrite par le collaborateur de Paul, tout comme Clément n’est certainement pas l’auteur de l’homélie qui fait partie du corpus.
Certains auteurs, comme Drobner (1998, p.98-9), estiment que l’expression corpus devrait être abandonnée et les œuvres reclassées dans l’histoire de la littérature chrétienne selon des critères plus homogènes (chronologiques ou de genre littéraire). Nous ne voyons aucune difficulté à continuer d’utiliser cette expression, déjà consacrée par la tradition pluriséculaire, tant que nous sommes conscients de sa nature hétérogène et de l’unicité de chaque œuvre. Les Pères Apostoliques, ainsi que d’autres sources pertinentes, sont un témoignage indispensable pour comprendre la dynamique des premiers moments de la formation de la conscience croyante et de l’Église : « ils sont une source privilégiée pour étudier la christologie, la question de la pénitence, qui émerge particulièrement dans le Pasteur d’Hermas, le martyre, l’option préférentielle pour les pauvres, la pratique sacramentelle, la vie et l’organisation de l’Église primitive » (DELL’OSSO, 2011, p.10).
2 Caractéristiques Générales
Tous les auteurs qui se sont penchés sur les Pères Apostoliques, ainsi que les simples lecteurs, sans intérêt direct pour la Patristique ou la littérature chrétienne ancienne, s’accordent à dire que, dans les pages de ces Pères, on perçoit une simplicité qui semble disparaître dans les œuvres des Pères postérieurs, surtout à partir du IVe siècle. Les jugements des auteurs classiques et contemporains sont significatifs : « La préoccupation qui inspirera les apologistes du IIe siècle, d’offrir une explication scientifique du christianisme ou des dogmes en particulier, est encore lointaine » (ALTANER, 1968, §23). « Les écrits des Pères Apostoliques ont un caractère pastoral. Leur contenu ainsi que leur style les rapprochent des livres du Nouveau Testament » (QUASTEN, 1980/2009, p.44). « Chaque fois que l’on ouvre une de leurs pages, on découvre de nouveaux aspects d’humanité, de sagesse et d’expériences éclairées. Ils ne vieillissent jamais parce qu’ils possèdent une véritable surabondance de vie spirituelle. (…) De toute la littérature chrétienne ancienne, celle des Pères Apostoliques est peut-être la plus spontanée, réussissant à susciter l’intérêt même des plus critiques du christianisme d’aujourd’hui » (QUACQUARELLI, 1991, p.375-6). « Les auteurs de ces œuvres n’étaient pas des écrivains professionnels, mais écrivaient pour les chrétiens, avec un langage compréhensible et simple, tel qu’ils s’adressaient à leurs frères dans la foi » (DELL’OSSO, 2011, p.6).
Cependant, il serait une erreur de considérer ces écrits comme « plus purs » par rapport à une prétendue décadence des œuvres postérieures allant dans une direction intellectualiste. En réalité, ces écrits ne traitent pas de « théologie » telle que nous l’entendons aujourd’hui et telle que nous la trouvons chez les auteurs principalement à partir du IVe siècle, car le christianisme n’avait pas encore été confronté à des questions concernant la véracité de ses affirmations. Cela se produira surtout lors de la confrontation avec le gnosticisme et l’arianisme, qui provoqueront la nécessité d’une réponse en accord avec le dépôt de la foi tel qu’il avait été reçu. Les premiers textes réellement théologiques, tels que nous les comprenons, sont ceux d’Irénée de Lyon et surtout ceux d’Origène, en réaction aux gnostiques; un pas supplémentaire sera franchi par les Pères Cappadociens (Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse) en réaction à l’arianisme et à l’apollinarisme. Les textes des Pères Apostoliques restent dans le style biblique, ont un intérêt parénétique particulier, d’exhortation morale, et abordent des questions concernant la vie de la communauté. Leur langage est concret, ils utilisent encore les catégories de l’Ancien Testament dans l’intention de rendre compte de la nouveauté expérimentée avec les événements liés à Jésus. Dans leurs pages, nous trouvons l’expression de la nouveauté chrétienne, montrant qu’il n’est pas encore nécessaire d’utiliser des catégories et un langage différents de ceux de l’Écriture Sainte, contrairement à ce qui sera nécessaire pour répondre à des questions différentes concernant leur foi. La théologie trinitaire d’Origène et le développement dogmatique à partir de Nicée (325) et de Constantinople I (381), ainsi que les derniers moments de la réflexion théologique d’Athanase d’Alexandrie et des Cappadociens, sont les réponses appropriées aux nouvelles questions posées respectivement par les gnostiques et par Arius. Les Pères Apostoliques ne traitent pas de ces thèmes parce que la conscience théologique de leur temps n’avait tout simplement pas encore eu besoin de se différencier théoriquement. Cela ne diminue pas, au contraire, cela renforce leur caractère extraordinaire en tant que source de grande valeur pour les débuts du christianisme dans toutes ses dimensions : « leurs riches et significatives diversités et le développement de la compréhension de leur propre identité, distinction sociale, théologie, normes éthiques et pratiques liturgiques » (EHRMAN, 2003, p.13-4).
3 Brève présentation de chaque œuvre en particulier
Épître aux Corinthiens de Clément de Rome, également connue sous le nom de 1Clem. Le texte lui-même est anonyme, mais il s’agit certainement d’une lettre de la sphère romaine, et son attribution à l’évêque de Rome, Clément, est constante dans les sources anciennes et dans le consensus général des chercheurs modernes. Citée par des sources anciennes écrites avant 170 et faisant référence à la persécution de Néron (64) et à un temps de persécution pendant que l’auteur écrit, cela suggère la période finale du règne de l’empereur Domitien (81-96). Le texte est une exhortation à la paix écrite par l’Église de Rome et adressée à l’Église de Corinthe à l’occasion de graves tensions internes dans cette dernière. La popularité de la lettre était énorme, au point qu’elle était encore lue dans les assemblées chrétiennes en 170. Traditionnellement, cette lettre était considérée comme une indication de la position prééminente de l’Église de Rome, capable d’intervenir dans les dynamiques internes d’une autre Église. Récemment, il a également été proposé de voir cette lettre comme un cas de « correptio fraterna [correction fraternelle] », à comprendre non pas comme une simple exhortation, mais comme une procédure juridique précise qui pourrait conduire à l’exclusion de la communauté” (LONGOBARDO, 2007, p.141)[1]. Si ce n’est pas sur le plan juridique, cependant, la légitimité de l’intervention de l’Église de Rome était certainement reconnue au moins sur le plan pastoral. La lettre est également intéressante pour les thèmes philosophiques présents dans son texte, ainsi que pour la saveur biblique qui la traverse.
Homélie du Pseudo-Clément. Dans la tradition manuscrite de 1Clem, exactement dans trois manuscrits, après l’Épître aux Corinthiens mentionnée ci-dessus, on trouve ce texte, appelé dans deux des trois manuscrits « Deuxième Épître de Clément aux Corinthiens ». Le texte semble être une ancienne homélie, probablement baptismale, mais d’origine orientale (Égypte, Syrie), datant du milieu du IIe siècle. « C’est le plus ancien sermon chrétien qui nous soit parvenu, adressé à des néophytes, dont le ton simple et sobre révèle un écrivain dépourvu d’aspirations littéraires » (DELL’OSSO, 2011, p.213).
Les Lettres d’Ignace d’Antioche. La discussion autour de ces lettres fut, en son temps, énorme. Ignace fut évêque d’Antioche entre les Ier et IIe siècles (traditionnellement, sa mort est datée de l’année 107, sous l’empereur Trajan). L’ancienneté et, par conséquent, l’autorité de ces lettres sont d’une importance considérable, car elles nous fournissent des indications précises sur la structure et l’organisation de l’Église à son époque. En particulier, l’épiscopat monarchique impressionne, où l’évêque est le garant de l’unité de l’Église; la structure évêque-prêtre-diacre de l’ordre ministériel; mais aussi la centralité du mystère du Christ, avec une insistance sur la réalité de l’incarnation contre les évidentes positions adverses de type docétiste. Notable également est la spiritualité du martyre, liée à une célèbre image eucharistique.
Le fait que le corpus de ses lettres nous soit parvenu de manière complexe a favorisé les positions de ceux qui, opposés à la reconnaissance d’une telle organisation hiérarchique ecclésiale déjà aux Ier-IIe siècles, niaient l’authenticité des lettres, les considérant beaucoup plus tardives. « Jusqu’à nos jours, le scepticisme a été alimenté par l’histoire compliquée du texte, dans laquelle la critique textuelle s’est vite mêlée à des questions théologiques et a été influencée, et parfois même guidée, par des choix confessionnels, devenant de plus en plus le véhicule d’une critique littéraire pas toujours exempte de présupposés concernant le contenu » (PROSTMEIER, 2006, p.490).
Aujourd’hui, il y a un consensus assez généralisé sur la reconnaissance de l’authenticité des sept lettres qu’Ignace a écrites lors de sa déportation vers Rome, où il devait être jugé et exécuté, les rédigeant à la manière d’un « journal de voyage écrit par le martyr designatus, pour utiliser une expression de Tertullien » (QUACQUARELLI, 1991, p.97). Ces lettres sont : Aux Éphésiens, Aux Magnésiens (c’est-à-dire à la communauté de Magnésie sur le Méandre, aujourd’hui territoire de la Province d’Aydin, en Turquie), Aux Tralliens (c’est-à-dire à la communauté de Tralles, aujourd’hui Aydin, en Turquie), Aux Romains, Aux Philadelphiens (c’est-à-dire à la communauté de Philadelphie, aujourd’hui Alaşehir, en Turquie), Aux Smyrniotes (de Smyrne, aujourd’hui Izmir, en Turquie), À Polycarpe.
Épître aux Philippiens de Polycarpe de Smyrne. Ayant reçu de la communauté de Philippes la demande d’une copie des lettres d’Ignace qu’il possédait, l’évêque de Smyrne les envoya accompagnées d’une lettre de sa propre main, qui aujourd’hui, contrairement aux hypothèses antérieures, est considérée comme unique et non comme la fusion d’une lettre avec un billet (chap. 13). La lettre est importante car elle parle justement des lettres d’Ignace mentionnées. Profitant de l’occasion, Polycarpe exhorte les chrétiens de Philippes à la morale quotidienne et les encourage à résister aux tentations docétistes. Elle a probablement été écrite peu de temps après la mort d’Ignace.
Le Martyre de Polycarpe. Selon Irénée, Polycarpe aurait connu l’apôtre Jean. Il semble cependant que l’évêque de Lyon ait confondu l’apôtre avec un presbytre homonyme, contemporain de Polycarpe, mentionné par Papias d’Hiérapolis (DELL’OSSO, 2011, p.131). Après sa mort, de nombreuses communautés demandèrent des nouvelles du martyre de ce vieil évêque (décédé à l’âge de 86 ans), qui jouissait d’une grande autorité. Le texte, qui en soi serait une lettre, inaugure (cf. LONGOBARDO, 2007, p.143), cependant, le genre littéraire du martyre, et utilise pour la première fois le terme « martyr », dans le sens où il sera connu surtout à partir des persécutions de la moitié du IIIe siècle. Dans le Martyre de Polycarpe, nous trouvons presque tous les éléments qui serviront de base au culte et à la spiritualité des martyrs.
Épître de Barnabé (ou Pseudo-Barnabé). Nous trouvons cet important texte répertorié juste après l’Apocalypse, dans le célèbre Codex Sinaiticus, un manuscrit du IVe siècle qui contient la plus ancienne copie complète du Nouveau Testament, donc parmi les livres considérés comme inspirés. Certaines preuves internes nous amènent à dater cet écrit de la première moitié du IIe siècle, probablement dans le contexte alexandrin, mais sans exclure la possibilité de la Palestine ou de la Syrie. Il n’est certainement pas de l’auteur qui fut le compagnon et collaborateur de Paul, c’est pourquoi il est aujourd’hui également désigné sous le nom de Pseudo-Barnabé. Bien que la forme soit de genre épistolaire, le texte est en réalité un véritable traité, où pour la première fois – autant que nous le sachions – la question de la relation entre le christianisme et le judaïsme est abordée. La première partie est écrite dans une perspective fortement critique à l’égard du judaïsme, duquel il prend clairement ses distances; dans la seconde partie, on trouve un catéchisme parénétique, selon l’image classique des deux voies. Comme dans toutes les œuvres polémiques avec le judaïsme de cette période, ou dans la littérature syriaque du IVe siècle, comme chez Aphraate et Éphrem de Nisibe, il serait une grave erreur de lire ces textes comme un « antisémitisme » ante litteram. Les disputes les plus furieuses se produisent souvent entre frères. Et dans ces textes, nous assistons au développement d’une nouvelle compréhension et au processus d’affirmation d’une nouvelle identité due à l’adhésion à l’expérience de ce qui s’est passé avec Jésus, par laquelle la différenciation par rapport aux origines juives a entraîné des tensions non négligeables des deux côtés. Nous sommes pleinement d’accord avec C. Dell’Osso lorsqu’il dit que le Pseudo-Barnabé est « le résultat de cet effort de réflexion que le mouvement chrétien émergent était en train de faire dans sa recherche des raisons de sa différence par rapport au judaïsme, ou dans la recherche de l’identité chrétienne en relation avec la matrice juive » (2011, p.178).
Le Pasteur d’Hermas. Ce texte, comparé aux autres appartenant au corpus des Pères Apostoliques, est certainement le plus difficile à situer dans le cadre. L’auteur serait Hermas, frère du Pape Pie (140-155), selon l’information du Canon de Muratori. Origène, d’autre part, émet l’hypothèse que l’auteur du Pasteur est le Hermas salué par Paul dans Romains 16,14. Le texte a également été considéré comme étant formé par un matériau varié, qui aurait traversé plusieurs rédactions et aurait reçu sa forme actuelle vers le milieu du IIe siècle. L’écrit est clairement divisé en trois parties qui semblaient à certains indépendantes, au point de soulever l’hypothèse de plusieurs auteurs organisés par un rédacteur final. D’autres, au contraire, tendent à une unité globale, et c’est aujourd’hui la position dominante parmi les chercheurs. L’œuvre est structurée en 5 visions, 12 commandements et 10 paraboles. Les nombres, évidemment, ne sont pas accidentels et il y a des preuves de l’intention positive de l’auteur d’utiliser précisément ces chiffres fortement symboliques. Pour certains, c’est une apocalypse, pour d’autres, un livre d’allégories. Il a certainement été écrit à une époque de crise, et son appel à la conversion est parfaitement en phase avec ce que l’on attend en un tel moment, dans l’espoir d’un avenir meilleur.
La communauté où le Pasteur émerge est celle de Rome, et ce texte est très intéressant pour l’histoire et la compréhension du développement de la discipline pénitentielle. On en déduit qu’il s’agit d’une communauté qui avait perdu son ferveur initiale et, par conséquent, du point de vue moral, la détérioration était évidente. Face à cela, surgit une tentation rigoriste, selon laquelle le baptême était la dernière possibilité de recevoir le pardon des péchés, et il n’y avait aucune possibilité de pardonner ceux commis après le bain de régénération; et une position plus ouverte et compréhensive, qui tentait de trouver une chance supplémentaire pour ceux qui étaient tombés après le baptême. Cette tension était constante dans la communauté romaine et nord-africaine, comme le montrent les cas du Pape Calixte et de son adversaire rigoriste, l’auteur de Elenchos (autrefois attribué à Hippolyte de Rome, mais étant donné que des œuvres de différents auteurs lui ont été attribuées, il est aujourd’hui préférable de les désigner ainsi), à Rome entre les Ier et IIe siècles; ou les controverses sur les lapsi après les persécutions de Dèce et Valérien, dans la seconde moitié du IIIe siècle, où Cyprien de Carthage et le Pape Corneille représentaient la ligne de la miséricorde, ce dernier contre Novatien, probablement un représentant de la même ligne rigoriste, minoritaire mais puissante, présente à Rome depuis l’époque d’Hermas.
Le Pasteur tend à reconnaître une seule possibilité de pénitence après le baptême, tout en exhortant à une conversion sérieuse en vue de la fin imminente. De tous les textes des Pères Apostoliques, le Pasteur est peut-être celui qui est le plus éloigné de nous sur le plan du langage, en raison de la forêt d’images et d’allégories qu’il présente. Cependant, il n’est pas dépourvu d’aspects très intéressants, notamment à la lumière du récent magistère du Pape François. A. Quacquarelli écrivait il y a environ quarante ans : « C’est un enseignement continu qui concerne la simplicité, la sincérité, la chasteté, l’indissolubilité du mariage, la charité de pardonner le conjoint coupable, mais non récidiviste, les secondes noces après le veuvage » (1991, p.240).
La Didachè. Ce texte, fondamental pour l’histoire de la liturgie, de la discipline ecclésiastique, de la morale et de la doctrine chrétienne, a été découvert en 1863 à Constantinople, dans un codex de 1056. Les matériaux qui le composent datent probablement de la même période que les synoptiques, bien que le texte actuel soit certainement rédactionnel, mais pas au-delà du Ier siècle, et la zone de composition aurait été la Syrie. Qu’est-ce que la Didachè? Didachè signifie « doctrine » et dans le texte découvert à Constantinople, l’œuvre porte deux titres, peut-être ajoutés par un copiste : « Doctrine des douze apôtres » et « Doctrine du Seigneur aux nations par les douze apôtres ». C’est « une sorte de règle pour la communauté chrétienne » (LONGOBARDO, 2007, p.145). C’est « un genre catéchétique influencé par le style évangélique (…), un manuel, peut-être l’un des nombreux qui circulaient alors dans la communauté (…), une anthologie de préceptes avec des réflexions et des exhortations qui pourraient donner l’impression d’un ensemble de notes » (QUACQUARELLI, 1991, p.25). En raison de son ancienneté, elle est d’un intérêt extraordinaire pour l’histoire de la liturgie (en particulier pour la célébration de l’eucharistie) et pour l’étude de l’organisation de l’Église dans ses tout premiers temps. Dans la partie de l’instruction morale, on trouve la doctrine des deux voies, comme nous l’avons vu dans le Pseudobarnabé. Certains auteurs pensent que, puisque cette même doctrine se retrouve dans les écrits de Qumrân, la matrice commune de cette éthique pourrait se trouver dans la littérature sapientiale juive; d’autres notent que l’image des deux chemins est classique dans le monde ancien (cf. DELL’OSSO, 2011, p.16). Quoi qu’il en soit, le texte est extrêmement précieux, car il « plonge ses racines dans les couches les plus profondes des origines chrétiennes, là où la tradition sur Jésus est encore vivante et fluide, où le lien avec la spiritualité, l’éthique et la liturgie juives est encore vital, et où résonne encore l’écho direct de l’eucharistie proto-chrétienne et de l’annonce des prophètes chrétiens » (cf. DELL’OSSO, 2011, p.16).
Papias d’Hiérapolis. Dans les collections des Pères Apostoliques, comme nous l’avons mentionné, à partir de 1765, apparaissent également certains fragments de l’Exposition des dits du Seigneur, œuvre de Papias, évêque d’Hiérapolis (aujourd’hui ses vestiges se trouvent près de Pamukkale, en Turquie). Selon Irénée de Lyon, Papias aurait été disciple de l’apôtre Jean et compagnon de Polycarpe. Eusèbe de Césarée, cependant, le situe comme disciple d’un autre Jean, un presbytre différent de l’apôtre. Par conséquent, Papias appartiendrait à la génération qui a été instruite par ceux qui connaissaient les apôtres, mais pas par les apôtres eux-mêmes. La date de composition de son œuvre est considérée comme la première moitié du IIe siècle, peut-être entre les années 125-130 (cf. DELL’OSSO, 2011, p.159). Le témoignage de Papias est important pour ses références aux origines de l’évangile de Matthieu (qui aurait été écrit en hébreu) et de Marc (qui serait issu de la prédication de Pierre), mais aussi parce qu’il révèle l’importance de la tradition orale des enseignements de Jésus, qui étaient transmis par les « presbytres ».
À Diognète. Ce texte porte ce nom en raison du nom qui se trouvait dans le seul manuscrit qui le contenait, découvert à Constantinople en 1436 et malheureusement détruit à Strasbourg pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Heureusement, deux copies avaient été réalisées peu avant. Le texte n’est pas tant une lettre qu’une œuvre de genre apologétique, située approximativement à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle. C’est une présentation du christianisme à un personnage, probablement fictif, appelé Diognète. Le style est élevé et le grec est excellent, ce qui suggère que l’auteur était une personne cultivée et d’un milieu social élevé. Dans le texte, les chrétiens sont présentés comme des personnes qui vivent leur vie quotidienne comme les autres hommes et femmes de leur temps, se distinguant essentiellement par le fait d’être persécutés et méprisés, et de répondre à cela avec douceur, témoignant de l’amour pour tous, sans distinction. Avec une célèbre image (chap. 6), l’auteur établit un parallèle suggestif : les chrétiens sont pour le monde ce que l’âme est pour le corps. Ensuite, il décrit certains points de la vision théologique des chrétiens, terminant par une exhortation parénétique à la conversion. Ce texte a souvent été utilisé pour parler du laïcat chrétien et, surtout après Vatican II, indiqué comme un instrument d’inspiration pour la formation à la maturité du laïcat catholique.
Massimo Pampaloni S.J.
4 Références bibliographiques
Pour un travail scientifique :
Pour réaliser un travail scientifique sur les Pères Apostoliques, l’édition critique la plus utilisée actuellement est la dernière édition de FUNK, F. X.; BIHLMEYER, K.; WHITTAKER, M. Die Apostolischen Väter. Tübingen, 1992.
Pour les œuvres en particulier (à l’exception de Papias et de l’Homélie de Pseudo-Clément), il existe une édition critique dans la collection Sources Chrétiennes, qui peut être utilisée de manière utile. Pour la Didachè, SC 248, Paris, 1978; pour l’Épître aux Corinthiens de Clément, SC 167, Paris, 1971; pour les lettres d’Ignace d’Antioche, l’Épître aux Philippiens de Polycarpe et le Martyre de Polycarpe, SC 10, Paris, 1958; pour l’Épître de Pseudo-Barnabé, SC 172, Paris, 1971; pour le Pasteur d’Hermas, SC 53, Paris, 1958; pour À Diognète, SC 33, Paris, 1965.
Pour une présentation générale de chaque œuvre en particulier :
– Les Patrologies classiques :
ALTANER, B.; STUIBER, A. Patrologie. Vie, œuvres et doctrine des Pères de l’Église. São Paulo: Paulinas, 2010.
DROBNER, H. Manuel de Patrologie. Petrópolis: Vozes, 2008.
QUASTEN, J. Patrologie I: jusqu’au Concile de Nicée. v. I. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1978.
– Un dictionnaire utile :
BERARDINO, A. DI (org.). Dictionnaire patristique et d’antiquités chrétiennes. Petrópolis: Vozes, 2002.
Bibliographie citée dans le texte :
ALTANER, B. Patrologie. Gênes, 1968.
DELL’OSSO, C. (ed). I Padri Apostolici, Testi patristici 5. Rome: Città Nuova, 2011.
DROBNER, H. R. Patrologie. Casale Monferrato, 1998.
EHRMAN, B. D. (ed). The Apostolic Fathers. v I. Cambridge – London: Loeb Classical Library, 2003.
LONGOBARDO, L. Apostolica, littérature – Pères Apostoliques. In: BERARDINO, A. DI (ed). Littérature patristique. Cinisello Balsamo, 2007. p.140-8.
PROSTMEIER, F. R. Ignace d’Antioche. In: DOPP, S.; GEERLINGS, W. (eds). Dictionnaire de littérature chrétienne ancienne. Rome, 2006. p. 489-92.
QUACQUARELLI, A. (ed). I Padri Apostolici, Testi patristici 5. Rome, 1991.
QUASTEN, J. Patrologie I. Gênes-Milan, 1980. Réimpression : 2009.
VISOGNÀ, G. (ed). Didachè. Enseignement des Apôtres. Milan, 2000.
[1] L’auteur de la thèse sur la lettre comme correction fraternelle est E. CATTANEO, La Prima Clementis come un caso di correptio fraterna. In P. LUISIER. Studi su Clemente Romano. 2003, OCA (268), 83-105.