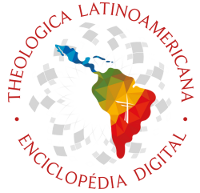Sommaire
Introduction
1 Qui sont les Pères Cappadociens ?
2 Pourquoi sont-ils si importants ?
3 Principales contributions théologiques
3.1 La fin de la controverse arienne
3.2 Contributions à la christologie
3.3 La contribution à la mystique
3.4 Exégèse
4 Hommes d’Église
5 Le monachisme
Conclusions
Références
Introduction
Le présent texte propose une initiation générale aux Pères Cappadociens. Il commence par une brève présentation biographique de chacun d’eux, puis indique pourquoi ils sont importants dans l’ensemble de l’Église et de la théologie chrétienne, tant en Orient qu’en Occident. Ensuite, les contributions théologiques de chacun sont présentées, tant dans la controverse qui a suivi la solution de Nicée au problème de l’arianisme, que dans l’élucidation des questions christologiques, la réflexion sur la mystique chrétienne et le développement de l’exégèse. Ensuite, la contribution des trois Cappadociens à l’organisation de l’Église est indiquée, et, enfin, au monachisme.
1 Qui sont les Pères Cappadociens ?
Le terme « Pères Cappadociens » désigne trois évêques du IVe siècle : Basile de Césarée (en Cappadoce) (†379), également connu sous le nom de Basile le Grand ; son ami Grégoire de Nazianze (†389), connu dans l’Orient chrétien sous le surnom de « le Théologien » ; et le frère de Basile, Grégoire de Nysse († après 394). Le terme « cappadocien » se réfère à la région d’où ils sont originaires, la Cappadoce, région orientale de la péninsule anatolienne, l’actuelle Turquie. L’habitude de les mentionner ensemble témoigne de la perception que l’Église a toujours eue de leur union et de leur unité d’action, tant dans le domaine théologique que dans celui de l’action politique ecclésiastique face aux dernières phases de la controverse arienne. Après la réforme conciliaire, la liturgie latine célèbre Basile et Grégoire de Nazianze en un seul jour, le 2 janvier, tandis que le nom de Grégoire de Nysse se trouve dans le Martyrologe romain le 10 janvier, où, d’ailleurs, il se trouvait également dans le Martyrologe avant la Réforme. C’est la même date que le calendrier byzantin. Il convient de noter que dans le calendrier byzantin (grégorien), Basile et Grégoire de Nazianze, en plus de leur fête spécifique (respectivement le 1er janvier et le 25 janvier), sont également célébrés lors de la fête des Trois Docteurs Saints, le 30 janvier, avec Jean Chrysostome. Le culte liturgique de Nysse apparaît plus tardivement par rapport à celui de son frère et de Nazianze : la mention la plus ancienne que nous connaissons se trouve dans la version géorgienne du Lectionnaire de Jérusalem (VIIe siècle), le 23 août. On ne peut probablement pas exclure comme cause certaines positions théologiques de Grégoire de Nysse, qui semblaient trop origenistes (bien que la véritable idée nyséenne concernant l’apocatastase soit discutée). De même, la condamnation d’Origène en 553 a probablement influencé la tardive apparition du culte liturgique de Nysse.
2 Pourquoi sont-ils si importants ?
L’importance de ces trois figures pour l’histoire de l’Église et de la théologie ne peut guère être sous-estimée. Ainsi écrit M. Simonetti :
Avec Basile, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nysse, la fusion entre un profond sentiment chrétien et la paideia grecque est complète et se réalise au plus haut niveau, tant de la spiritualité chrétienne que de la formation classique. De haute extraction sociale, éduqués de la manière la plus traditionnellement raffinée et complète et, en même temps, élevés dans des milieux profondément chrétiens, ils ont réalisé l’idéal d’un christianisme cultivé, qui a su accepter tout ce qu’il y avait de valable dans l’hellénisme, sans défigurer les lignes maîtresses du message chrétien, dans une synthèse qui devait rester paradigmatique pour la chrétienté orientale. (SIMONETTI, 1990, p. 89)
La famille de Basile et de Grégoire de Nysse est effectivement l’un des premiers exemples de familles chrétiennes depuis plusieurs générations, de grande richesse économique et culturelle et qui ont participé à l’histoire de l’évangélisation de leur propre région, témoignant personnellement lors des persécutions. Leur théologie est donc d’un intérêt particulier, entre autres, parce qu’il s’agit de l’un des premiers produits de personnes éduquées dans la paideia grecque la plus classique, mais, en même temps, formées dans un environnement chrétien de longue date. Basile et Grégoire de Nazianze ont étudié ensemble à Athènes, qui était encore la capitale de la culture à cette époque. Basile s’est ensuite installé à Constantinople, où, selon le témoignage de Nysse, il fut disciple du célèbre rhéteur Libanios. Basile nous a laissé une œuvre importante, connue sous divers noms, le plus courant étant Discours aux jeunes, dans laquelle il montre comment l’étude des classiques, faite cum grano salis bien sûr, non seulement n’est pas dangereuse pour la foi, mais devient même propédeutique pour l’étude ultérieure des Écritures et de la théologie. Grégoire de Nazianze est un littérateur fin et un rhéteur très capable, et ses œuvres, tant théologiques que littéraires, montrent sa culture et son goût littéraire classique raffiné.
Outre leur lien avec l’évangélisation de la Cappadoce, la famille de Basile et de Nysse est également une famille qui a donné à l’Église un nombre impressionnant de saints. La grand-mère de Basile, Macrine l’Ancienne, fut disciple de Grégoire le Thaumaturge (martyr, célébré le 2 mars) qui fut, à son tour, disciple d’Origène et est compté parmi les évangélisateurs de la Cappadoce. Dans le martyrologe romain avant la Réforme, Macrine l’Ancienne était mentionnée le 14 janvier (dans la réforme liturgique, son nom a été omis). Les parents de Basile sont également mentionnés dans le martyrologe (tant l’ancien que le réformé) le 30 mai. Outre la grand-mère et les parents de Basile et de Grégoire de Nysse, cette famille comprend encore deux saints : un autre frère de Basile et de Grégoire, Pierre, évêque de Sébaste (qui était célébré le 9 janvier, mais est aujourd’hui mentionné le 26 mars) et la sœur Macrine la Jeune (dont la mémoire liturgique, dans les deux calendriers, reste le 19 juillet). Macrine aura une influence très notable sur Grégoire de Nysse, qui la mentionnera avec des accents émouvants dans une lettre (Ep. 19) et à qui il dédiera une œuvre importante, le De Anima et resurrectione, défini par certains comme le Phédon chrétien, où le dialogue sur la mort et la résurrection se déroule entre Grégoire et sa sœur sur son lit de mort, jouant le rôle « socratique ». On ne peut manquer de noter combien la présence féminine a été importante dans la transmission et la vie personnelle de Basile et de Nysse (PAMPALONI, 2003 ; SUNBERG, 2017). Les persécutions subies par la famille ont, sans aucun doute, été l’une des sources qui ont donné à Basile cette énergie particulière avec laquelle il a su s’opposer à tout ce qui empêchait la liberté de l’Église. La famille d’origine de Grégoire de Nazianze se situait également à peu près dans les mêmes coordonnées. C’était une famille aristocratique et riche, son père (connu sous le nom de Grégoire l’Ancien), après sa conversion du paganisme, est devenu évêque de Nazianze et sa mère, appelée Nona, également mentionnée dans le martyrologe romain (5 août), a joué un rôle important tant dans la conversion de son mari que dans l’éducation de son fils, qui a dédié à sa mère un souvenir émouvant dans l’un de ses discours (Orat. 18).
Basile et les deux Grégoire représentent un cas pratiquement unique dans l’histoire de la théologie. Avant tout par l’amitié entre eux, surtout entre Basile et le Nazianze, bien que dans les dernières années l’amitié entre Grégoire et Basile ait probablement été soumise à une dure épreuve et ait peut-être, d’une certaine manière, connu un certain refroidissement. Deuxièmement, par la collaboration qu’ils ont su maintenir, bien que non sans difficultés, en raison des tempéraments différents des trois et d’une certaine « exubérance » dans le leadership de Basile par rapport à son frère et à son ami lors de la lutte contre l’empereur Valens. Mais ce fut surtout une union particulière dans l’effort commun dans le domaine de la théologie, où chacun a su faire fructifier ses propres capacités de manière synergique. La profondeur théologique et la vision générale des problèmes de l’Église de Basile, la sensibilité théologique et littéraire de Nazianze, associée à son habileté de rhéteur, les dons de spéculation philosophique et l’expérience mystique de Nysse ont imprimé une marque indélébile dans l’histoire du développement de la théologie. Vérifier la possibilité d’expliciter leur méthode de faire de la théologie « ensemble » serait un thème qui mériterait un approfondissement. Après la mort de Basile, qui, selon la plupart des chercheurs, est survenue en 379, l’ami et le frère ont recueilli son héritage. Les tumultueux événements qui impliquèrent Grégoire de Nazianze à Constantinople puis au concile que Théodose voulut tenir dans la capitale en 381, n’empêchèrent pas que ce concile et le rôle qu’y jouèrent les deux Grégoire représentent la victoire décisive de la théologie des trois Cappadociens sur le danger arien.
3 Principales contributions théologiques
3.1 La fin de la controverse arienne
La contribution théologique des Cappadociens se situe dans la phase finale de la controverse arienne et, sans aucun doute, a eu un impact décisif pour sa cessation. Le concile de Nicée, avec l’affirmation du terme homoousios, avait certainement coupé à la racine toute possibilité d’existence de la position d’Arius, mais, puisque le terme ousia n’était pas perçu comme clairement distinct de hypostasis, les évêques orientaux, qui avaient toujours soutenu une théologie trinitaire tripostatique (c’est-à-dire qui soulignait la distinction des trois hypostases divines), voyaient dans le terme homoousios le danger de nier une distinction réelle entre le Père et le Fils, puisque affirmer la même substance aurait pu être compris aussi comme affirmer la même hypostase. La crainte n’était pas infondée, car à Nicée, parmi les soutiens d’Athanase et du homoousios, se trouvait également Marcel d’Ancyre, dont la position monarchienne radicale était connue et pour laquelle il serait bientôt condamné. Marcel niait la distinction des hypostases dans la Trinité, car, pour lui, cela signifierait affirmer trois dieux distincts, et proposait une modalité purement économique de la distinction entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint, qui seraient, en fin de compte, une seule « personne ». L’acceptation des conclusions du concile par les évêques orientaux fut obtenue sous une indéniable pression de Constantin, qui souhaitait clore rapidement la question pour des raisons de nature politique et stratégique, après la récente défaite de Licinius (324) et être ainsi devenu l’unique empereur. Mais une convergence théologique ne fut en fait pas atteinte, et ce fait causera la tension interne qui éclatera immédiatement après, menant à une vingtaine d’années de tumultueux successions de synodes et de propositions de formules de foi, dès le synode important d’Antioche de 341 (pour ces formules, en KELLY, 1989).
La phase suivante, que nous pouvons faire débuter avec la mort de Constantin et la division de l’empire entre ses fils, vit l’empereur Constance imposer, pour la paix religieuse de l’empire – dont, après la mort de son frère Constant (350) et la défaite de l’usurpateur Magnence (353), il était devenu l’unique empereur -, une formule de foi qui pouvait satisfaire toutes les parties, mais qui en réalité était inacceptable tant pour les évêques orientaux que, naturellement, pour les plus fidèles à Athanase, car elle accueillait des expressions de sens arien clair. Les adeptes de la nouvelle formule sont appelés homéousiens, du terme homoiousios, « semblable » au Père, proposé pour dire ce qu’auraient prétendu Athanase et les autres nicéens, sans toutefois utiliser le terme contesté. Pour cette raison, le terme « semi-arien » pour cette position est aujourd’hui inacceptable. Constance réussit cependant, par la force et la coercition, à obtenir la signature de presque tous les évêques, tant d’Orient que d’Occident. Cela fut obtenu par la célébration simultanée de deux conciles distincts, l’un à Séleucie en Isaurie, l’autre à Rimini, dans lesquels l’empereur avait séparé les orientaux, plus divisés entre eux, des occidentaux, beaucoup plus unis dans la fidélité nicéenne. Mais l’acclamation comme empereur de Flavius Claudius Julien (connu sous le nom d’Apostat) par les légions stationnées en Gaule, en 360, et la mort de Constance l’année suivante, freinèrent la consolidation de la pax religieuse rêvée par lui. Après la mort de Julien dans la lutte contre les Sassanides, en 363, Valens accéda au trône de la partie orientale de l’empire. Étant sympathique aux ariens, le projet fut repris avec vigueur. Il fut cependant cette fois limité à l’Orient, car son frère Valentinien, empereur en Occident qui l’avait nommé pour gouverner la partie orientale de l’empire, était nicéen.
C’est le moment le plus important où les Cappadociens, surtout Basile, entrent en action. Il eut le mérite de comprendre que, contrairement à ce que pensait la courante homéousienne, à laquelle se reconnaissait l’empereur Constance, une solution politique à un problème théologique ne peut fonctionner (et la même chose se vérifiera également un siècle plus tard avec la réception du concile de Chalcédoine et l’échec de l’Henotikon). Alors, outre la politique ecclésiastique minutieuse de défense de l’Église face à l’hostilité de Valens, Basile élabora une solution qui serait définitive au problème de la distinction entre ousia et hypostasis, en se basant sur une distinction aristotélicienne entre « ousia première » et « ousia seconde », l’une indiquant la substance en général et l’autre la substance individuelle, ou l’hypostase (pour le chemin qui mena Basile à ce résultat, en SIMONETTI, 2006). Ainsi, la formule trinitaire une seule ousia et trois hypostases fut consacrée. L’autre contribution décisive, toujours découlant de la polémique avec les ariens, concernait la divinité de l’Esprit Saint, sujet qui devint central dans les discussions théologiques à partir de 370, et sur lequel Basile écrivit une œuvre célèbre (De Spiritu Sancto), d’un grand intérêt également parce que Basile y fait appel à la lex orandi comme source de la théologie.
Une des évolutions de la pensée arienne, bien au-delà des propres positions d’Arius, fut celle qui devint connue sous le nom d’anomea, pour laquelle la différence entre le Père et le Verbe était absolument radicale. Un des représentants théologiques les plus célèbres de cette tendance fut sans doute Eunomius, très actif dans la seconde phase de la controverse arienne. Son rationalisme théologique radical fut réfuté dans deux œuvres, l’une de Basile et l’autre de son frère Grégoire, peut-être la plus célèbre. Contre la théologie anomea sont également les célèbres cinq discours théologiques de Grégoire de Nazianze, prononcés en 380, à Constantinople.
3.2 Contributions à la christologie
La subdivision classique de la manuelle caractérise le IVe siècle comme le siècle des controverses trinitaires et le Ve siècle comme celui des controverses christologiques. En réalité, à notre avis, il n’est pas incorrect de considérer également la question arienne comme, en fin de compte, christologique, car elle s’interrogeait sur la nature divine du Verbe. Et la question de son incarnation, bien que pleinement thématisée au Ve siècle, n’était pas absente des siècles précédents. Sans revenir au IIIe siècle avec ce que l’on pourrait appeler, en jargon cinématographique, une bande-annonce des controverses du Ve siècle, c’est-à-dire la célèbre dispute impliquant, à Antioche, Paul de Samosate et le prêtre Malchion (NAVASCUÉS 2004), sans doute également la seconde moitié du IVe siècle a reconnu l’actualité pleine de la question, grâce à la figure d’Apollinaire de Laodicée, contre lequel se sont mobilisées les esprits théologiques les plus attentifs de l’époque, parmi lesquels les Cappadociens (BELLINI, 1978). Dans un premier temps, Basile considérait Apollinaire avec bienveillance, ne le connaissant pas personnellement, mais seulement de réputation, étant, entre autres choses, un fervent partisan d’Athanase et du concile de Nicée (LIENHARD, 2006). Il alla même jusqu’à le consulter sur certaines questions (la correspondance basilienne). Pendant son enseignement à Antioche, à la fin du IVe siècle, Apollinaire eut parmi ses élèves également Jérôme. Mais, lorsque sa christologie commença à être mieux connue, non seulement les Cappadociens s’en distancèrent immédiatement, mais une autre ligne de front théologique se forma en faveur des deux Grégoire (entre-temps, Basile était déjà décédé). Selon Apollinaire, dans l’incarnation, le Verbe aurait assumé la place (et, par conséquent, exercé les fonctions) du nous humain (dans le modèle tripartite classique, nous, psychē et sōma) ou de l’âme (dans le modèle bipartite anima/corpus), les deux modèles se retrouvant dans ses écrits ariens. Si de cette manière, dans l’intention d’Apollinaire, qui voulait ainsi réfuter les ariens et les sabelliens (MCCARTHY SPOERL, 1993 ; MCCARTHY SPOERL, 1994), la réalité de l’incarnation était clairement affirmée, le résultat qui en découlait était cependant inacceptable, car, si le nous, la partie qui chez l’homme spécifie l’humanité, n’était pas humain mais était le même Logos, il en résultait au moins deux conséquences absurdes : que le Christ n’aurait pas été pleinement humain et que, dans la pratique, on niait la transcendance divine, réduite à l’une des « fonctions » humaines. Grégoire de Nazianze souligna cela avec force, faisant sien le célèbre adage « ce qui n’a pas été assumé par le Verbe n’a pas été sauvé« . Grégoire de Nysse écrira également une œuvre entière contre Apollinaire. En polémique, enfin, très probablement avec des théologiens antiochiens (BEELEY, 2011), Grégoire de Nazianze utilisera une expression célèbre qui clarifie sa vision : en Christ, les deux natures ne sont pas allos/allos, mais allo/allo, utilisant une distinction permise par la langue grecque et qui, en pratique, signifie qu’en Christ il n’y a pas deux sujets, mais deux natures distinctes. Dans la réponse à Apollinaire, apparaît un aspect particulier de la christologie de Grégoire de Nysse, (également appelée « christologie de transformation » DALEY, 2002), qui est profondément liée au concept, particulièrement nyséen, d’epektasis et à une conception positive du changement (tropē) (DANIÉLOU, 1970).
3.3 La contribution à la mystique
Parmi les chercheurs modernes, Jean Daniélou fut l’un des premiers à percevoir l’importance de la dimension mystique de Grégoire de Nysse. Par bien des aspects, Grégoire fut considéré, d’ailleurs, comme le « père » de la mystique chrétienne, surtout à partir de la Vie de Moïse et de ses Homélies sur le Cantique des Cantiques, qui reprennent l’héritage origenien avec des spécificités propres, comme précisément l’idée de progrès infini (PAMPALONI, 2010) et ce qui a été appelé la mystique des ténèbres (PONTE, 2013). La pensée de Grégoire a influencé les mystiques tant de l’Orient que de l’Occident. En Orient, au-delà du domaine de langue grecque, il faut mentionner la figure du mystique syriaque Jean de Dalyatha (PUGLIESE, 2020), tandis qu’en Occident, il faut certainement citer le nom de Guillaume de Saint-Thierry et son influence sur la mystique cistercienne du XIIe siècle.
3.4 Exégèse
On ne peut manquer d’évoquer l’exégèse de ces Pères. De Basile, nous avons le premier Hexaemeron connu, qui représentera un genre littéraire de grand succès, surtout au Moyen Âge. L’exégèse de Nazianze et de Nysse est généralement très influencée par Origène, mais sans se prêter aux accusations d’allégorisme radical. Un magnifique exemple de réponse aux accusations d’allégorisme est donné exactement par Grégoire de Nysse, qui, pour répondre aux critiques de nier un véritable contenu cognitif à l’exégèse allégorique, écrivit sa Vie de Moïse en deux parties. Dans la première, il présente la vie de Moïse par une exégèse littérale et, dans la seconde, il le fait par une exégèse spirituelle, c’est-à-dire allégorique, montrant ainsi qu’une exégèse n’exclut pas l’autre.
4 Hommes d’Église
De ce que nous avons dit à propos de la description du cadre dans lequel s’est développée la contribution théologique des Cappadociens, émerge la dimension de Basile en tant qu’homme d’action, capable et décisif dans la lutte en faveur de la liberté de l’Église, face aux manœuvres de l’empereur Valens. Dans cette lutte, agissent également les deux Grégoire en tant que protagonistes – pourrions-nous dire – malgré eux. Lorsque Valens divisa la Cappadoce en deux provinces (Cappadoce I, avec la capitale à Césarée, et Cappadoce II, avec la capitale à Tiana) – selon certains chercheurs pour redimensionner le pouvoir de Basile, alors évêque de Césarée et métropolite de Cappadoce ; selon d’autres simplement pour des raisons fiscales – Basile réagit promptement et résolument. Pour neutraliser ce plan et l’ambition de l’évêque (arien) Anthime de Tiana, qui aurait voulu récupérer les droits de métropolite de Cappadoce II, Basile défendit la thèse selon laquelle il ne devait pas y avoir de coïncidence entre les circonscriptions ecclésiastiques et les circonscriptions civiles. Un concile tenu en 372 décida en ce sens (DI BERARDINO, 2006) et Basile en profita pour créer de nouveaux diocèses en Cappadoce II, nommant des évêques amis, parmi lesquels son ami Grégoire, dans la petite localité de Sasima. Grégoire refusa de s’y rendre, provoquant une réaction assez sévère de son ami, ce qui semble avoir tendu la relation entre eux. Tant que ses parents vécurent, Grégoire resta à Nazianze, pour ensuite se consacrer, de 374 jusqu’à la mort de Basile, à une vie retirée, comme il avait toujours voulu le faire. Basile, avec la même méthode, nomma également son frère Grégoire à l’évêché de Nysse, mais les capacités administratives de Nysse n’étaient pas comparables à ses capacités philosophiques, et il fut rapidement contesté et finalement déposé par un concile arien, en 376. Certaines de ses décisions furent également fortement critiquées par Basile, qui n’épargna pas son frère de critiques dans certaines de ses lettres à d’autres évêques. Le choix d’Amphilochios, cousin de Nazianze, pour l’évêché d’Iconium, fut plus judicieux, et la relation avec lui resta toujours de grande amitié, cordialité et respect, contrairement à la relation avec son frère et son ami Grégoire, et à Amphilochios il dédiera le traité déjà cité sur l’Esprit Saint.
Un autre domaine dans lequel Basile s’est engagé avec passion fut le soutien à Mélèce, dans les événements qui suivirent le schisme d’Antioche. Il chercha de toutes les manières, comme le montre sa correspondance avec le pape Damase, à convaincre l’Occident de la nécessité d’unir les efforts pour vaincre Valens, et que, pour cela, il fallait le soutien des « occidentaux » (y compris d’Athanase). Une partie de cet effort consistait à convaincre les nicéens radicaux, par son intense activité épistolaire et ses contacts, que les positions homéousiennes de Mélèce, et les siennes propres, étaient parfaitement orthodoxes avec la foi de Nicée.
À la mort de Basile en 379, les deux Grégoire acquirent leur propre lumière. Avec la défaite tragique d’Andrinople contre les Goths et la mort de Valens au combat, l’empereur Gratien nomma pour l’Orient l’un de ses généraux, Théodose, de foi nicéenne avérée. Le climat politique et religieux changea alors profondément et Grégoire de Nazianze, grâce à la position éminente de la sœur d’Amphilochios d’Iconium, Théodosie, fut appelé en 379 à Constantinople pour raviver la maigre minorité orthodoxe. Il accepta de quitter son cher retrait en Isaurie et se lança à nouveau dans la mission. À Constantinople, aucune église n’était accordée aux non-ariens, et Théodosie mit à disposition une partie de son palais pour une chapelle, qui prendra le nom d’Anástasis, chapelle de la Résurrection, sur laquelle Grégoire écrira quelques vers émouvants. Sa mission ne fut pas facile et, dans la nuit de Pâques 379, il y eut même une incursion des ariens dans la chapelle, décidés à empêcher que s’y célèbrent les baptêmes et que soit prononcé le symbole non arien. Les événements à Constantinople se compliquèrent. Le siège étant vacant et considérant que Grégoire n’ayant jamais pris possession de Sasima, il était un évêque « libre », il fut choisi pour la succession au prestigieux siège de la ville impériale. Un usurpateur nommé Maxime, avec le soutien de Pierre, évêque d’Alexandrie, contesta son élection, réussissant à rallier à sa cause même Ambroise de Milan et le pape Damase, provoquant ainsi une grande amertume chez Grégoire. En prenant possession de Constantinople, Théodose expulsa les ariens de la ville. Le concile s’ouvrit alors en 381. Avec la mort inattendue de Mélèce d’Antioche, qui présidait le concile, la présidence fut offerte à Grégoire, mais il dut subir les attaques des évêques égyptiens, de Maxime et des délégués romains, qui l’accusèrent de ne pouvoir être évêque de Constantinople car déjà titulaire de Sasima. Grégoire, en pleine consonance avec son caractère assez sensible, ne choisit pas le chemin de la résistance, mais abandonna tout et s’en alla, et à sa place fut consacré Nectaire. Cet épilogue triste laissera des traces indélébiles chez Grégoire, comme on peut le voir dans bon nombre de ses écrits ultérieurs. Les dernières années le verront enfin évêque de Nazianze, bien que réticent, engagé dans les études, la polémique anti-apollinariste et la prédication. Il mourut en 390.
Le Nysse, après la mort de Basile, commença une activité féconde de composition d’œuvres, qui ne s’arrêtera qu’avec sa mort, survenue après 394. Il participa également au concile de Constantinople et, après le retrait de son ami, devint le représentant le plus autorisé de l’orthodoxie nicéenne, étant envoyé à certaines missions qui témoignent de la grande autorité, intellectuelle et ecclésiale, qu’il avait atteinte à ce moment-là, bien que toutes ces missions n’aient pas été conclues de manière positive.
5 Le monachisme
Les trois Cappadociens ont également laissé une marque importante pour le développement du monachisme, en particulier Basile et son expérience avant l’ordination épiscopale. Cette expérience, bien qu’elle ne corresponde pas aux canons du monachisme tel que nous le comprenons aujourd’hui, a laissé, cependant, des traces indélébiles, surtout dans le monachisme oriental. En revenant des études à l’étranger, en 355, il s’orienta vers une vie chrétienne plus consciente, grâce à l’influence de sa sœur Macrine, qui avait toujours manifesté une grande inclination pour la vie ascétique. L’influence de la sœur nous est relatée par Nysse : certains chercheurs modernes suggèrent l’influence d’un ascète célèbre à cette époque, Eustathe de Sébaste, figure de toute façon importante pour Basile pendant longtemps, comme nous le détectons par sa correspondance. Il entreprit divers voyages dans des régions connues pour la présence de figures vivant une certaine vie que nous appellerions aujourd’hui monastique, bien que dépourvue encore des structures que nous associons actuellement au terme. Vers la fin de 357, il reçut le baptême (même avec une formation chrétienne profonde, le baptême à cette époque se recevait encore souvent à l’âge adulte, comme nous le voyons dans le cas plus connu d’Augustin) et se retira dans la solitude dans une propriété familiale à Annesi. De là, il envoya de nombreuses lettres à Grégoire pour qu’il le rejoigne dans cette vie. Pendant un certain temps, l’ami le rejoignit à Annesi. Cette expérience de recherche de la solitude pour être en paix, étudier et méditer fut vécue dans le cadre du cercle familial, dans ses propriétés (certains ont suggéré un parallèle avec le retrait de Cassiciacum, d’Augustin avant son baptême). Plus tard, ayant également passé un certain temps avec Eustathe de Sébaste, bien que son ascétisme fût trop radical pour Basile, celui-ci développera au fil du temps une forme de vie commune originale par rapport au modèle anachorétique, dont l’origine se relie à Antoine du désert, et au cénobitique, selon le modèle de Pacôme. Alors qu’il était encore prêtre, il créa une véritable et singulière petite ville pour accueillir les pèlerins, les étrangers et les malades, connue sous le nom de Basiliade. Ses enseignements ascétiques sont évidents, surtout dans ses Règles (tant la collection dite « brève » que la « longue »). Bien que Basile pensât à ce mode de vie pour tous les chrétiens, ses Règles et ses écrits constitueront la base, encore aujourd’hui solide, du monachisme oriental, qui, à l’exception de celui d’origine studite, peut à juste titre être appelé « basilien ».
Conclusion
À partir de ces quelques mentions, il est possible de comprendre que l’étude des Pères Cappadociens nous transporte au cœur du IVe siècle, avec ses difficultés et ses splendeurs. Ce n’est pas par hasard que le IVe siècle est appelé le « siècle d’or » de la patristique. C’est le temps de la formation de la liturgie (l’Église orientale connaît plusieurs anaphores attribuées à Basile), du développement de la conscience du langage dogmatique, des premiers conciles œcuméniques. Dans toute cette période extrêmement féconde sont présents les Cappadociens. S’occuper d’eux, donc, d’une part, nécessite un effort de grande envergure car il faut entrer dans la philosophie, l’histoire, la théologie, la rhétorique classique et bien d’autres domaines, d’autre part, représente une magnifique porte pour connaître l’une des périodes les plus fascinantes de l’Antiquité Tardive, quand le parfum du monde classique ne s’était pas encore entièrement dissipé, et l’action culturelle de l’Église, dans son effort simultané d’inculturation et de fécondation, était dans l’un de ses moments de plus grand éclat. Les études sur Basile et sur Nazianze restent toujours vives, mais il faut reconnaître que des trois, celui qui jouit de l’intérêt continu le plus soutenu de la part des chercheurs, et pas seulement limité au cercle des spécialistes de l’Antiquité, est Grégoire de Nysse, grâce aussi au fait que nous disposons de presque la totalité des œuvres en édition critique, Gregorii Nysseni Opera (GNO), une entreprise monumentale initiée par W. Jaeger. Un autre signe d’intérêt est que nous disposons d’un dictionnaire dédié à Grégoire de Nysse, ce qui facilite grandement la recherche de thèmes spécifiques dans l’œuvre de Nysse. Enfin, contribue beaucoup à ce « succès » actuel de Grégoire, également de la part d’auteurs non directement intéressés par l’aspect théologique de ses écrits, le côté philosophique et mystique, qui semble répondre à une recherche/un intérêt toujours actuel dans la conjoncture historique présente.
Massimo Pampaloni SJ (professeur invité de la FAJE). Texte original italien. Envoyé : 30/09/2022 ; Approuvé : 30/11/2022 ; Publié : 30/12/2022. Traduction : Francisco Taborda SJ
Références
Principales traductions en portugais
BASILE DE CÉSARÉE. Homélie sur Luc 12 ; Homélies sur l’origine de l’homme ; Traité sur l’Esprit Saint. 2e éd. São Paulo : Paulus, 2005.
GRÉGOIRE DE NYSSE. La création de l’homme ; L’âme et la résurrection ; La grande catéchèse. São Paulo : Paulus, 2011.
GRÉGOIRE DE NYSSE. Vie de Moïse. Campinas (SP) : CEDET, 2018. (Remarque : cette édition utilise une traduction qui existe depuis longtemps sur Internet. Il n’y a pas d’indication sur le traducteur et si la traduction a été faite du grec ou d’une autre langue).
GRÉGOIRE DE NAZIANZE. Discours théologiques. Petrópolis : Vozes, 1984.
Suggestions de lecture
BEELEY, C. A. The Early Christological Controversy: Apollinarius, Diodore, and Gregory of Nazianzen. Vigiliae Christianae, v. 65, p. 376-407, 2011.
BELLINI, E. (Ed.). Su Cristo. Il grande dibattito nel Quarto secolo. Milano : Jaca Book, 1978.
CADERNOS PATRÍSTICOS, v. 5 n. 9 (2013). (Numéro monographique sur les Cappadociens)
DALEY, B. « Heavenly Man » and « Eternal Christ »: Apollinarius and Gregory of Nyssa on the Personal Identity of the Savior. The Journal of Early Christian Studies, v. 10, p. 469-488, 2002.
DANIÉLOU, J. L’être et le temps chez Grégoire de Nysse. Lieden : Brill, 1970.
DI BERARDINO, A. Cappadocia-II. Concilio. In : Nuovo Dizionario di Patristica e di Antichità cristiane. Roma : Marietti 1820, 2006.
GREGORII NYSSENI OPERA (GNO). Édition en ligne. Disponible sur : https://scholarlyeditions.brill.com/gnoo/ Accès : 12 sept. 2022.
KELLY, J. N. D. Early christian doctrines. 5e éd. London : A&C Black, 1989.
LIENHARD, J. T. Two Friends of Athanasius: Marcellus of Ancyra and Apollinaris of Laodicea. Zeitschrift für antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity, v. 10, n. 1, 2006.
MATEO-SECO, L.-F. ; MASPERO, G. Gregorio di Nissa, Dizionario. Roma : Città Nuova, 2007.
MCCARTHY SPOERL, K. Apollinarius and the Response to Early Arian Christology. Studia Patristica, v. 26, p. 421-427, 1993.
MCCARTHY SPOERL, K. Apollinarian Christology and the Anti-Marcellian Tradition. Journal of Theological Studies, v. 45, p. 545-568, 1994.
MORESCHINI, C. Basílio Magno. São Paulo : Loyola, 2010.
MORESCHINI, C. I Padri Cappadoci. Storia, letteratura, teologia. Roma : Città Nuova, [s.d.].
MORESCHINI, C. Gregório Nazianzeno. São Paulo : Loyola, 2010.
NAVASCUÉS BENLLOCH, P. Pablo de Samosata y sus adversarios: estudio histórico-teológico del cristianismo antioqueno en el s. III. Roma : Institutum patristicum Augustinianum, 2004.
PAMPALONI, M. La parole comme médecin de l’âme. Deux lettres du genre « consolatio » de Basile de Césarée. Perspectiva Teológica, v. 35, p. 301-323, 2003.
PAMPALONI, M. L’immersion infinie : pour une introduction à Grégoire de Nysse. Cadernos Patrísticos, v. 5, n. 9, p. 69-88, 2010.
PIERANTONI, C. Apolinar de Laodicea y sus adversarios: aspectos de la controversia cristológica en el siglo IV. Santiago : Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2009.
PONTE, M. N. Q. La mystique des ténèbres de Grégoire de Nysse dans l’œuvre « Vie de Moïse ». Pensar-Revista Eletrônica da FAJE, v. 4, n. 1, p. 5-24, 2013.
PUGLIESE, P. R. L’infini jardin intérieur. La mystique de Jean de Dalyatha et de Grégoire de Nysse. Roma : Pontificio Istituto Orientale – Valore italiano Lilamé, 2020.
SIMONETTI, M. Genèse et développement de la doctrine trinitaire de Basile de Césarée. In: STUDI DI CRISTOLOGIA POST-NICENA. Studia Ephemeridis Augustinianum. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2006. p. 235-258.
SUNBERG, C. D. Les Mères Cappadociennes. La déification exemplifiée dans les écrits de Basile, Grégoire et Grégoire. Eugene: Pickwick Publications, 2017.