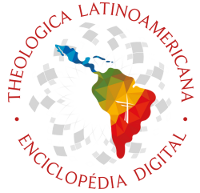Summary
1 Terminology
2 History
3 Controversies Surrounding the Missal of Saint Pius V
4 From Controversies to Separation
5 In Search of Reconciliation and Liturgical Peace: Benedict XVI and Summorum Pontificum
6 Remaining Challenges
7 Bibliographical References
1 Terminology
The terms “Missal of Saint Pius V,” “Tridentine Missal,” “Traditional Missal,” “Missal of all time,” “Gregorian Missal,” “Classic Roman Missal,” and also the missal of the forma antiquior (older form), of the usus antiquior (older use), or of the vetus ordo (old ordo) form the lexical field surrounding that form of Eucharistic celebration that Benedict XVI designated as “Mass according to the extraordinary form of the Roman rite.” With this classification, Benedict XVI clarified that the Roman Missal, promulgated by Paul VI in 1969, is the ordinary expression of the lex orandi of the Catholic Church of the Latin rite. However, since 2007 and by virtue of the Motu Proprio Summorum Pontificum, broader possibilities for celebration according to the usus antiquior have been opened, consolidated in the typical edition of the Roman Missal of 1962, under the pontificate of John XXIII. It is not a matter of two distinct rites, but of two different forms of the same rite. Because of its wide use and its historical importance, we will retain in this entry the designation “Missal of Saint Pius V.” This designation is also used by the General Instruction of the Roman Missal (GIRM n.8).
2 History
It was from the 10th century that the term “missal” and its correlates (liber missalis, missale plenum, missale plenarium) became frequent to indicate the liturgical books endowed with all the euchological and scriptural texts necessary for the celebration of the Mass. The term missal arose for practical reasons that produced the fusion of the various texts prescribed for masses into a single portable volume. Previously, such texts were separate, part of them in the sacramentaries, which also contained the Eucharistic prayers and the rite of communion, and the other parts in the lectionaries, psalters, and antiphonaries.
The growing disuse and neglect of Eucharistic concelebration, the phenomenon of the multiplication of “private masses” for devotional reasons, especially for the suffrage of the deceased, led to the edition of booklets with series of masses (libelli missarum) with numerous daily masses for the dead and other votive masses. The practicality of these booklets, as they dispensed with the handling of bulky sacramentaries and ancient lectionaries, was well-received by the religious and secular clergy. Thus, by the 13th century, the transition that established the preference for the missal as the liturgical book of the altar was complete.
It fell mainly to the Franciscans, in their missionary activities and expansion of conventual foundations, to spread throughout Europe what became the most widespread missal until then. This is the Missale secundum consuetudinem curiae, that is, the missal of the Papal Chapel which, in turn, faithfully reproduced the missal in force during the pontificate of Innocent III (1198-1216). With the advent of printing, this missal received its first printed edition in 1474 and was later the fundamental reference for the elaboration of the Missal of Saint Pius V in 1570.
The 16th century was profoundly agitated by the events resulting from the Protestant Reformation, initiated by Luther in 1517. The wave of theological challenges also reached the liturgical praxis of the Roman Church. On the other hand, a consistent movement of theological and pastoral renewal already existed within the Roman sphere itself. Such renewal required doctrinal clarifications, spiritual deepening, and disciplinary norms in relation to the sacraments, especially the Eucharist. It is in this context that the Council of Trent (1545-1563) took place and the consequent edition of revised liturgical books. It is from this environment that the Roman Missal of Saint Pius V emerges.
With regard to the Eucharist, although with varied nuances, the nascent Protestantism questioned the traditional understanding of the presence of Christ in the Eucharistic sacrament and rejected the understanding of the Mass as an updating of the sacrifice of Calvary, offered in an unbloody and mystical way on the altar through the ministry of priests. The Council of Trent defended and reaffirmed the Catholic doctrine on the Mass, emphasizing the real presence of Christ under the Eucharistic species and the sacrificial character of the Mass (DH 1738-1743, 1751-1754). A series of abuses to be avoided in the Mass was also cataloged, and the correct way of its celebration was indicated (BOROBIO, 1993, p.232-240).
Since the medieval period, the numerous liturgical abuses constituted a painful open wound in the life of the Church. The Tridentine council strove to curb irreverence and carelessness as well as to punish the sacrilege, superstition, and avarice that often distorted liturgical acts (JUNGMANN, 2010, p.145-149). It fell to Pope Pius IV (1499-1565) to officially receive the heavy task of a major revision of liturgical praxis, but it was his immediate successor, Pope Pius V (1504-1572), who effectively carried it out.
The main purpose of the Tridentine liturgical revision was the safeguarding of doctrinal orthodoxy and the elimination of abuses. The revision and edition of the reformed liturgical books was the chosen path. In seeking to achieve this, the goal was to restore the liturgical rites in accordance with the ancient norm of the Holy Fathers. The limits of research, in those truly difficult times, led St. Pius V to opt for preserving those historical forms of the liturgical tradition to which the scholars of that time had access. Faced with this liturgical tradition impugned by the reformers, it was also decided to introduce the minimum of modifications to the sacred rites. Therefore, “the missal of 1570 differs little from the first printed missal of 1474 which, in turn, faithfully reproduces that of the time of Pope Innocent III” (GIRM n.7). The limitation imposed on the Tridentine liturgists also referred to the sources researched: “in addition, the manuscripts of the Vatican Library, although suggesting some corrections, did not allow one to go beyond the medieval liturgical commentaries in the investigation of the ancient and proven authors” (GIRM n.7). The culmination of this process occurred in 1570 with the bull Quo primum tempore, in which Pius V promulgated the revised missal, later associated with his name.
The understanding of the “norm of the Holy Fathers,” that is, the liturgical praxis of the Church Fathers, was the inspiring guideline for the revision that generated the Missal of Saint Pius V. The understanding of the liturgy of the ancient Church was greatly expanded and enriched with the subsequent advancement of liturgical research. The numerous critical editions of the venerable sacramentaries of the patristic period, as well as the rediscovery of the Hispanic and Gallican liturgical books, rescued from oblivion euchologies of great spiritual value until then ignored. Likewise, the traditions of the first centuries, prior to the formation of the rites of the East and West, are now better known, after the discovery of numerous liturgical documents. In addition, the progress of patristic studies shed on Eucharistic theology the light of the doctrine of the most eminent Fathers of Christian antiquity (GIRM n.8).
Thus, “the norm of the Holy Fathers” does not only require that we preserve what our most recent ancestors have bequeathed to us. These “recent ancestors,” as Paul VI understood, are the promoters of the great Tridentine liturgical revision. It is also imperative that “one assume and judge of the highest value the entire past of the Church and all the manifestations of faith, in forms as varied as the Semitic, Greek, and Latin human and civil cultures” (GIRM n.9), which implies a comprehensive understanding of what the Tradition of the Church really is and its relationship with the natural processes of revision and reform of its liturgical rites: “this broader vision allows us to perceive how the Holy Spirit grants the People of God an admirable fidelity in the conservation of the immutable deposit of faith, despite the enormous variety of prayers and rites” (GIRM n.9).
3 Controversies Surrounding the Missal of Saint Pius V
The promulgation of the Roman Missal of Paul VI in 1969 became the starting point of a controversy that extends to our days. A controversy that opposes not only the Missal of Paul VI to the Missal of Pius V, but also unfolds into the unusual affirmation of an antagonism between the Second Vatican Council (1962-1965) and the rest of the Church’s Tradition. The starting point of this controversy was the Short Critical Study of the Novus Ordo Missae, prepared by Cardinals Alfredo Ottaviani and Antonio Bacci in that same year of 1969. The statements contained in this critical study were of the utmost gravity and cast a tremendous suspicion of heresy on the Missal of Paul VI. In it, we find the shocking accusation that the new missal departs in an impressive way, both as a whole and in particular, from the Catholic theology of the holy Mass. The condition of the main signatory of the critical study weighs even more: Cardinal Alfredo Ottaviani, pro-prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith until 1968. The controversial critical study expressed the opinion of a group of theologians linked to the French archbishop Marcel Lefèbvre (1905-1991), marked by the radical rejection of both the Roman Missal of Paul VI and the Second Vatican Council. Cardinals Ottaviani and Bacci sponsored the text, adopting it as their own. The so-called “Ottaviani Intervention” is, even today, the privileged source of arguments against the Novus Ordo Missae.
Let us briefly analyze some objections presented by those who use the Missal of Saint Pius V to reject the Missal of Paul VI. The first of these refers to the perpetuity of the bull Quo primum tempore of Saint Pius V. In this document, it seems that the said pope fixes an immutable form for the Ordo Missae (the form of celebrating the Mass) and in this immutability, he commits his full pontifical authority, prohibiting any subsequent modifications to the rites and ceremonies codified by the missal of 1570. In practice, traditionalists usually affirm a supposed intangibility of the Missal of Pius V, canonized by Quo primum tempore. However, a narrow interpretation of this perpetuity is not sustainable. In an official response, dated June 11, 1999, the Congregation for Divine Worship clarified that no pope can perpetually fix a rite. Furthermore, the Council of Trent itself, when reflecting on the administration of the sacraments, stated that the Church can perfect liturgical celebrations by modifying and establishing new elements, as long as the specific identity of the sacraments is not altered. It can do this taking into account the utility of those who receive the sacraments according to the variety of things, times, and places (DH 1728). From a canonical point of view, when a pope writes perpetuo concedimus, it should always be understood as “until otherwise ordained.” It is proper to the sovereign authority of the Roman Pontiff not to be limited by merely ecclesiastical laws, much less by the dispositions of his predecessors. A pope is limited, evidently, by the immutability of divine and natural laws, in addition to the very constitution of the Church (cf. RIFAN, 2007, p.45-46).
This was the understanding held by the various successors of Pope Pius V when they modified or introduced elements into the missal promulgated by him in 1570. They did this without contradicting the bull Quo primum tempore. Thus, by way of example, in 1604, Clement VIII abolished a prayer prescribed for the priest upon entering the church, the word omnibus in the two prayers after the Confiteor, and the eventual mention of an emperor’s name in the Roman Canon. Leo XIII added, at the end of the Mass, the Leonine prayers, and other additions were made by Pius X in 1904, and Pius XI in 1929. However, it was Pius XII who, in 1951 and 1955, undertook the greatest liturgical modification prior to Vatican II with a notable reform of the Holy Week celebrations. Finally, John XXIII, already at the dawn of the Council, inserted, in 1960, the name of Saint Joseph into the Roman Canon.
Une autre objection fréquente qui oppose indûment le Missel de Pie V au Missel de Paul VI est la « question de l’offertoire ». Dans le Missel de Pie V, la préparation et la présentation des oblats sont accompagnées de longues prières qui soulignent clairement le caractère sacrificiel de la messe. Le Missel de Paul VI a opté pour des prières plus brèves où l’on bénit Dieu pour les dons du pain et du vin qui deviendront le corps et le sang du Seigneur. L’objection traditionaliste affirme que le changement de l’offertoire a détruit le caractère sacrificiel de la messe qui, de ce fait, a cessé d’être catholique et est donc devenue illicite voire invalide. Une telle objection, entachée de préjugés, est réfutée par la constatation que la mention principale du sacrifice a sa place propre non pas à l’offertoire, mais dans l’anamnèse du Canon lui-même. Ce que l’on appelle l’« offertoire » était à l’origine une simple préparation des oblats sur l’autel. Jusqu’au Xe siècle, le geste accompli en silence a prédominé. Aux siècles suivants, des prières furent élaborées, qui furent ensuite incluses dans le Missel de Pie V (BOROBIO, 1996, p.335-338). Après le Concile Vatican II, plusieurs liturgistes ont préconisé la suppression des paroles de ce rite, en reprenant la simple élévation en silence, mais Paul VI a insisté sur la récupération de formules brèves et enracinées dans les sources les plus anciennes de la liturgie chrétienne, qui révèlent la vraie nature de ce moment : la présentation des oblats sur l’autel (TABORDA, 2009, p.142-144).
La soi-disant « question du mystère pascal » est probablement l’objection traditionaliste la plus forte soulevée contre le Missel de Paul VI. Ils affirment que le nouveau missel est hétérodoxe, car sa théologie met l’accent sur la célébration du mystère pascal du Christ. En revanche, le Missel de Pie V est orthodoxe car il conserve et exprime pleinement la théologie du sacrifice expiatoire du Christ, perpétué de manière non sanglante sur les autels. Le cardinal Ratzinger de l’époque a qualifié d’étrange et déplacée l’opposition lancée entre les catégories « mystère pascal » et « sacrifice » (RIFAN, 2007, p.53-54). Cette opposition anormale est l’argument central, défendu par la Fraternité Saint-Pie X, selon lequel il existe une véritable rupture dogmatique entre la liturgie renouvelée à partir du Concile Vatican II et la liturgie antérieure (FSSPX a, p.55-68). En d’autres termes, l’accusation d’hétérodoxie lancée contre le Missel de Paul VI se fonde sur le jugement que tout s’interprète désormais à partir du mystère pascal, qui a usurpé la place du sacrifice expiatoire du Christ. Une telle accusation n’est pas soutenable et le malentendu est évident. La catégorie de mystère pascal ne remplace, n’abolit ni ne relativise l’importance et la réalité du sacrifice du Christ. La Pâque du Christ est le mystère salvifique dans toute son ampleur et c’est là que son sacrifice se situe véritablement.
Le terme de mystère pascal conduit clairement aux réalités qui se sont déroulées entre le Jeudi saint et le matin de Pâques : la cène comme anticipation de la croix, le drame du Golgotha et la résurrection du Seigneur. La catégorie de mystère pascal comprend ces événements comme un événement unitaire qui manifeste toute l’œuvre du Christ. Œuvre salvifique qui a une place historique éminente, mais qui la transcende simultanément. Puisque cet événement unique et transcendant est le culte le plus parfait rendu à Dieu, il peut devenir culte divin et être présent à tous les instants de l’histoire car il a été assumé par Dieu lui-même dans son mystère de salut. La théologie pascale du Nouveau Testament le laisse entendre : l’épisode apparemment profane de la crucifixion du Christ est un sacrifice d’expiation, un acte réconciliateur accompli par le Dieu fait homme. La théologie de la Pâque est une théologie de la rédemption, une liturgie du sacrifice expiatoire situé au centre du mystère pascal (RIFAN, 2007, p.54). Il est ainsi démontré que l’opposition entre le sacrifice et le mystère pascal est artificielle et inconsistante.
4 Des controverses à la séparation
La polémique autour du Missel de Pie V a connu un crescendo de tensions et de ruptures, surtout autour de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), fondée par l’archevêque français Marcel Lefèbvre. Cette fraternité fut approuvée en 1970 par l’évêque de Lausanne (Suisse) et reçut une lettre laudative de la Congrégation pour le Clergé en 1971. La position extrêmement critique à l’égard du Concile Vatican II et le rejet du nouveau rite de la messe, qualifié péjorativement de « messe nouvelle », ont occasionné un éloignement progressif de Lefèbvre et de ses partisans par rapport à Rome.
Ses déclarations programmatiques sont incisives. La FSSPX adhère « de tout cœur, de toute son âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette Foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité ». Mais elle refuse, « au contraire, et toujours [refusera] de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s’est manifestée clairement pendant le Concile Vatican II et, après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont issues » (FSSPX a). Un tel éloignement a culminé avec la suspension a divinis de Monseigneur Marcel Lefèbvre en 1976, pour avoir insisté à former et à ordonner des prêtres dans cette perspective de rejet de Vatican II. Par la suite, en 1988, la situation s’est aggravée avec son excommunication latae sententiae en raison de l’ordination de quatre évêques sans le mandat pontifical nécessaire, un événement connu sous le nom de « schisme traditionaliste ».
La Messe de saint Pie V est devenue, depuis lors, un véritable étendard de lutte. Sa conservation, sa défense et son expansion sont devenues non seulement la raison d’être de la FSSPX, mais un véritable principe opératoire par rapport à l’Église actuelle, toujours évaluée négativement et reconnue comme inclinée au modernisme apostat. De cette manière, il ne s’agit pas seulement de conserver la messe tridentine, mais de s’engager dans un programme de restauration de l’Église à partir du paradigme compris par la FSSPX comme la « tradition authentique de l’Église ». Le retour à la tradition conformée au modèle tridentin est assumé comme l’unique chemin pour surmonter la crise profonde de l’Église. Les paroles du père Davide Pagliarini, Supérieur de la FSSPX, sont significatives et révélatrices ; « nous devons avoir le courage de reconnaître que même une bonne posture doctrinale ne suffira pas, si elle n’est pas accompagnée d’une vie pastorale, spirituelle et liturgique cohérente avec les principes que nous voulons défendre » (FSSPX b). La messe traditionnelle demandera une reconfiguration de l’Église à partir du modèle prétendument tridentin et interprété comme la meilleure expression de la Tradition. Pagliarini poursuit : « concrètement, il faut que nous passions à la messe tridentine et à tout ce qu’elle signifie ; il faut que nous allions à la messe catholique et que nous en tirions toutes les conséquences » (FSSPX b). Ces conséquences englobent l’ensemble de la vie ecclésiale contemporaine et forment un véritable programme de restauration : « il ne s’agit pas de restaurer la messe tridentine parce que c’est la meilleure option théorique ; il s’agit de la restaurer, de la vivre et de la défendre jusqu’au martyre, car seule la Croix de Notre-Seigneur peut sortir l’Église de la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve » (FSSPX b). Ainsi comprise, le prétendu retour à la tradition implique une rupture avec de nombreuses réalités considérées comme les grandes conquêtes du dernier Concile. De telles conquêtes sont interprétées comme de grands maux qui doivent être purgés. Les conséquences logiques de cette restauration seraient le rejet total de la réforme liturgique post-conciliaire, la suspension du cheminement œcuménique, la réinterprétation de la liberté religieuse, la remise en question de la collégialité épiscopale et des conférences épiscopales, la méfiance généralisée à l’égard du magistère et des synodes post-conciliaires, la récupération de la théologie scolastique et de la « philosophie pérenne », la posture combative et apologétique face au monde contemporain et à la sécularisation. En somme : un changement radical de la cosmovision catholique existante depuis le Concile Vatican II. L’instaurare omnia in Christo, interprété dans cette logique, a cette portée radicale. Le pôle irradiant de cette restauration est la Messe de saint Pie V avec toutes les conséquences qu’on en tire dans cet horizon de compréhension. On commence par la liturgie traditionnelle et on conclut par le renversement de Vatican II.
Cependant, tous les adeptes de la liturgie traditionnelle ne se sont pas sentis identifiés au radicalisme de cette proposition, surtout au rejet large et véhément du Concile Vatican II. Le risque qu’ils entrevoyaient n’était pas seulement celui d’une mentalité réactionnaire et schismatique, mais aussi des pires formes de sectarisme et d’isolement volontaire, promouvant une défense et une préservation erronées de la foi catholique. D’où la naissance de plusieurs initiatives de dialogue avec Rome et d’accueil et d’inclusion des fidèles traditionalistes dans la pleine communion ecclésiale.
En 1984, Jean-Paul II a accordé que, par un indult et sous des conditions spécifiques, le Missel de saint Pie V puisse être utilisé régulièrement. Par le Motu Proprio Ecclesia Dei afflicta (1988) le même pape a normalisé l’accueil des traditionalistes qui avaient rompu avec Monseigneur Marcel Lefèbvre en raison de l’excommunication encourue par cet archevêque et les évêques qu’il avait ordonnés. Cet événement a plongé la FSSPX dans une situation canonique compliquée qui perdure jusqu’à ce jour, malgré la levée de l’excommunication en 2009. C’est en 1988 qu’est née la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, fondée par d’anciens membres de la fraternité lefebvriana, et directement liée au Saint-Siège, se consacrant à l’apostolat auprès des fidèles traditionalistes qui souhaitaient maintenir la pleine communion avec Rome. Dans cette même perspective, d’autres associations centrées sur l’usage exclusif de la liturgie traditionnelle voient le jour : l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (1990) et l’Institut du Bon Pasteur (2006). À l’approche du Grand Jubilé de l’an 2000, les dialogues et les négociations de plusieurs groupes traditionalistes avec le Saint-Siège se sont intensifiés. Au Brésil, ce mouvement de dépassement de la rupture a abouti à la création d’une circonscription ecclésiastique qui possède son propre évêque en pleine communion avec Rome et conserve pour son clergé et ses fidèles la liturgie romaine traditionnelle. Il s’agit de l’Administration Apostolique Saint-Jean-Marie-Vianney, érigée en 2001 et dont le siège est à Campos dos Goytacazes, RJ.
Le « monde traditionaliste » n’est pas uniforme et monolithique, mais vaste et diversifié. Il abrite en son sein des positions les plus radicales d’opposition et de rejet du Concile Vatican II jusqu’à des attitudes plus ouvertes au dialogue et à l’interaction. Son point de convergence est le Missel de Pie V. Son axe de tension, de conflit et de dispersion passe par l’herméneutique de Vatican II.
5 À la recherche de la réconciliation et de la paix liturgique : Benoît XVI et la Summorum Pontificum
Dans le processus décrit ci-dessus, déjà sous le pontificat de Benoît XVI, la Lettre Apostolique sous forme de Motu Proprio Summorum Pontificum, sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, mérite une mention spéciale. Partant de l’affirmation que le Missel de Paul VI est l’expression ordinaire de la lex orandi de l’Église catholique de rite latin, on admet le Missel de saint Pie V (dans son édition de 1962) comme l’expression extraordinaire de la même lex orandi. Dans son usage vénérable et ancien, il doit jouir de l’honneur qui lui est dû, mais sans que cette disposition ne crée une division de la liturgie de l’Église car ce sont deux usages (ordinaire et extraordinaire) de l’unique rite romain (SP n.1). Ainsi, Benoît XVI a établi qu’« il est licite de célébrer le Sacrifice de la Messe selon l’édition typique du Missel Romain promulguée par le bienheureux Jean XXIII, en 1962, et jamais abrogée comme forme extraordinaire de la liturgie de l’Église » (SP n.1). Il établit également que tout prêtre catholique, dans les messes célébrées sans le peuple et à l’exception des jours du triduum pascal, peut célébrer conforme à ce missel sans avoir besoin d’aucune permission du Siège Apostolique ou de son Ordinaire (SP n.2). Les religieux, dans leurs communautés individuelles ou en tant qu’instituts ou sociétés, peuvent avoir de telles célébrations fréquemment, habituellement ou en permanence, moyennant l’approbation des supérieurs majeurs et en suivant les normes du droit et les lois et statuts particuliers (SP n.3). Les fidèles peuvent être admis aux célébrations à condition qu’ils le demandent spontanément et que les normes du droit soient observées (SP n.4). Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles qui préfère la forme extraordinaire, que les curés ou les recteurs d’églises accueillent cette demande, en harmonisant le bien de ces fidèles avec l’attention ordinaire de la paroisse, sous la direction de l’évêque, mais « en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église » (SP n.5 §1). Si ce groupe de fidèles n’obtient pas ce qu’il demande, qu’il en informe l’évêque diocésain. « On demande vivement que l’évêque satisfasse leur désir. S’il ne peut pourvoir à une telle célébration, que l’affaire soit référée à la Commission Pontificale Ecclesia Dei » (SP n.7). De même, le curé peut accorder la permission d’utiliser le rituel plus ancien dans l’administration des sacrements du baptême, du mariage, de la pénitence et de l’onction des malades « si le bien des âmes le requiert » (SP n.9 §1). « Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer la Confirmation en utilisant l’ancien Pontifical Romain » (SP n.9 §2) et aux clercs il est également licite d’utiliser le Bréviaire Romain promulgué en 1962 (SP n.9 §3). L’Ordinaire du lieu, s’il le juge opportun, peut ériger une paroisse personnelle « pour les célébrations selon la forme la plus ancienne du Rite Romain, ou nommer un aumônier » (SP n.10).
Dans cette même Lettre aux Évêques, après une série de considérations canoniques et pastorales, Benoît XVI entrevoit la possibilité d’une interaction féconde entre les deux formes, ce qu’il a appelé un enrichissement mutuel. « Les deux formes du Rite Romain peuvent s’enrichir mutuellement. Dans l’ancien missel pourront et devront être insérés de nouveaux saints et quelques-unes des nouvelles préfaces ». D’autre part, « dans la célébration de la messe selon le Missel de Paul VI, pourra se manifester, de manière plus intense que cela n’a souvent été le cas jusqu’à présent, cette sacralité qui attire beaucoup vers l’usage ancien ». La garantie la plus sûre que le Missel de Paul VI unisse les communautés paroissiales et qu’il soit aimé par elles est sa célébration « avec une grande révérence, conformément aux rubriques ; cela rend visibles la richesse spirituelle et la profondeur théologique de ce missel ». Par conséquent, a conclu Benoît XVI, il n’existe aucune contradiction entre une édition et l’autre du Missel Romain, car dans l’histoire de la liturgie il y a croissance et progrès, mais aucune rupture.
6 Desafios que permanecem
Le chemin proposé par Benoît XVI dans Summorum Pontificum correspond parfaitement à l’un des axes de son magistère, à savoir l’« herméneutique de la continuité ». Cependant, les mouvements de rupture dans le champ liturgique ont existé et continuent d’exister. D’un côté, la posture négationniste du traditionalisme de tendance lefebvrienne qui n’accorde aucune valeur à la réforme liturgique post-conciliaire et prône la rupture la plus drastique avec son bannissement complet de la vie de l’Église. De l’autre côté, les défenseurs de l’héritage liturgique issu de Vatican II, conscients de ses conquêtes et de ses avancées, mais fermement décidés à ne reculer ni à ne céder en rien (ISNARD, 2008, p.20). Des positions extrêmes, parfois chargées de passion pour leurs étendards respectifs, aboutissant à un climat tendu qui aggrave les divisions existantes.
La voie de la croissance et du progrès dans la liturgie, mais sans ruptures, telle que l’a idéalisée Benoît XVI, reste un défi et difficile. Plus que les formes liturgiques et les particularités de leurs rites, il existe une réalité plus profonde qui précède toutes ces questions. Il s’agit de la tension conflictuelle entre deux formes de compréhension de l’Église et de son positionnement face au monde contemporain. Le débat et les polémiques autour de l’usage du Missel de saint Pie V ne font que manifester un drame et une lutte bien plus profonds et qui sont encore loin d’une résolution pacifique et intégratrice.
La décennie qui s’est écoulée après Summorum Pontificum mérite d’être mieux analysée. Des postures et des opinions raisonnablement tolérantes et ouvertes au dialogue sont devenues plus fréquentes des deux côtés, mais les noyaux durs de la critique et du rejet, que ce soit par rapport à la messe traditionnelle ou à la Messe de Paul VI, restent intacts tant dans les divers groupes traditionalistes que chez les partisans du renouveau liturgique post-conciliaire. Les interviews et les écrits de leurs représentants ou défenseurs en témoignent abondamment (KWASNIEWSKI, 2018, p.133-144 ; GRILLO, 2007, p.103-120).
On ne peut pas parler d’une victoire traditionaliste après Summorum Pontificum (KWASNIEWSKI, 2018, p.223-231). La liturgie de Paul VI n’a pas été abrogée comme le souhaitent encore les plus extrémistes et il n’existe aucune possibilité, proche ou lointaine, qu’une telle abrogation se produise. À son tour, le pape François n’a pas annulé le chemin ouvert par Benoît XVI à l’égard des adeptes de la liturgie traditionnelle ni ne s’est fermé au dialogue avec la Fraternité Saint-Pie X. Cependant, l’impasse demeure concernant la valorisation et la signification du Concile Vatican II. Un éventuel accord théologique sur ce Concile, simultanément acceptable par Rome et par les lefebvristes, est une condition indispensable à la régularisation canonique de la fraternité traditionaliste. Un tel accord n’a pas encore été atteint malgré tous les efforts de Benoît XVI et les démonstrations d’accueil et de bienveillance sous le pontificat de François, avec l’octroi de facultés canoniques concernant les sacrements du mariage et de la pénitence administrés par le clergé de la Fraternité Saint-Pie X. Une réaction extrême face à ce rapprochement initial entre Rome et les traditionalistes de la FSSPX s’est produite avec le départ retentissant de l’évêque Richard Williamson, l’un de ceux consacrés par Monseigneur Marcel Lefèbvre en 1988. Williamson a interprété le rapprochement naissant avec Rome comme une trahison de la cause de la Tradition. Quand il s’agit du Concile Vatican II, on ne travaille qu’avec la perspective de son rejet. C’est pourquoi il a rompu violemment avec la FSSPX en 2012, emmenant avec lui un certain nombre de prêtres et de laïcs et fondant un nouveau courant traditionaliste. Depuis 2015, pour avoir ordonné des évêques sans mandat pontifical, il est retombé dans l’excommunication latae sententiae. Les partisans de Williamson au Brésil sont liés au Monastère de la Sainte-Croix à Nova Friburgo, RJ. La blessure schismatique d’un autre traditionalisme hors de la pleine communion ecclésiale s’est ainsi rouverte.
Loin de toute conduite schismatique, la situation du catholicisme traditionnel aux États-Unis est révélatrice, un pays où Summorum Pontificum a trouvé de grands enthousiastes. On pourrait penser à une avancée traditionaliste notable dans ce pays, mais ce n’est pas ce que l’on constate en termes de réalité. Des recherches révèlent que le catholicisme traditionaliste a progressé aux États-Unis, non pas de manière généralisée, mais ponctuelle et restreinte. Sur plus de 70 millions de catholiques américains, seulement environ 0,3% fréquentent la messe traditionnelle. La majorité expressive du clergé de rite romain (95%) célèbre exclusivement selon le Novus Ordo. Dans un article analysant la recherche mentionnée, nous trouvons le témoignage interpelant de Monseigneur Charles Pope sur cet échec pastoral retentissant :
Dans ma propre Archidiocèse, bien que nous proposions la messe traditionnelle à cinq endroits différents, nous n’avons jamais réussi à attirer plus de mille personnes. C’est seulement la moitié de 1% du nombre total de catholiques qui assistent à la messe dans ce diocèse chaque dimanche. Cela ne convainc pas les évêques que la messe nouvelle n’est pas la liturgie de l’avenir et que le retour de la messe traditionnelle est le meilleur chemin à suivre. Si nous qui aimons la messe traditionnelle pensons que la messe ferait seule sa propre évangélisation, nous nous trompons. Elle est belle et digne de Dieu de bien des manières, mais dans un monde de plaisirs et de divertissements instantanés, nous devons démontrer la valeur pérenne d’une liturgie si belle. La vérité est qu’une liturgie ancienne, parlée dans une langue ancienne et, la plupart du temps, parlée à voix basse, n’est pas quelque chose que la plupart des gens modernes apprécieraient de manière immédiate (BANKE, 2019).
Les milieux constitués autour de la messe traditionnelle ont aussi leurs grands défis. Le plus grand d’entre eux se réfère probablement à la mentalité de ghetto, de groupe d’élite, de constitution des seuls lieux où le vrai catholicisme peut subsister. En pratique, cette mentalité s’est pervertie en isolement par rapport aux autres membres du corps ecclésial, presque toujours évalués de manière péjorative. Un isolement où, en raison d’un certain « esprit d’élite », la critique amère et les prises de position offensantes, chargées de mépris pour tout ce qui a trait à l’Église post-conciliaire, sont très fréquentes. Une telle perversion engendre des antipathies et des résistances et accentue encore plus l’échec pastoral mentionné ci-dessus.
D’autre part, on évalue que Summorum Pontificum n’a pas réussi à mettre en œuvre de manière suffisante l’herméneutique de la continuité dans le domaine liturgique. Au contraire, il a ouvert un espace à un état anormal de contradiction dans la praxis de célébration de l’Église avec la coexistence de deux formes du même rite dont les adeptes ne brillent pas toujours par l’harmonie fraternelle. De l’avis du théologien Andrea Grillo, il y a un « effet dangereusement désorientant » de ce document qui plane sur tous. Selon Grillo (2011), par le biais d’une « fiction juridique », deux formes différentes de célébration de la messe deviennent artificiellement contemporaines. Faisant l’objet d’un choix, « on crée une situation hybride et anormale, qui se révèle bientôt être une confusion, avec laquelle on introduit une grave discontinuité dans la tradition du rite romain ». Ce qui est plus paradoxal et plus grave, c’est la « liberté absolue » accordée au prêtre ou à l’évêque, dans la « célébration sans peuple », qui peuvent désormais choisir entre la forme ordinaire ou extraordinaire, sans avoir de comptes à rendre à personne. Le résultat est que « la réforme liturgique devient ainsi une simple ‘option’ de l’identité ministérielle elle-même. C’est aussi un monstruum inédit par rapport à la Tradition de l’Église ». Et il conclut : « Il est surprenant que le pape Benoît XVI ait assumé une théorie si inconsistante sur le plan juridique et avec des conséquences si incontrôlables sur le plan liturgique, ecclésial et spirituel ». En somme : « une prétention de parallélisme rituel qui instaure une coexistence entre le rite ordinaire et le rite extraordinaire, ce qui – déjà à première vue – se révèle incohérent, inefficace et gravement dangereux pour la communion ecclésiale » (GRILLO, 2011).
Avec la prétention de permettre une double validité de formes différentes et non harmoniques du même rite romain, on détermine progressivement un conflit indomptable entre temps, espaces, habitudes, rites, calendriers, ministères, codes, compétences diverses. L’extension se réfère tant aux habilitations subjectives au rite, c’est-à-dire les critères avec lesquels les sujets peuvent revendiquer des droits à cet égard, qu’aux finalités objectives du rite, qui, plus explicitement, sont définies comme « pastorales ». En réalité, ce document, malgré ses bonnes intentions, court le risque de rendre impossible toute pastorale liturgique, car il a un effet dangereusement désorientant sur tous : principalement sur les évêques, qui perdent le contrôle des diocèses, puis sur les prêtres et, enfin, aussi sur les laïcs, du fait qu’il soustrait à la réforme sa nécessité (GRILLO, 2011).
La relativisation et même le mépris de la réforme liturgique issue de Vatican II fut l’un des effets non désirés par Benoît XVI en publiant Summorum Pontificum. En abusant de l’herméneutique de la continuité, des critiques si radicales ont émergé que même la réforme de la Semaine Sainte réalisée par Pie XII dans les années 1950 a été remise en question. Non seulement remise en question, mais à certains endroits, on a repris la célébration de la Semaine Sainte, comme au temps de saint Pie V. De tels faits révèlent jusqu’où peut aller le degré de rigidité liturgique, en prenant paradoxalement comme point de départ Summorum Pontificum.
Ce tableau préoccupant manifeste la nécessité d’approfondir notre compréhension de la véritable identité de la tradition liturgique. Le Missel de Paul VI, fruit éminent de la réforme liturgique, loin de s’écarter de la véritable Tradition, a rapproché la célébration eucharistique de ses origines qui sont éminemment bibliques et patristiques. La réforme liturgique post-conciliaire a considérablement élargi l’accès à la Parole de Dieu, a souligné le rôle prépondérant de l’Esprit Saint dans l’action eucharistique et a mis en exergue la nature ministérielle et la participation active de toute l’Église en prière.
When the two forms of the Roman rite are analyzed more closely, scholars find that the Missal of Paul VI is effectively more traditional than its Tridentine predecessor. The current missal manifests with greater evidence its connection with the “norm of the Holy Fathers,” so valued by Saint Pius V and his contemporaries, but not fully accessible to them in the 16th century. Hence the surprising recognition that the Tridentine rite is a modern rite when placed in the broader context of the long history of the Roman liturgy (CASSINGENA-TRÉVEDY, 2007, p.89-95).
The passage from this first modern form of the Roman rite to the second, post-conciliar, communal, relational, symbolic-ritual form, happened through a Council and a long phase of reform, which was caused by the limits, the gaps, the unilateralisms of the Tridentine rite, of which the Church had become progressively aware, starting from the 19th century. The passage that the reform wants to promote refers to the subject who celebrates (from the individual priest to the assembly/ministers relationship), to the rite (which is no longer just to be observed by an individual, but must be celebrated by a community), to the relationship with God (which, from monological, becomes dialogical), to the Word of God (which now has space, sacramental visibility, and much more significant richness), to the role of communion (which is now done by all as a ritual action of the mass and no longer as a private devotion) (GRILLO, 2011).
The historical evolution of the Roman rite is verified through the passage of its various stages. In this passage, there is an evolution guided by creative fidelity, as Paul VI well explained in the Apostolic Constitution Missale Romanum and in the proemium of the General Instruction of the Roman Missal. The two forms can only be correctly understood in their continuity if situated in a diachronic succession (GRILLO, 2011). However, when different forms become artificially contemporary and the object of free choice, with the aggravating factor of a context of old misunderstandings and unresolved prejudices, what one has is the great risk of discontinuity and liturgical rupture and serious threats to ecclesial unity itself.
In truth, the greatest challenges go beyond the limits of liturgical praxis. They are challenges of the ecclesial life itself, marked by tensions and hopes, conflicts and possibilities of growth and retreat. The liturgy is “the summit toward which the activity of the Church is directed” and, at the same time, “the font from which all her power flows” (SC n.10). Occupying this central and vital position, it is evident that everything the Church experiences is also manifested, in various forms, in its liturgy. Including its disagreements and impasses.
Luiz Antônio Reis Costa, São José Theological Institute, Mariana, MG – (original Portuguese text).
7 References
AILLER, Marc. The Old Mass and the New. Explaining the Motu Proprio Summorum Pontificum of Pope Benedict XVI. San Francisco: Ignatius Press, 2010.
BANKE, Dan. Reality Check: No, the Latin Mass Is Not Taking Over. Available at: https://onepeterfive.com/reality-check-latin-mass/. Accessed on: 28 Sep 2019.
BENTO XVI. Carta Apostólica sob a forma de Motu Proprio Summorum Pontificum sobre o uso da liturgia romana anterior à reforma de 1970. São Paulo: Paulinas, 2007.
BOROBIO, Dionisio. A Celebração da Igreja. Sacramentos. São Paulo: Loyola, 1993.
BROUARD, Maurice. Eucharistia. Enciclopédia da Eucaristia. São Paulo: Paulus, 2006.
BUX, Nicola. Benedict XVI’s Reform. The liturgy between innovation and Tradition. San Francisco: Ignatius Press, 2012.
CASSINGENA-TRÉVEDY. François. Te Igitur. Le Misel de Sainte Pie V. Herméutique et déontologie d’un attachement. Genève: Ad Solem, 2007.
CEKADA, Anthony. Work of Human Hands. A theological critique of the Mass of Paul VI. West Chester: Philothea Press, 2010.
DAVIES, Michael. Cranmer’s Godly Order. The destruction of Catholicism through liturgical change. Fort Collins: Roman Catholic Books, 1995.
DE CHIVRÉ, Bernard-Marie. The Mass of Saint Pius V. Spiritual and theological commentaries. Winona: STAS Editions, 2007.
FRATERNIDADE SACERDOTAL SÃO PIO X. O problema da Reforma Litúrgica. A Missa do Vaticano II e de Paulo VI. Niterói: Permanência, 2001.
______ a. Quem somos. Available at: >https://www.fsspx.com.br/sobre-a-fraternidade-sao-pio-x/<. Accessed on: 6 Oct 2019.
______ b. Uma Igreja de pernas para o ar. Available at: >https://www.fsspx.com.br/uma-igreja-de-pernas-para-o-ar/<. Accessed on: 21 Oct 2019.
GRILLO, Andrea. Oltre Pio V. La reforma liturgica nel conflito di interpretazioni. Brescia: Queriniana, 2007.
______ . Por uma Ecclesia verdadeiramente Universal. Entrevista. IHU, 28 May 2011. Available at: >http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/43708-por-uma-%60%60ecclesia%60%60-verdadeiramente-%60%60universa%60%60-entrevista-especial-com-andrea-grillo . Accessed on: 10 Dec 2019.
INSTRUÇÃO GERAL SOBRE O MISSAL ROMANO. São Paulo: Paulinas, 2007.
ISNARD, Clemente. Reflexões de um bispo sobre as instituições eclesiásticas atuais. São Paulo: Olho d’água, 2008.
JUNGMANN, Josef Andreas. Missarum Solemnia. Origens, liturgia, história e teologia da Missa romana. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2010.
KWASNIEWSKI, Peter. Ressurgente em meio à crise. A liturgia sagrada, a Missa tradicional e a renovação da Igreja. Campinas: Ecclesiae, 2018.
OTTAVIANI, Alfredo; BACCI, Antonio. Breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Available at >https://adelantelafe.com/download/breve-examen-critico-del-novus-ordo-missae/ <. Accessed on 24 Sep 2019.
RIFAN, Fernando Arêas. Considerações sobre as formas do Rito Romano da Santa Missa. Campos dos Goytacazes: AASJMV, 2007.
TABORDA, Francisco. O memorial do Senhor. Ensaios litúrgico-teológicos sobre a Eucaristia. São Paulo: Loyola, 2009.